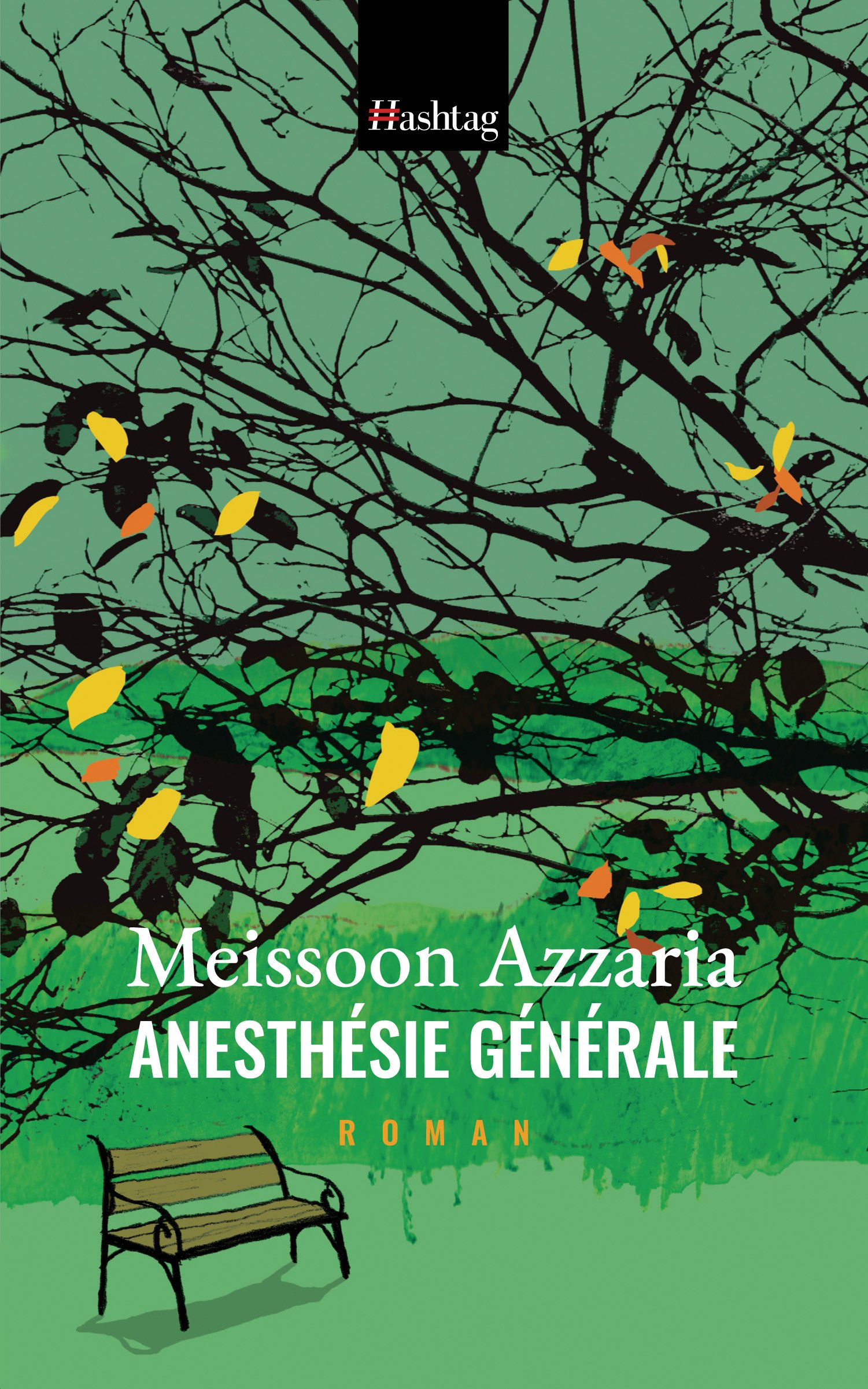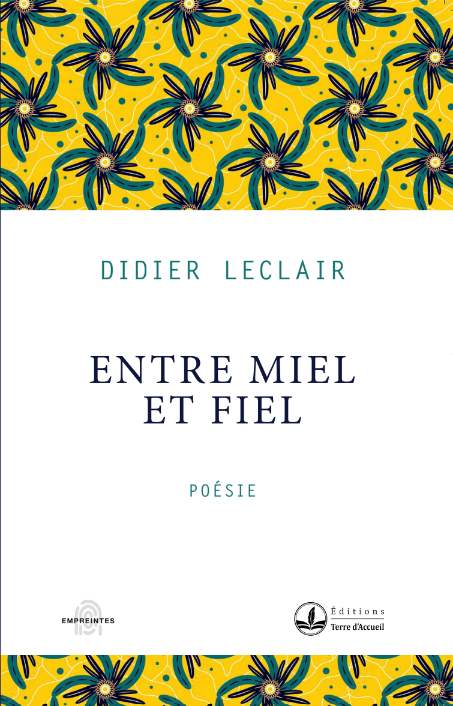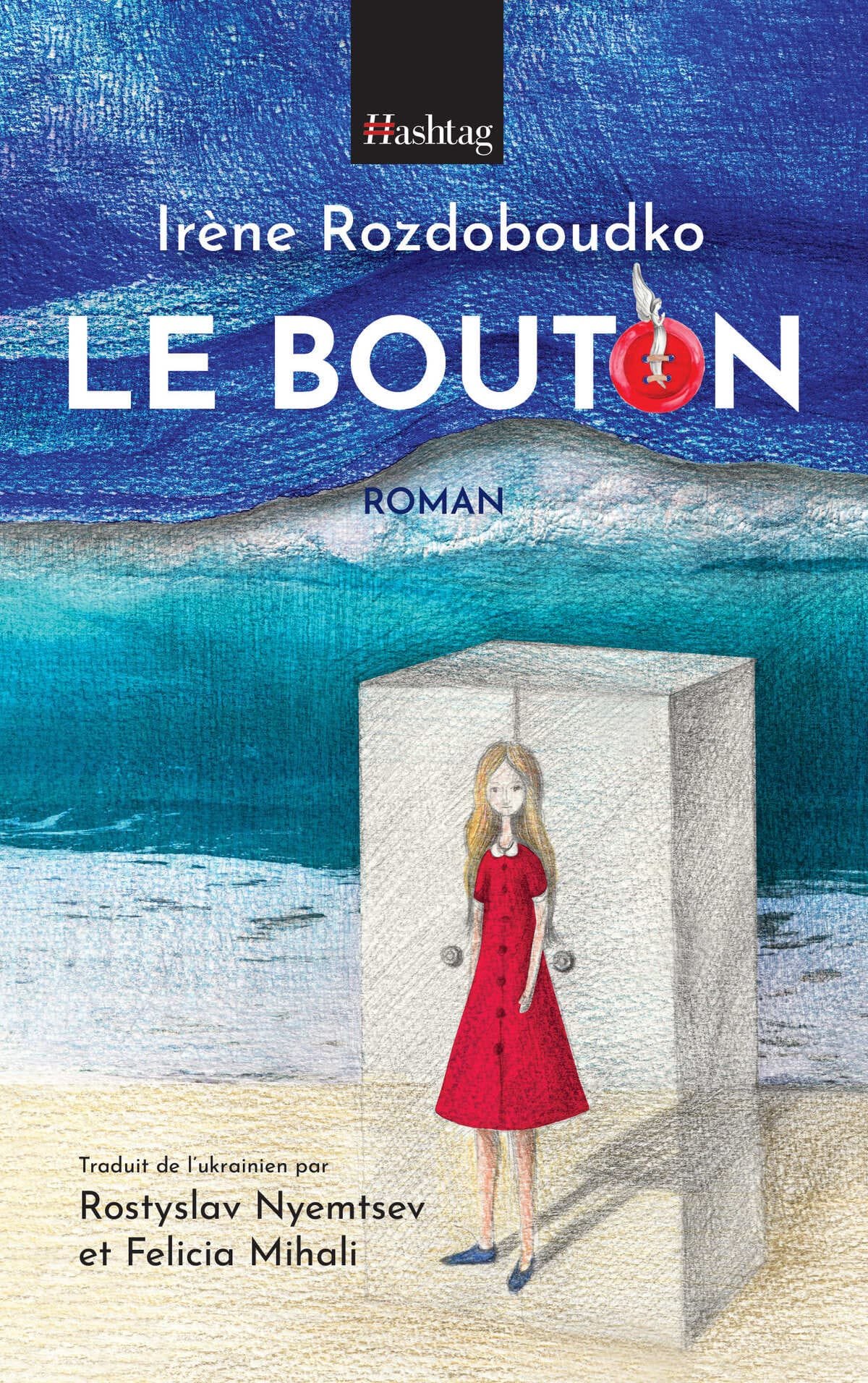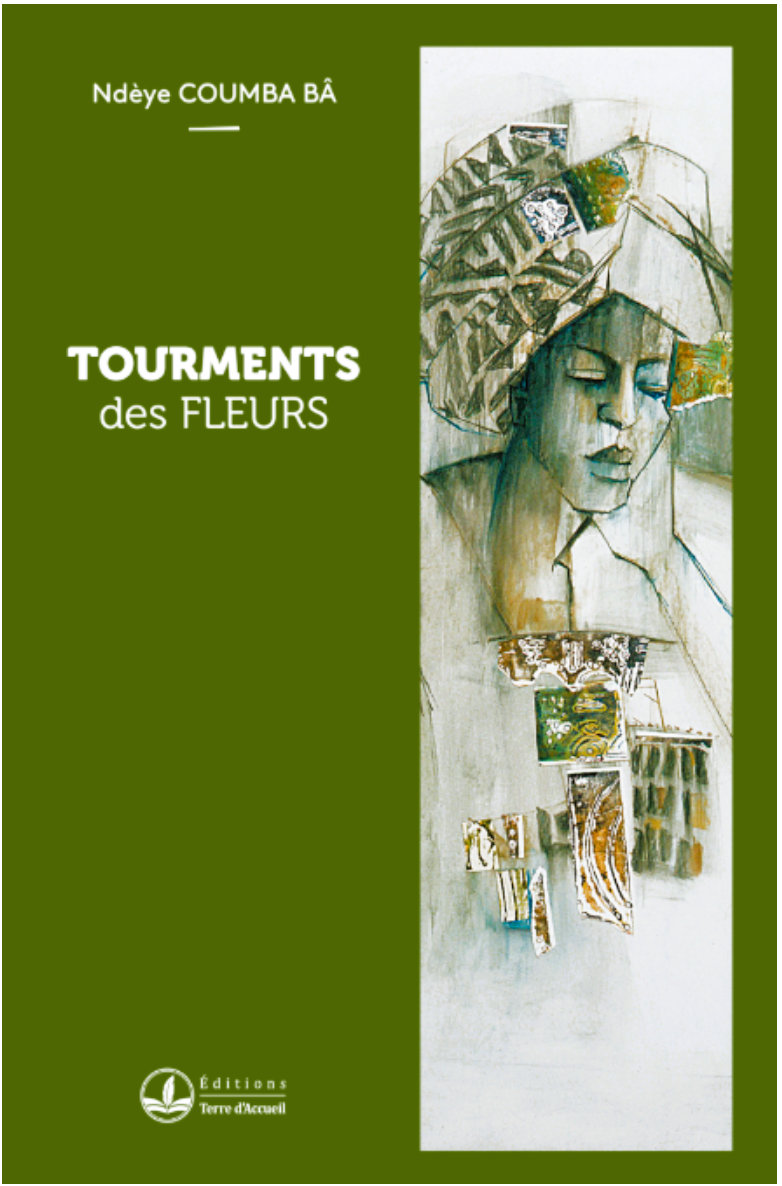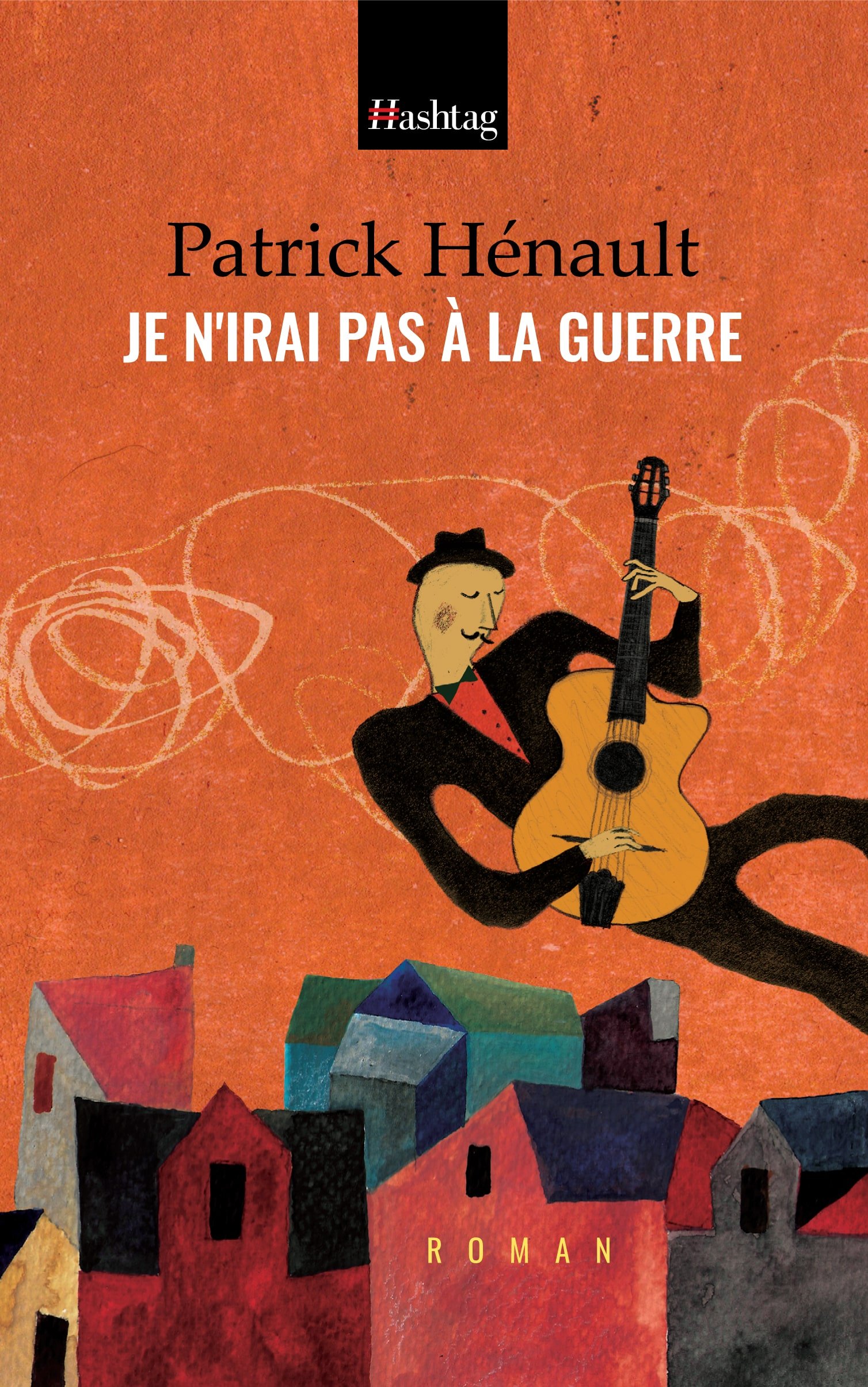Dans « Anesthésie générale », Meissoon Azzaria propose un récit introspectif, à la fois poétique et hanté, porté par la voix solitaire de Hanane, une femme en quête d’une réanimation multiple : de soi, de sens, de mémoire. Comme dans un état second, entre veille et rêve, Hanane tourne inlassablement autour du parc Beaubien (Montréal), au cœur d’une ville grise, figée, presque anesthésiée. Au fil de la lecture, on constate que ce mouvement presque circulaire n’est pas anodin, car on y entrevoit une errance existentielle, mais aussi une spirale mémorielle où se rejouent les fragments d’un passé individuel et collectif.
****
Dès les premières pages, le roman s’ancre dans une tension entre l’oubli et la mémoire. Hanane, en proie à une forme de léthargie affective, porte en elle les « lourdes valises de ses ancêtres », comme si l’histoire de sa famille, marquée par la guerre, l’exil et la dispersion physique, s’infiltrait dans ses propres cellules. À ce titre, le roman m’a fait penser à Paul Ricoeur, pour qui la mémoire n’est pas une simple restitution du passé, mais un acte interprétatif, toujours mêlé d’oubli et de reconstruction. L’identité de Hanane ne peut être comprise sans cette mémoire, à la fois vive et confuse, de son oncle décédé, qui sert de point d’ancrage à une quête plus large de sens.
****
La question de l’identité traverse le roman comme une ligne de fracture. Hanane est multiple : Québécoise, Irakienne, Arménienne, Britannique, et pourtant, elle semble en questionnment avec ces appartenances. L’évocation de son enfance à Laval, « à l’époque, il y avait encore peu de familles immigrantes », témoigne d’une expérience de l’altérité qui a modelé une forme de retrait intérieur. À la manière d’Amartya Sen, qui défend l’idée des identités plurielles, Hanane incarne une subjectivité éclatée, refusant les assignations rigides, mais cherchant à tisser du lien entre ses différentes strates identitaires.
Ce morcellement identitaire se traduit par un rapport troublé au réel : « Si personne ne sait ce que je pense, cette pensée existe-t-elle ? Est-ce que j’existe si personne ne le certifie ? ». Ce doute ontologique n’est pas sans rappeler les « Rêveries du promeneur solitaire » de Jean-Jacques Rousseau. Mais là où Rousseau cherchait la paix dans la contemplation de la nature, Hanane s’enlise dans la torpeur urbaine, prisonnière d’un monde où la reconnaissance, même intérieure, semble hors de portée.
******
Le style du roman, intimiste et sensoriel, donne à voir une narratrice d’une acuité rare, capable de capter les moindres frémissements de son environnement et de son for intérieur. Rien ne lui échappe : ni les gestes anodins des passants, ni les fissures de ses pensées. Cette hyperconscience crée une atmosphère presque claustrophobe, où chaque détour de la promenade est aussi une plongée dans l’abîme du soi. Hanane est incontestablement une narratrice ultrasensible. Elle est, de fait, témoin du dedans et du dehors
Un fait ayant attiré l’attention de la lectrice que je suis : les relations avec les hommes, par exemple, sont abordées avec une lucidité désarmante. Hanane y projette ses propres incertitudes, ses héritages, ses blessures. Ce n’est pas tant l’autre sexe qu’elle fuit, mais ce que cet autre réveille en elle de non-résolu.
Pour moi, « Anesthésie générale » est avant tout le roman du doute. Il questionne tout : la mémoire, l’identité, la filiation, le désir, la réalité même de l’existence. Mais il le fait sans emphase, sans recherche d’effet. Il préfère la lenteur du ressassement, le vertige du silence intérieur à l’éclat du spectaculaire. En cela, le titre du roman prend tout son sens : Hanane est à la fois anesthésiée par la violence du monde et en quête d’un antidote, d’un sursaut. On dirait un long Poème… Roman audacieux et résolument intimiste qui s’inscrit dans une tradition littéraire du questionnement existentiel, tout en y apportant une voix singulière, nourrie de migrations, de deuils et de résistances silencieuses. Ce livre, qui interpelle par sa densité introspective et son écriture précise, nous marque au fer et laisse la trace d’une empreinte durable, celle d’une femme qui marche pour ne pas sombrer, qui pense pour ne pas s’effacer.
Merci à Hashtag pour le service de presse… toujours apprécié
Nathasha Pemba