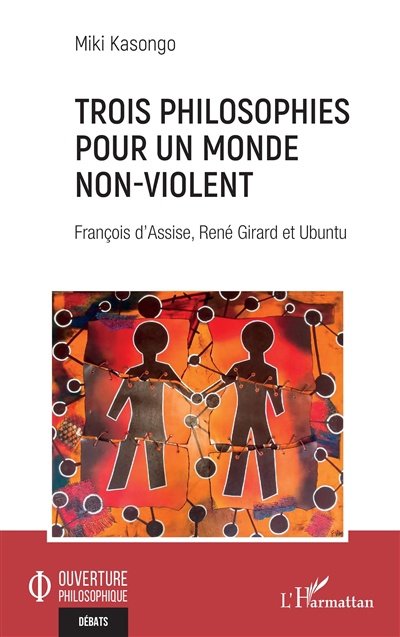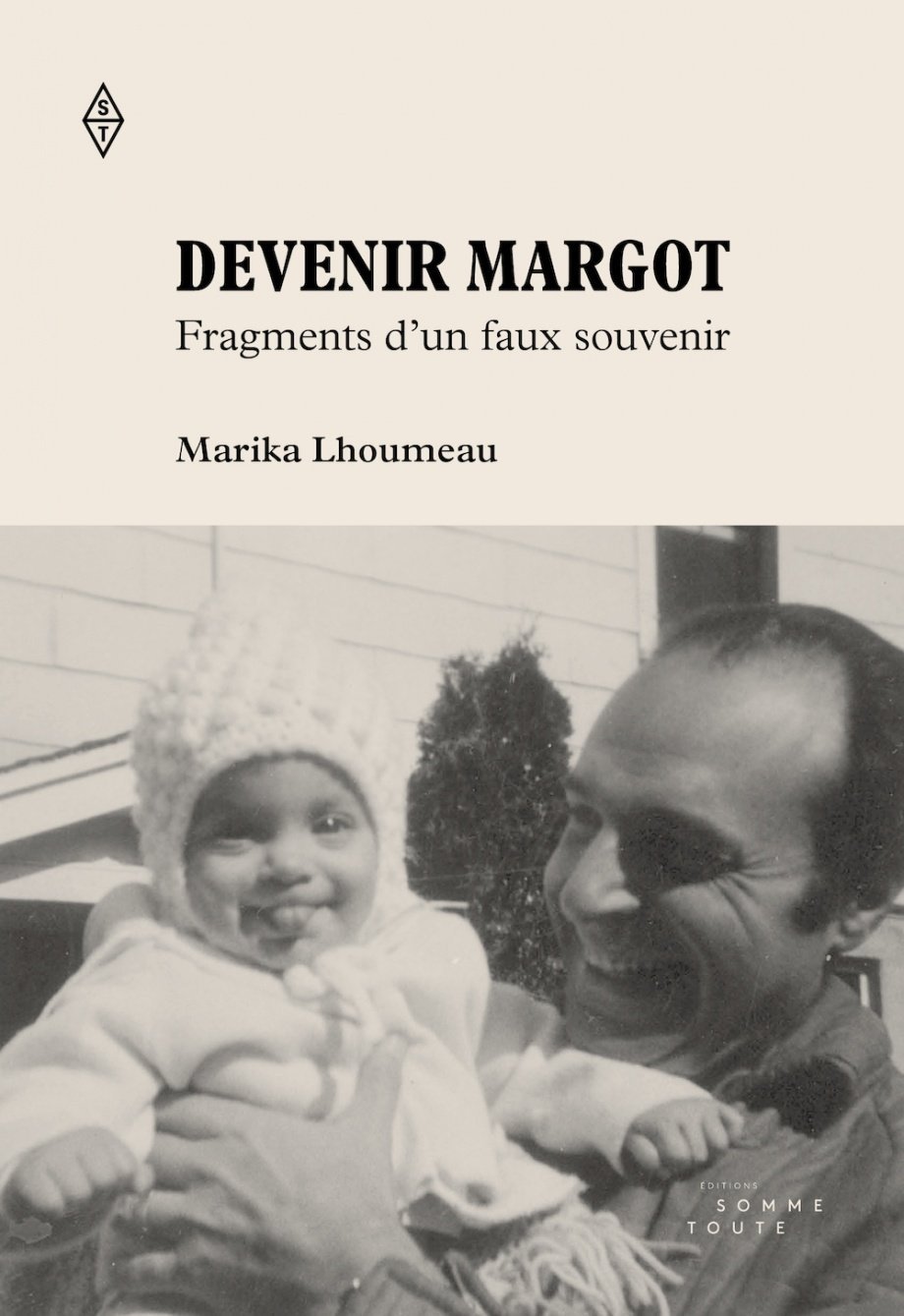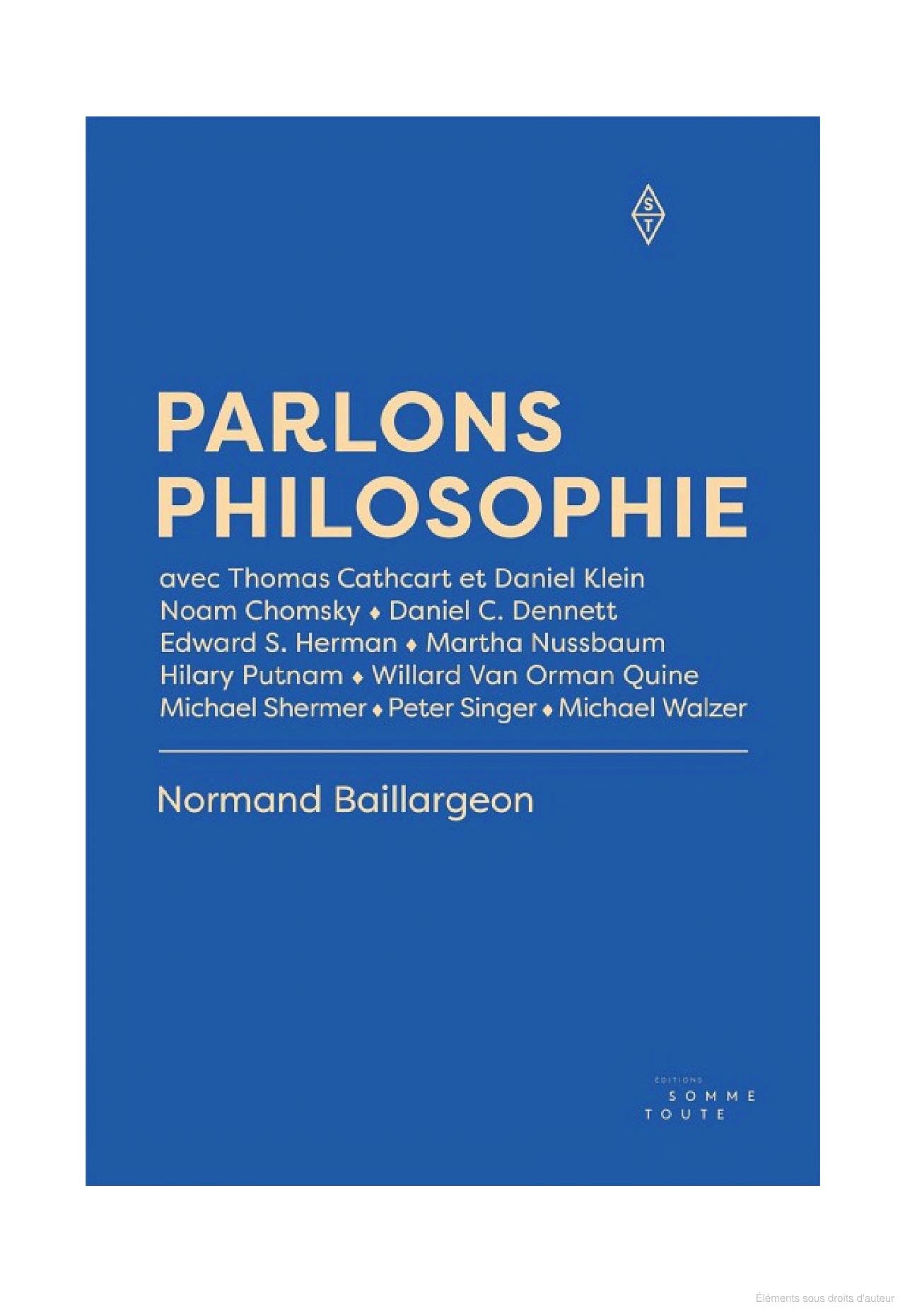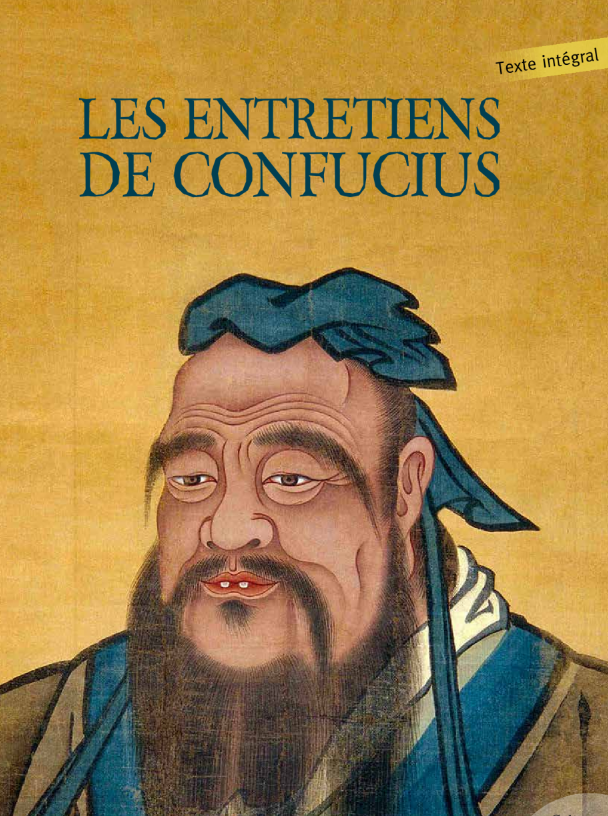Dans un monde où les conflits se multiplient et où la violence semble gagner du terrain, comment expliquer cette persistance de la barbarie ? Faut-il se résigner à voir en l’homme un loup pour l’homme, condamné par ses instincts ou ses conditions sociales à reproduire éternellement les mêmes schémas destructeurs ?
Un essai récent, Trois philosophies pour un monde non-violent : François d’Assise, René Girard et Ubuntu, bouleverse ces certitudes en proposant une grille de lecture inédite. Son auteur refuse les explications traditionnelles qui font de la violence soit une fatalité biologique, soit le produit mécanique d’injustices sociales. À la place, il nous invite dans un voyage philosophique fascinant à travers trois traditions qui, malgré leurs origines diverses, convergent vers une même révélation : la violence n’est pas une fatalité, mais le résultat d’un mécanisme que nous pouvons comprendre et dépasser.
Le piège du désir mimétique
Au cœur de cette nouvelle approche se trouve l’intuition géniale de René Girard : nous sommes violents parce que nous désirons ce que désire autrui. Cette « mimesis » du désir crée des rivalités inexorables, surtout quand l’objet convoité ne peut être partagé. Contrairement aux pulsions animales qui s’apaisent une fois satisfaites, le désir humain se nourrit de lui-même, créant des spirales de violence-vengeance dont les sociétés peinent à s’extraire.
Cette grille de lecture éclaire d’un jour nouveau les conflits contemporains : des rivalités géopolitiques aux violences domestiques, en passant par les guerres commerciales ou les tensions communautaires. Partout, le même schéma se répète : je désire ce que tu as, tu résistes, j’escalade, tu ripostes…
Mais si le diagnostic est sombre, l’espoir renaît avec les solutions proposées. Car trois traditions, nées dans des contextes radicalement différents, ont expérimenté des chemins de sortie remarquablement convergents.
François d’Assise : l’art du dépouillement
La première voie explorée plonge dans l’Italie du XIIIe siècle, où François d’Assise révolutionne le christianisme par sa radicalité évangélique. Face aux rivalités de son époque – marchands contre nobles, villes contre campagnes, chrétiens contre musulmans –, le saint d’Assise propose une solution révolutionnaire : le dépouillement volontaire.
En renonçant à toute possession, François brise mécaniquement la logique mimétique. Impossible d’envier celui qui n’a rien, difficile de rivaliser avec qui refuse la compétition. Sa pauvreté choisie devient ainsi un acte politique radical : elle démonte les ressorts de la violence acquisitive et ouvre l’espace à la fraternité universelle.
L’intuition franciscaine dépasse le cadre religieux : elle révèle que la sortie de la violence passe parfois par la sortie du jeu lui-même. Une leçon que certaines entreprises redécouvrent aujourd’hui en adoptant des modèles économiques coopératifs, ou que des communautés expérimentent à travers la décroissance choisie.
René Girard : la lucidité salvatrice
Deuxième pilier de cette trilogie : l’œuvre de René Girard lui-même. L’anthropologue français ne se contente pas de diagnostiquer le mécanisme mimétique, il en dessine les issues. Sa prescription ? La prise de conscience. Comprendre nos désirs rivalitaires, c’est déjà commencer à s’en affranchir.
Girard montre comment les sociétés traditionnelles canalisaient cette violence par le sacrifice rituel – un bouc émissaire cristallisant sur lui toute l’agressivité collective. Mais cette solution archaïque n’est plus viable dans nos sociétés modernes. Il nous faut inventer de nouveaux rituels de pacification, fondés sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur l’exclusion.
Cette approche inspire aujourd’hui de nombreuses pratiques : cercles de parole dans les entreprises, médiations familiales, processus de réconciliation post-conflit. Partout où l’on fait le pari que nommer la rivalité, c’est déjà la désarmer.
Ubuntu : « Je suis parce que nous sommes »
Mais c’est sans doute la troisième tradition qui offre les perspectives les plus concrètes. L’Ubuntu, philosophie africaine millénaire, repose sur une vision radicalement relationnelle de l’être humain. Son principe fondateur – « Je suis parce que nous sommes » – inverse notre conception occidentale de l’individualité.
Loin d’étouffer la personne dans le collectif, l’Ubuntu révèle que notre humanité ne se réalise que dans la relation à autrui. Cette philosophie privilégie la restauration sur la punition, l’interdépendance sur la compétition, la réconciliation sur la vengeance.
L’Afrique du Sud post-apartheid en a offert la démonstration grandeur nature. Plutôt que de juger et emprisonner les criminels du régime raciste, les Commissions Vérité et Réconciliation ont privilégié le témoignage, la reconnaissance de la souffrance des victimes et la possibilité du pardon. Un pari fou qui a permis d’éviter la guerre civile et de reconstruire – imparfaitement mais réellement – une nation.
Convergences troublantes
Ce qui fascine dans cet essai, c’est la convergence troublante de ces trois approches. Malgré leurs origines diverses – Europe chrétienne médiévale, anthropologie contemporaine, sagesse africaine traditionnelle –, toutes pointent vers les mêmes intuitions : la violence naît de la rivalité, la paix se construit par la relation, la réconciliation passe par la reconnaissance mutuelle.
Cette convergence suggère l’existence de constantes anthropologiques profondes. Comme si l’humanité, à travers ses différentes cultures, avait expérimenté des chemins similaires pour dépasser ses propres démons.
Des applications concrètes
Au-delà de la réflexion philosophique, l’ouvrage montre comment ces principes trouvent des applications concrètes dans nos sociétés contemporaines. De la justice restaurative qui se développe dans plusieurs pays aux pratiques de médiation qui transforment les entreprises, en passant par les processus de réconciliation post-conflit, ces philosophies nourrissent une révolution silencieuse.
Même les neurosciences viennent confirmer certaines intuitions : les recherches sur les neurones miroirs révèlent notre propension naturelle à l’imitation, validant scientifiquement l’hypothèse girardienne du désir mimétique.
Limites et défis
L’essai ne cache pas les défis de ces approches. Comment transposer l’Ubuntu au-delà de son contexte africain d’origine ? Comment articuler ces trois philosophies dans des politiques publiques cohérentes ? Comment surmonter les résistances institutionnelles qui perpétuent les logiques punitives ?
Ces questions restent largement ouvertes, mais elles n’invalident pas la pertinence de la démarche. Elles appellent plutôt à poursuivre l’exploration, à expérimenter, à inventer les formes contemporaines de ces sagesses anciennes.
Un espoir raisonné
Trois philosophies pour un monde non-violent ne verse pas dans l’utopisme béat. Il propose un espoir raisonné, fondé sur une compréhension lucide des mécanismes humains et sur l’expérimentation concrète d’alternatives viables.
Son message résonne avec une actualité particulière à l’heure où les tensions se multiplient – géopolitiques, sociales, environnementales. Face à ces défis, les réflexes sécuritaires et punitifs montrent leurs limites. Il devient urgent d’explorer d’autres voies, de puiser dans la diversité des sagesses humaines pour inventer les chemins de paix de demain.
Cet essai nous y invite avec une rare intelligence, démontrant que la non-violence n’est ni naïveté ni faiblesse, mais une praxis exigeante qui demande courage, lucidité et patience. Un programme ambitieux pour qui refuse de se résigner à la barbarie contemporaine.
À lire : Trois philosophies pour un monde non-violent : François d’Assise, René Girard et Ubuntu, essai philosophique qui révolutionne notre compréhension de la violence et de ses dépassements possibles.
Karl Makosso