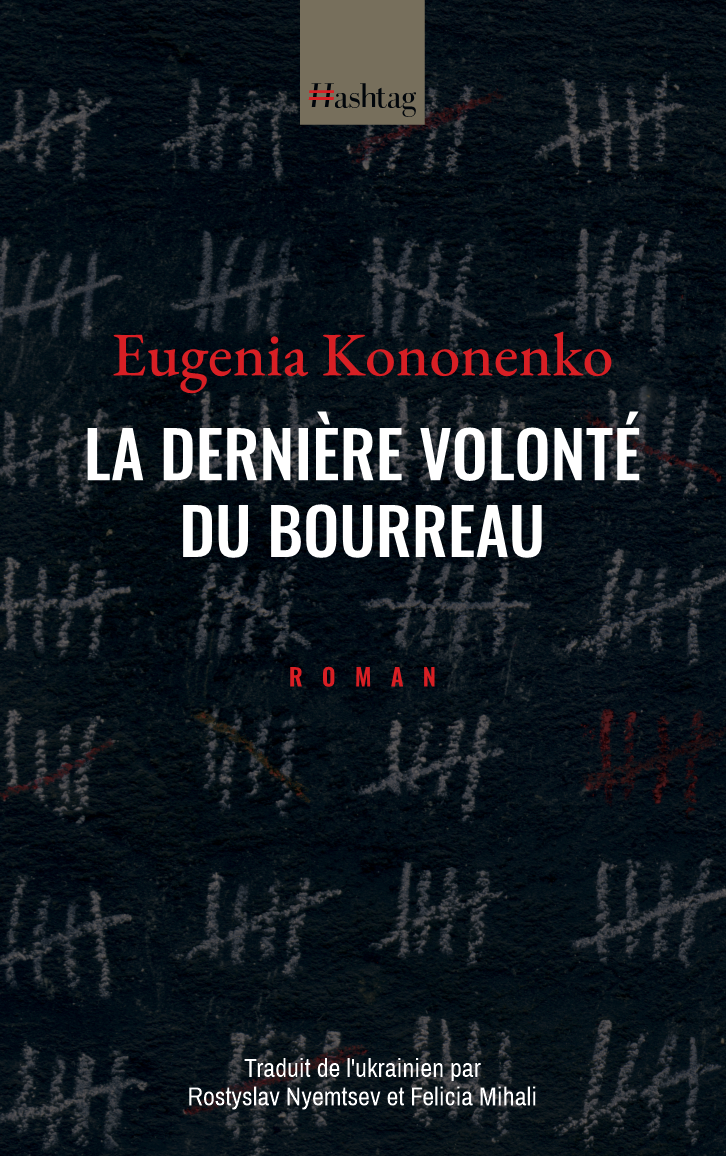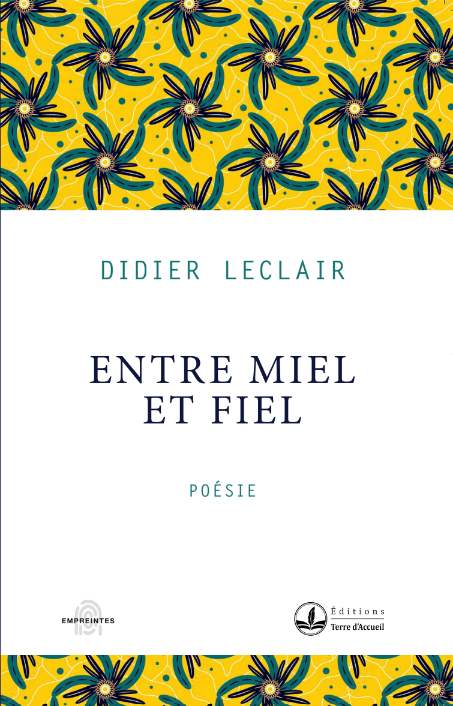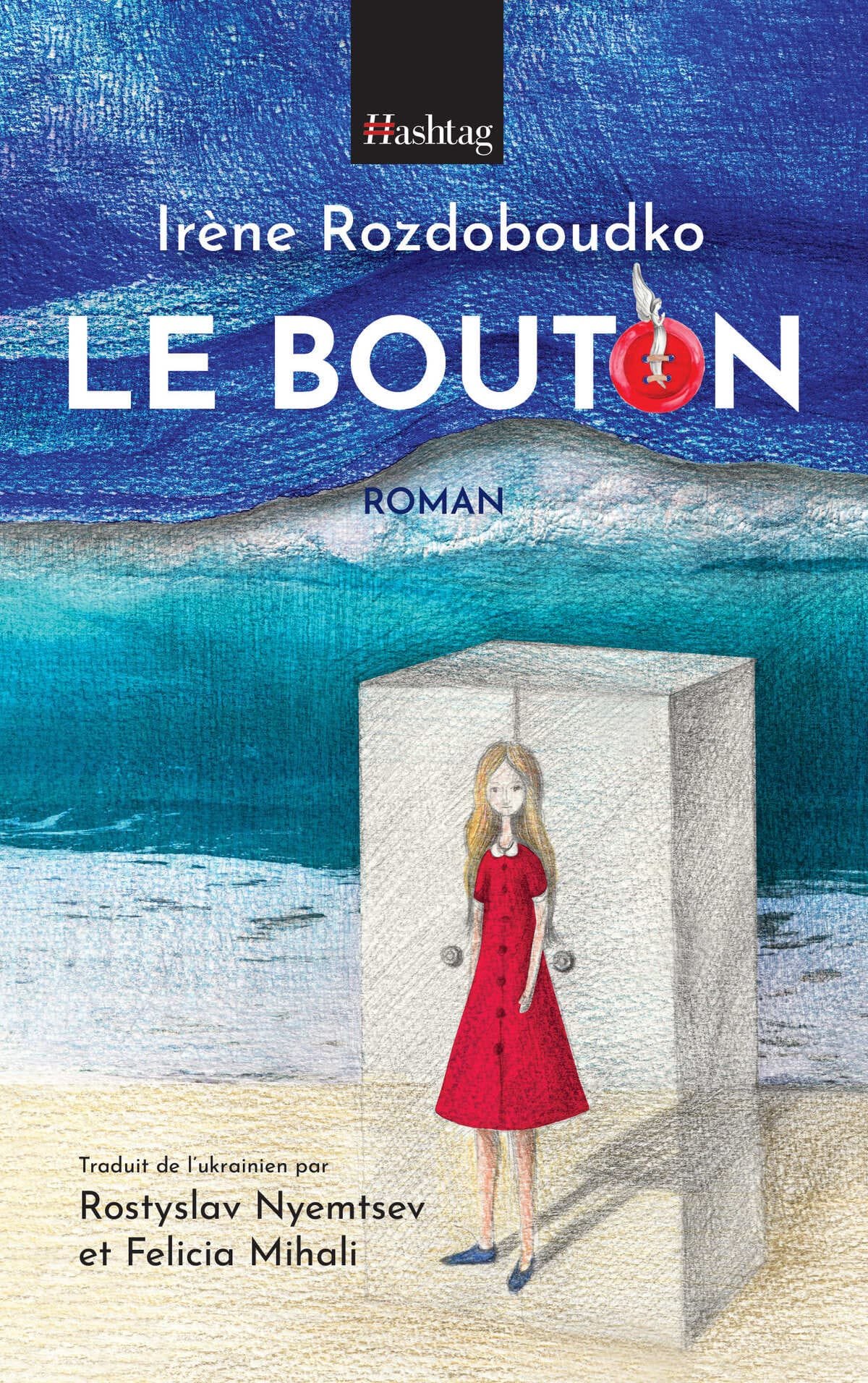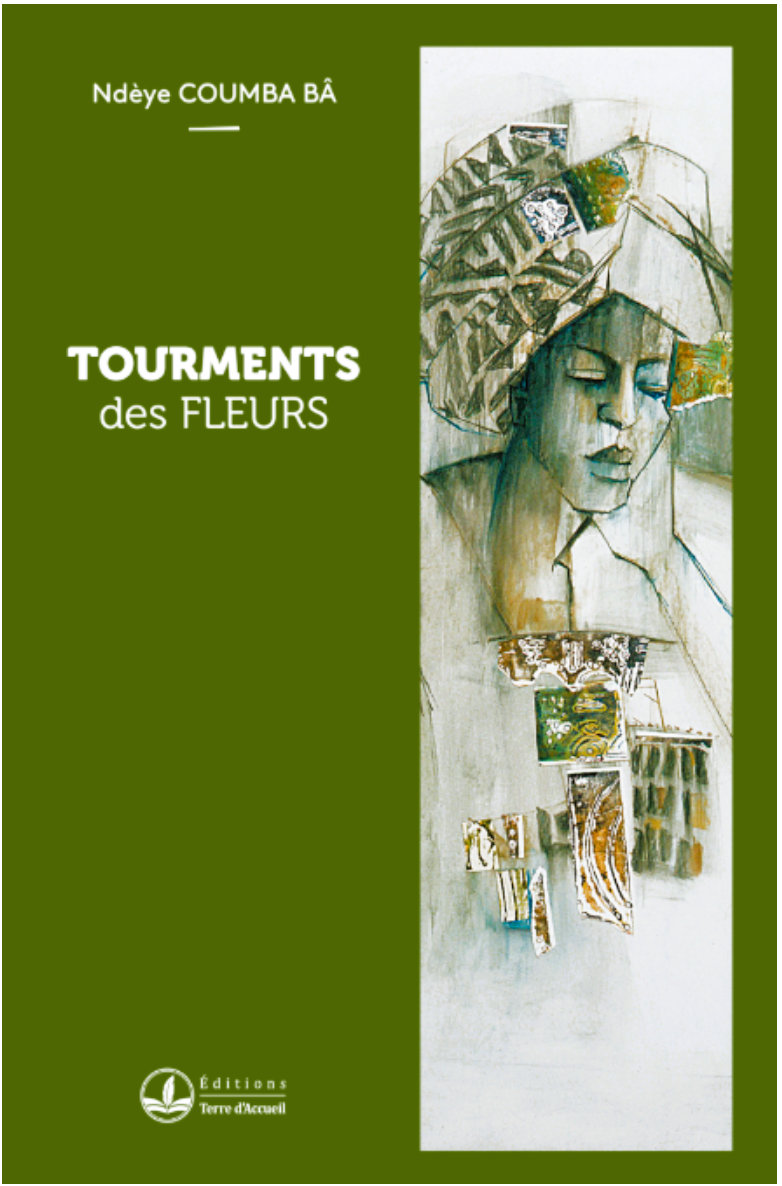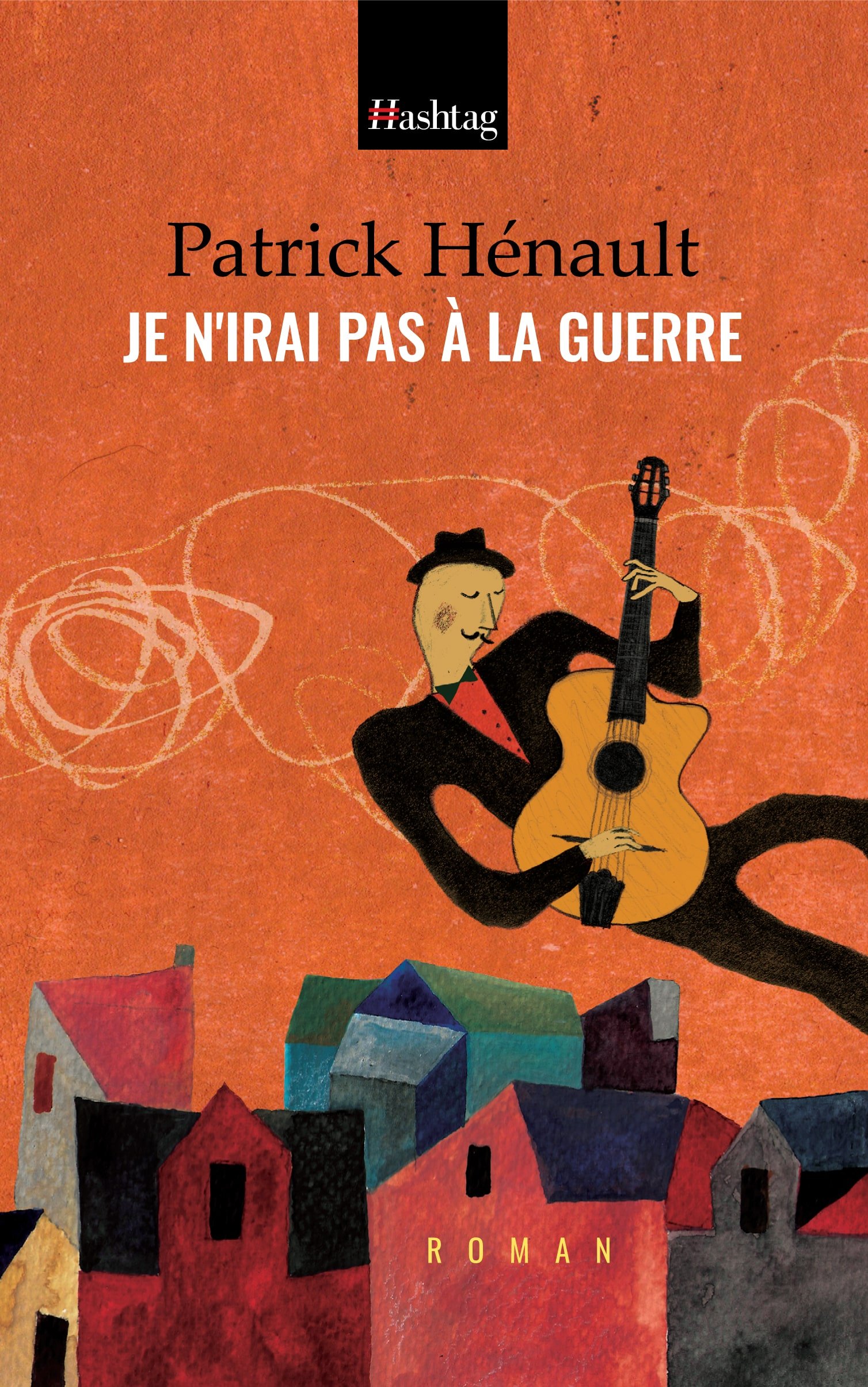Littérature, mémoire et survivance sous le poids de l’Histoire
Avec La dernière volonté du bourreau, Eugenia Kononenko offre bien plus que le portrait d’un vieil écrivain rongé par la maladie et les remords. Elle propose un roman profondément lucide sur le rôle de la littérature dans les contextes d’oppression, sur le fardeau d’un passé soviétique que ni le temps ni la maladie ne peuvent effacer, et sur la complexité du pardon dans les sociétés post-totalitaires.
Au cœur du récit, Ivan Ivak, ancien écrivain soviétique, vit ses derniers jours dans un mélange d’asphyxie physique et morale. Jadis agent du NKVD et auteur respecté du régime communiste, il est aujourd’hui méprisé par sa propre famille, oublié du public, et hanté par une œuvre qu’il n’a jamais pu écrire “en toute liberté”.
Sa dernière volonté ? Réhabiliter sa mémoire, et surtout faire lire une œuvre authentique, débarrassée des chaînes idéologiques.
Le poids de l’histoire et l’urgence du témoignage
À travers ce personnage, Kononenko soulève une question essentielle et douloureuse : que devient un écrivain lorsque la liberté d’expression est confisquée par l’État ? Ivak est un homme de lettres brisé, mais aussi une figure emblématique d’un système où la littérature n’était tolérée qu’à condition de servir le discours officiel. Il est le produit d’un compromis permanent entre ce qu’on pense, ce qu’on écrit, et ce qu’on publie. Le NKVD n’a pas seulement été l’organe de la répression politique, il fut aussi un grand censeur de l’âme.
La dernière volonté du bourreau résonne avec force dans le contexte géopolitique actuel, alors que la Russie de Poutine ravive des pratiques autoritaires où le passé soviétique est de plus en plus glorifié, et où les écrivains et penseurs critiques sont réduits au silence, emprisonnés ou contraints à l’exil. À l’heure où la guerre en Ukraine réactive des tensions historiques et mémorielles, La dernière volonté du bourreau nous rappelle que sans travail de mémoire, il ne peut y avoir de futur viable. Comme le dit un des personnages : « Sans repentir des parents, il n’y a pas d’avenir pour les enfants. »
De la servitude volontaire à la liberté intérieure
À la manière de Milan Kundera, Kononenko explore les contradictions intimes des individus pris dans l’engrenage totalitaire. Ivak n’est ni tout à fait une victime, ni tout à fait un bourreau : il est le fruit d’un système qui exigeait de ses écrivains qu’ils renoncent à eux-mêmes pour être publiés. Le roman rejoint ainsi les grandes réflexions de Kundera dans Le Livre du rire et de l’oubli ou L’Insoutenable légèreté de l’être, où la mémoire et l’oubli, la légèreté et la gravité, sont autant d’instruments de résistance ou de soumission.
Kononenko interroge la possibilité d’une liberté intérieure dans un monde verrouillé par la peur.
Le silence d’Ivak est celui de toute une génération d’intellectuels soviétiques qui, comme Pasternak, Grossman ou même Chalamov, ont connu l’humiliation de la censure, de la prison, ou du silence imposé. Certains ont fui, d’autres ont résisté par l’ambiguïté de leurs œuvres. D’autres encore, comme Ivak, se sont tus trop longtemps…. D,autres encore, spus des cieux non-soviétiques continuent de se taire.
Peut-on rester fidèle à soi-même lorsque l’écriture est surveillée ?
Peut-on être écrivain sans trahir la vérité ?
Littérature comme survie et rédemption
Dans cette dernière volonté, on note aussi un ultime espoir : celui que l’écriture puisse encore servir à témoigner, à transmettre. Ivak, malgré sa maladie, veut livrer au monde une œuvre libérée, affranchie des carcans de son époque. Le roman souligne ainsi le pouvoir rédempteur de la littérature, non pas comme outil de propagande, mais comme acte de vérité, de lucidité et de transmission.
La citation suivante éclaire cette volonté : « Le brave écrivain soviétique souffrait d’un blocage. Il voulait que les lecteurs aient finalement accès à une œuvre créée en toute liberté. »
C’est là, à mon avis, que réside la vocation profonde de l’écrivain, même en contexte d’oppression : porter le poids du réel, dire ce que l’on ne peut dire, écrire pour être soi.
Nathasha Pemba