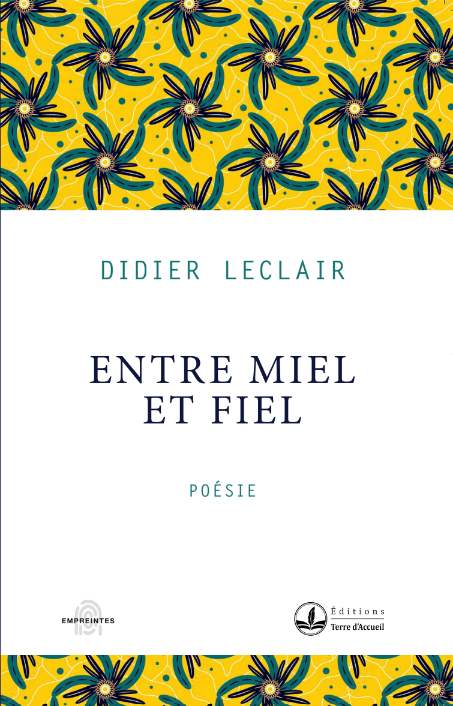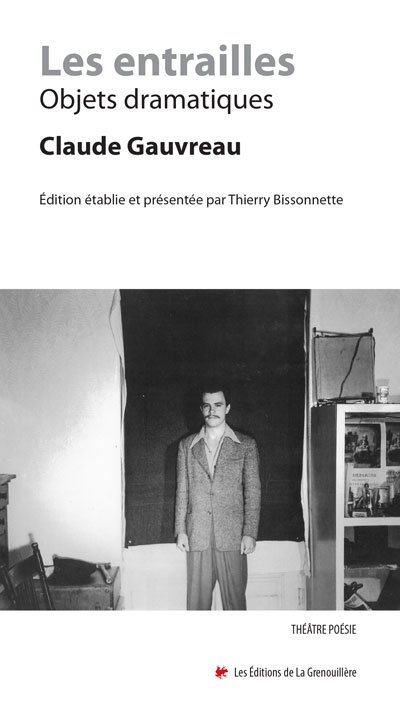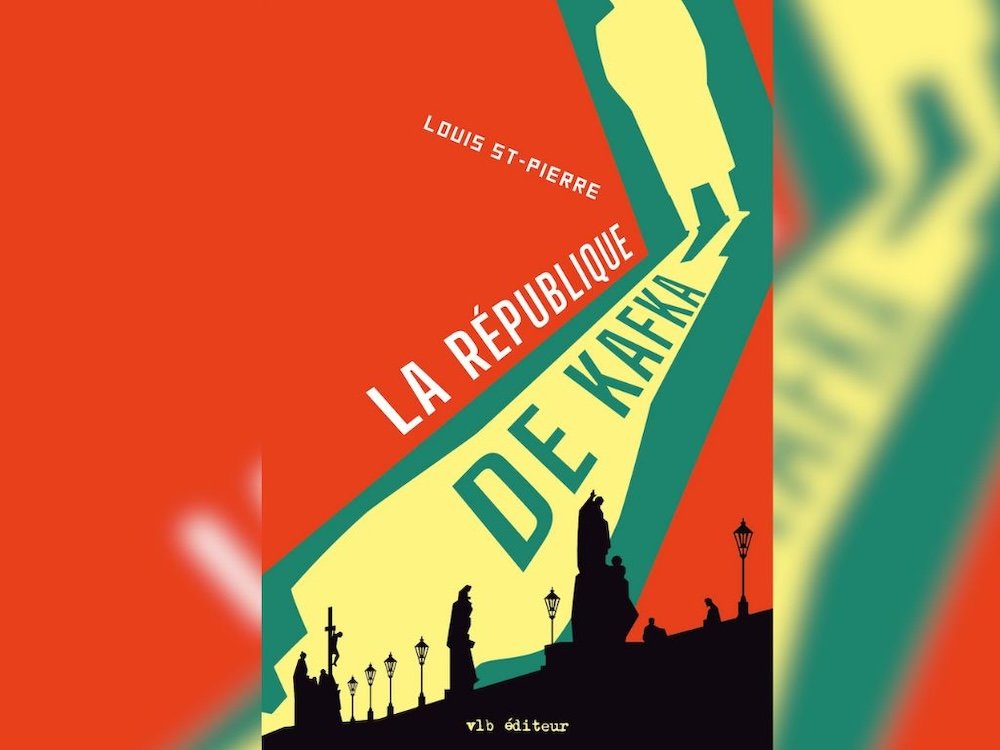« Il y a longtemps que je suis fasciné par La Corriveau. J’ai vu, à l’âge de onze ans, sur les ondes de Radio Canada, La Corriveau, une œuvre dramatique télévisuelle réalisée par Jean Salvy d’après la pièce de Guy Cloutier, avec Anne Dorval dans le rôle-titre. C’est à ce moment-là que j’ai découvert La Corriveau et que j’ai été marqué par elle (…). J’ai voulu, moi aussi, raconter son histoire, à ma façon.»
Ménard revisite l’histoire de La Corriveau qu’il considère comme une « femme mythique ». Son rêve a toujours été d’élucider ce qu’il considère comme une part de mystère planant sur cette femme que le monde avait choisi de nommer « sorcière ». On n’oubliera pas, dans ce penchant du poète, qu’il y a aussi son intérêt pour les laissés-pour-compte et autres marginaux de la société. Ménard a donc voulu redonner à cette figure féminine québécoise ses lettres de noblesse. Remettre en question l’histoire pour résister au classement afin de ne pas oublier : tel est le sens de Poupée de rouille. Résister pour restaurer la dignité et donner un autre sens à l’histoire. Montrer qu’à cette époque, la justice pouvait faire beaucoup de mal et développer un système d’injustice plutôt que de justice.
Ménard nomme la victime, La Corriveau, la Québécoise criminelle condamnée par une cour martiale britannique. La Corriveau pour lui est un être humain qui vient d’un milieu précis et qui porte une identité et qui a vécu une situation avec son deuxième époux qu’elle ne haïssait certainement pas. L’auteur pense que la peine a été trop dure et humiliante et qu’on n’aurait pas dû la mettre dans la cage réservée aux criminels.
On retrouve ici une part de l’histoire certes, mais il y a aussi l’autre part : la fictive.
Comme on le constate, l’histoire aide David Ménard à dénoncer ce qui existait en 1763, mais qui continue d’exister sous une autre forme dans la société actuelle à travers diverses sortes de traitement à l’endroit des humains.
255 ans ont passé et la force du récit demeure. La Corriveau c’est un souvenir qui est traduit de plusieurs manières. L’écrivain retourne la blessure cuisante de La Corriveau. Il en ressuscite la trace.
Le titre Poupée de rouille peut aussi porter à confusion. En effet, pour ma part le mot poupée m’a questionnée dès le départ. Il m’a fait penser à l’histoire d’une orpheline. Quand on l’a lu on comprend qu’il n’est pas, de prime abord, l’histoire que le lecteur curieux peut identifier.
Retenons d’emblée que l’auteur ne refait pas le procès de La Corriveau pour condamner les Britanniques. Il estime juste qu’on aurait pu comprendre son acte comme une volonté de l’amour voulant sauvegarder l’image de l’être aimé en pleine dégénérescence et le soustraire de toutes les humiliations possibles. L’intérêt, outre celui qui, littéraire, est certain compte tenu de la qualité de la langue et de la construction formelle de l’ouvrage relève de l’enchâssement des horizons convoqués. Celui que constitue cette « femme-mémoire », dont le temps de l’existence et le temps verbal se révèlent étrangement référencés à un passé élevé à une puissance quasi mythique, plus vrai que tout présent ; celui que constitue un pays habité par des esprits.
Revisité à la lumière d’un soleil contemporain fait des déclarations des droits humains et des chartes pour la dignité, des mouvements féministes, La Corriveau devient l’espace, non d’une réécriture, mais d’une métamorphose, celle d’une Marie-Josèphte devenant l’héroïne d’une histoire dont elle fut condamnée sans être écoutée. Certes, il s’agit toujours d’une femme qui a tué, et dont l’acte ne peut être justifié puisqu’il est question d’une vie qui est ôtée ; mais, si elle est condamnée c’est parce qu’elle a tué non pas parce qu’on ne l’aimait pas, mais parce que l’acte de tuer en soi n’est pas bon. Néanmoins, condamnée à mort, était-ce le sort réservé aux criminels qui devait lui être imposé ? Peut-être aurait-on dû écouter La Corriveau et comprendre la force de cet acte ?
La force de ce recueil, c’est, selon moi, de n’être ni une revanche ni une histoire de martyr. C’est une suite, une réponse historique, le pan de l’histoire du Québec, l’histoire de l’occupation britannique, le parcours de la femme dans l’histoire. Effectivement, Ménard n’est pas fâché avec l’histoire; il veut simplement montrer qu’on aurait dû faire montre d’une certaine empathie, de l’effacement de la victime, de « la nonchalance majestueuse » des Britanniques qui peuvent être vus comme des criminels, tout compte fait. Il opère en quelque sorte une mutation de l’illogique, la restauration enfin, et un après, un itinéraire de vie. De ce fait, Poupée de rouille devient comme la tentative de dire la dignité et l’amour au cœur de la justice au moyen d’un style précis pour faire ré-exister ce qui devait l’être.
En conclusio,n me vient cette pensée d’Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regarde sans rien faire ». David Ménard selon moi a accompli ce qu’il lui fallait accomplir pour restituer cette partie de l’histoire selon sa compréhension. Si Ménard ne refait pas le procès de La Corriveau, peut-on sous-entendre qu’il fait, indirectement, le procès de l’histoire?
Nathasha Pemba