Contexte et tonalité générale : l’art de l’entre-deux
La fatigue de la haine se déploie dans un registre profondément mélancolique et lucide, oscillant entre la célébration fragile de la beauté du monde et la prise de conscience douloureuse de ses dérèglements. Daniel Guénette s’inscrit délibérément dans une tradition élégiaque, où la beauté devient d’autant plus précieuse qu’elle est menacée. La haine évoquée dans le titre n’est pas fureur destructrice, mais fatigue morale, lassitude existentielle de vivre dans un monde déchiré.
La quatrième de couverture annonce déjà ce balancement fondamental : « la pensée du poète oscille entre la célébration et le désarroi ». Le recueil se situe dans une zone-limite, une crête fragile entre clarté et obscurité, comme à l’instant précis et suspendu du coucher du soleil. Cette position d’équilibriste confère au texte une tension poétique remarquable, évitant autant l’optimisme naïf que le pessimisme complaisamt.
Thèmes majeurs : cartographie d’une époque en déshérence
Le désarroi et la fin d’un monde
Un malaise existentiel profond traverse l’ensemble du recueil, face à un monde qui s’effondre doucement, presque imperceptiblement. Cette conscience de la fin s’exprime par des images d’extinction ou de fragilité ultime :
« Combien de châteaux de sable vais-je encore élever / Avant que ne s’abatte sur moi un dernier rayon de soleil »
« Des instants […] sur leur socle aujourd’hui de plus en plus vacillent »
Ces vers révèlent un poète lucide, presque désabusé, face à la fragilité des bonheurs humains et aux menaces qui pèsent sur l’avenir. Cette tonalité rappelle celle des grands élégiaques contemporains comme Philippe Jaccottet ou André du Bouchet, mais avec une spécificité : chez Guénette, la mélancolie n’est jamais pure contemplation, elle reste habitée par une interrogation morale sur l’état du monde.
La beauté du monde et la célébration fragile
Malgré la noirceur ambiante, persiste une lueur d’émerveillement : la lune, une biche, la surface d’un étang, les rires des amants… Cette persistance de la beauté relève d’une forme de résistance poétique : continuer à voir malgré tout, maintenir l’exigence esthétique contre la barbarie ordinaire.
Cette beauté demeure cependant éphémère : le temps la menace sans cesse, lui conférant cette urgence particulière que connaissent les grands lyriques. On retrouve ici un écho de la tradition romantique, mais épurée de tout sentimentalisme : l’émotion naît de la justesse de l’observation, non de l’épanchement du moi.
La haine et l’éveil des consciences
Le titre trouve sa justification dans certains passages qui parlent directement de désillusion politique ou éducative. Il y a là une attente historiquement déçue, particulièrement visible dans le poème « UN PAPIER » :
« Nous pensions que la clarté devait émaner, / jaillir des fenêtres enfin ouvertes / des petites et grandes écoles »
Les maîtres, symboles d’espoir démocratique, sont devenus impuissants face aux forces de régression. Cette critique de l’institution éducative s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’échec des Lumières contemporaines. Le poète appelle à un réveil des consciences, à réenchanter un monde intellectuel devenu stérile.
Cette dimension politique, jamais explicite, traverse le recueil en filigrane, donnant à la mélancolie une portée collective qui dépasse la simple introspection lyrique.
La nature comme miroir de l’âme
La nature occupe une place centrale, souvent en miroir du ressenti intérieur du poète :
« À l’orée du bois, une biche / lasse d’avoir épuisé tout son temps »
La biche devient ici symbole du poète lui-même, fatigué et en marge, témoin silencieux d’un monde qui s’épuise. L’usage récurrent des éléments naturels (lune, étang, feuillages) donne au recueil une dimension presque sacrée, en contraste saisissant avec la noirceur du monde humain.
Cette sacralité de la nature n’est pas panthéisme facile, mais reconnaissance d’une permanence qui résiste à la destruction historique. Elle offre un refuge contemplatif sans pour autant constituer une évasion hors du monde.
Style et langage poétique : la musique du murmure
Le style de Daniel Guénette se caractérise par sa fluidité lyrique et l’absence de ponctuation rigide dans certains poèmes. Cette liberté formelle crée une sensation de murmure continu, de réflexion intérieure qui se déploie sans contrainte apparente. L’écriture évoque celle de contemporains comme James Sacré ou Gérard Macé, avec cette même recherche d’une oralité poétique authentique.
L’image poétique reste métaphorique mais accessible : l’auteur évite délibérément l’obscurité gratuite, privilégiant la justesse de l’émotion sur la virtuosité formelle. Cette accessibilité n’est jamais simplisme : elle procède d’une épuration, d’une recherche de l’essentiel.
L’alternance constante entre le concret et le symbolique donne aux textes une double lecture, immédiate et méditative :
« Les soifs engendreraient pareillement nos songes »
Cette image, à la fois onirique et presque mystique, révèle comment le manque devient moteur de pensée poétique. La soif, physique et métaphysique, génère le songe qui la transcende.
Lecture globale : élégie contemporaine et espoir ténu
Ce recueil peut se lire comme une élégie contemporaine au sens le plus noble du terme. Il porte le deuil d’un monde sans renoncer totalement à l’espoir. Daniel Guénette observe, conscient de l’échec des idéaux passés, tout en continuant à chanter la beauté éphémère des choses et des êtres.
Le titre résume parfaitement cet état de tension : La fatigue de la haine – comme si la haine, par sa persistance historique, devenait elle-même épuisante, banale, mais aussi insoutenable pour qui conserve une exigence éthique. Le poète ne prêche pas la révolte spectaculaire, mais propose un réveil doux, une prise de conscience lucide, presque spirituelle dans sa discrétion.
Cette approche rejoint celle de poètes comme Yves Bonnefoy ou Philippe Jaccottet, avec lesquels Guénette partage cette capacité à transformer la mélancolie en force de résistance poétique. La beauté devient acte de résistance contre la médiocrité ambiante.
Refuge et éveil
Daniel Guénette signe avec La fatigue de la haine un recueil mélancolique et lucide, mais jamais désespéré. Il met en lumière la beauté menacée, dénonce les idéaux trahis, et appelle à ressentir plus profondément, à penser au-delà de l’amertume stérile.
Ce texte s’adresse autant à la sensibilité qu’à la réflexion, touchant ceux qui perçoivent que « tout semble sur le point de basculer », mais veulent encore croire à la poésie comme refuge et éveil. Il trouve sa place dans le paysage poétique contemporain aux côtés d’œuvres qui refusent autant la facilité du désenchantement que celle de l’optimisme volontariste.
La force de ce recueil réside dans sa capacité à maintenir vivante une exigence de beauté et de vérité, même – et surtout – quand le monde semble y avoir renoncé. En cela, il accomplit pleinement la fonction première de la poésie : témoigner de ce qui, en l’homme, résiste à sa propre destruction.
Heidi Provencher

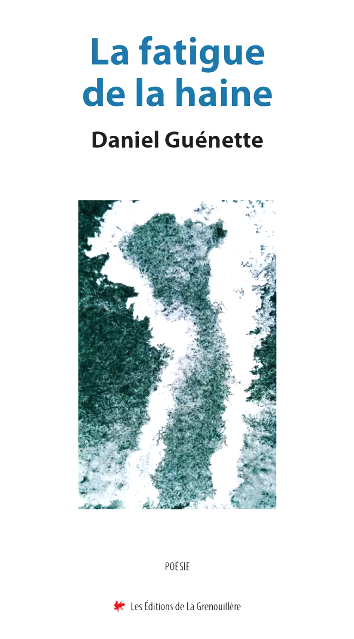
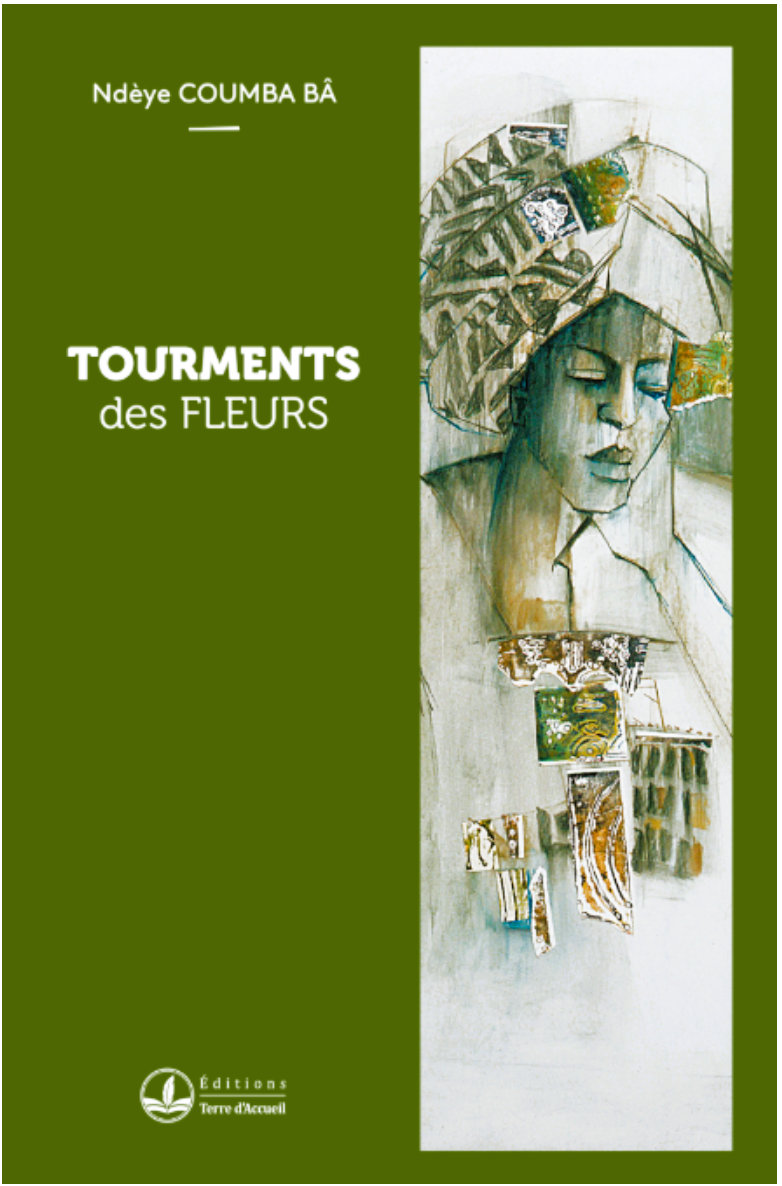
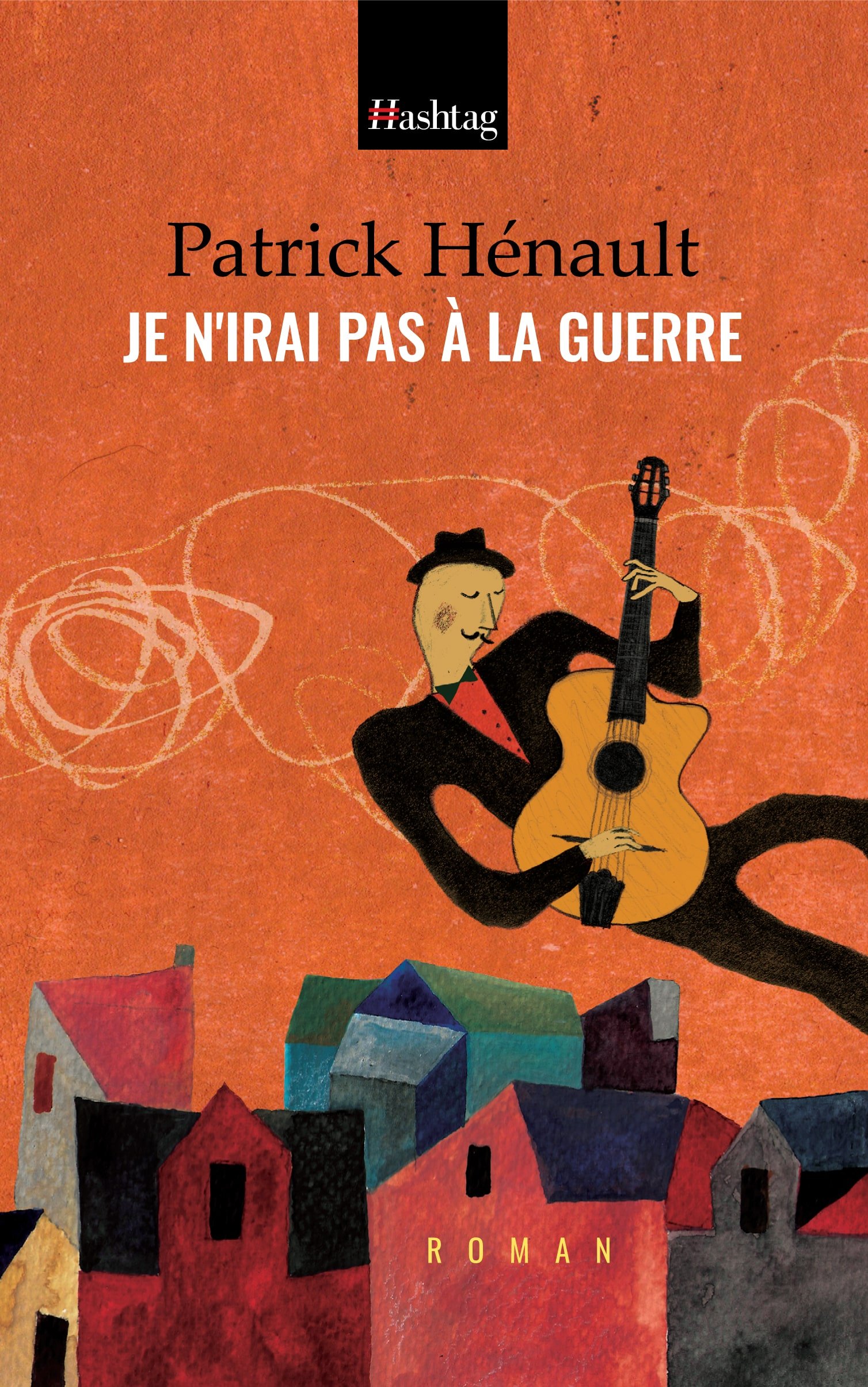
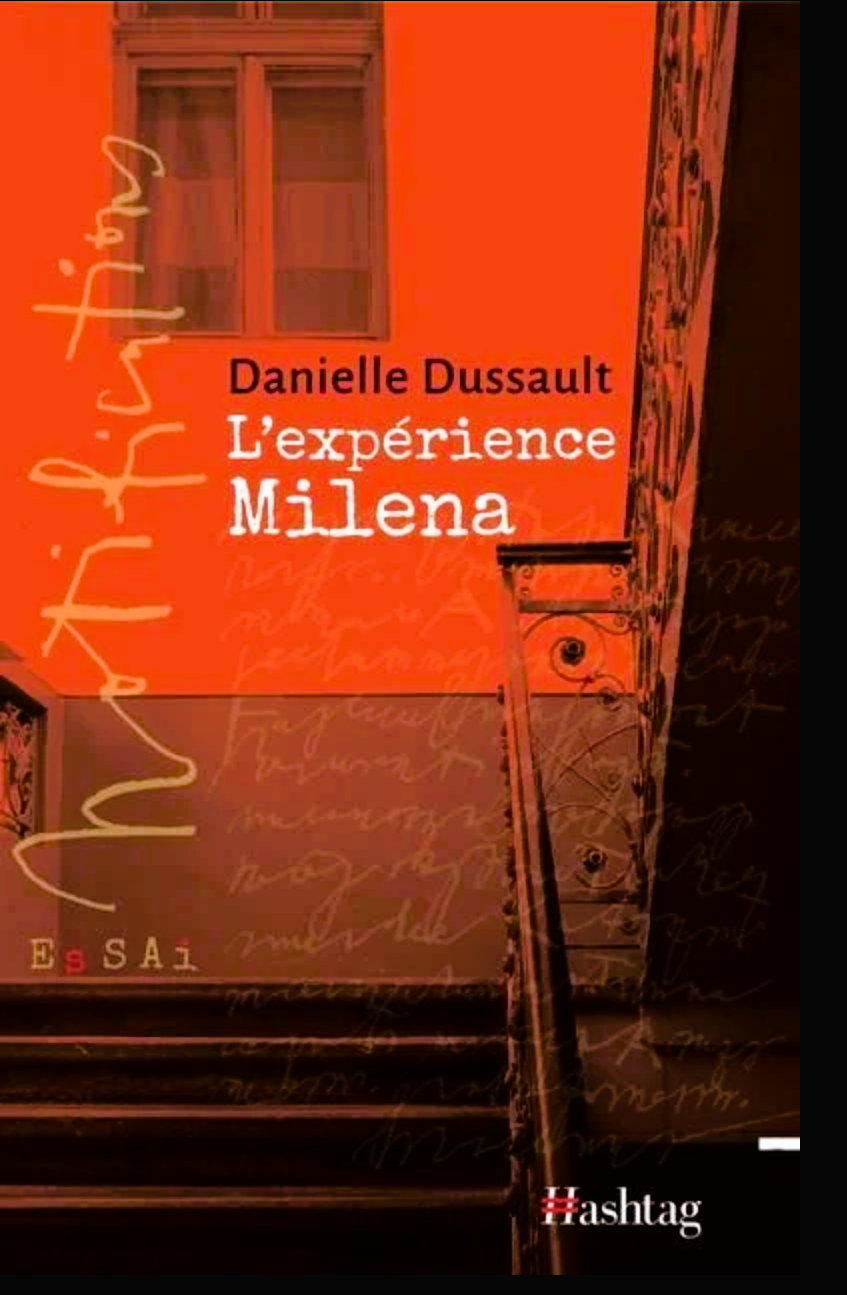
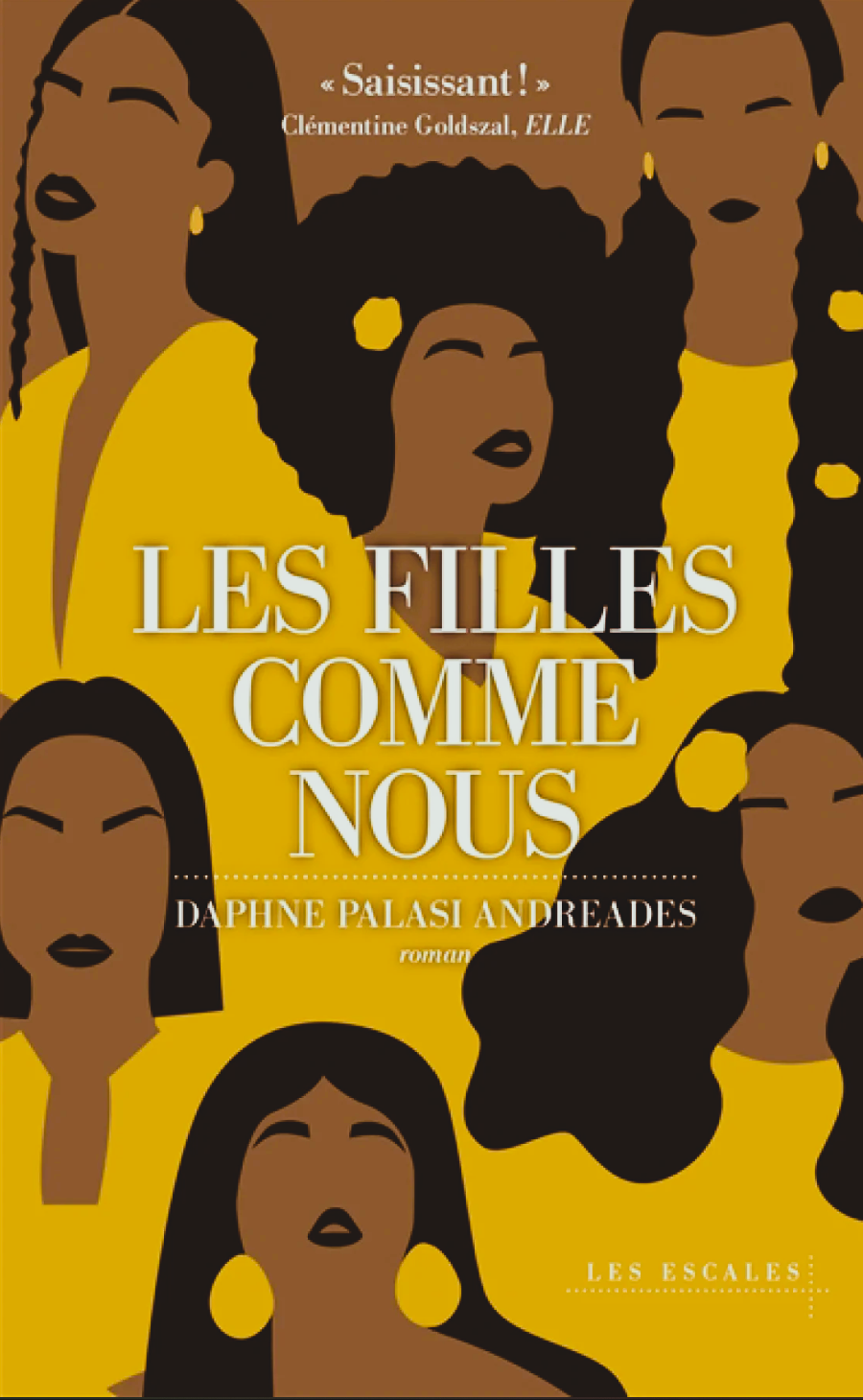




2 commentaires
Certains jours réservent de belles surprises. On marche rêveusement le long d’une plage imaginaire, ne se souvenant presque plus de la bouteille qu’on avait jetée à la mer à une époque qui semble bien lointaine. Elle contenait des poèmes. Certains jours réservent d’agréables surprises. Oui, puisqu’au retour de la marée se fait entendre un merveilleux écho des mots que l’on avait enclos dans un ouvrage de poésie. Quand un recueil se voit ainsi rescapé par un lecteur, ici une lectrice qui prend la peine de lui consacrer une note bienveillante de lecture, en ce jour où l’on découvre ses commentaires, vraiment on se dit que la vie nous réserve parfois de très agréables surprises.
Un grand merci au magazine Ou’Tam’Si Mag, à sa directrice Nathasha Pemba, à son équipe et, finalement, à Heidi Provencher qui signe ici un article fin, attentif et généreux.
Merci ! Daniel