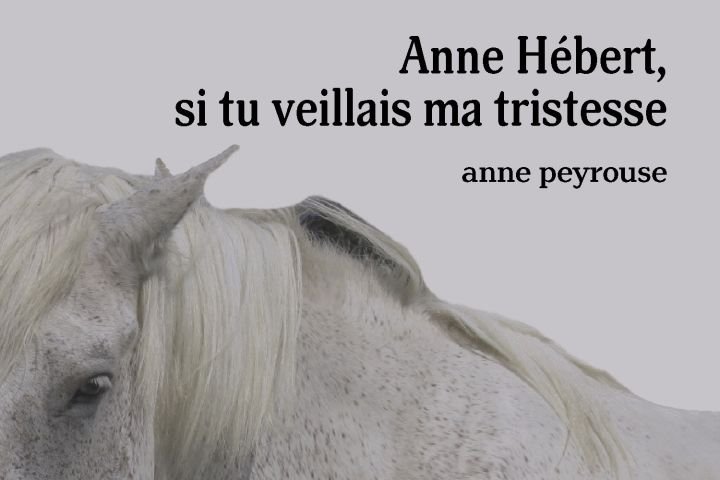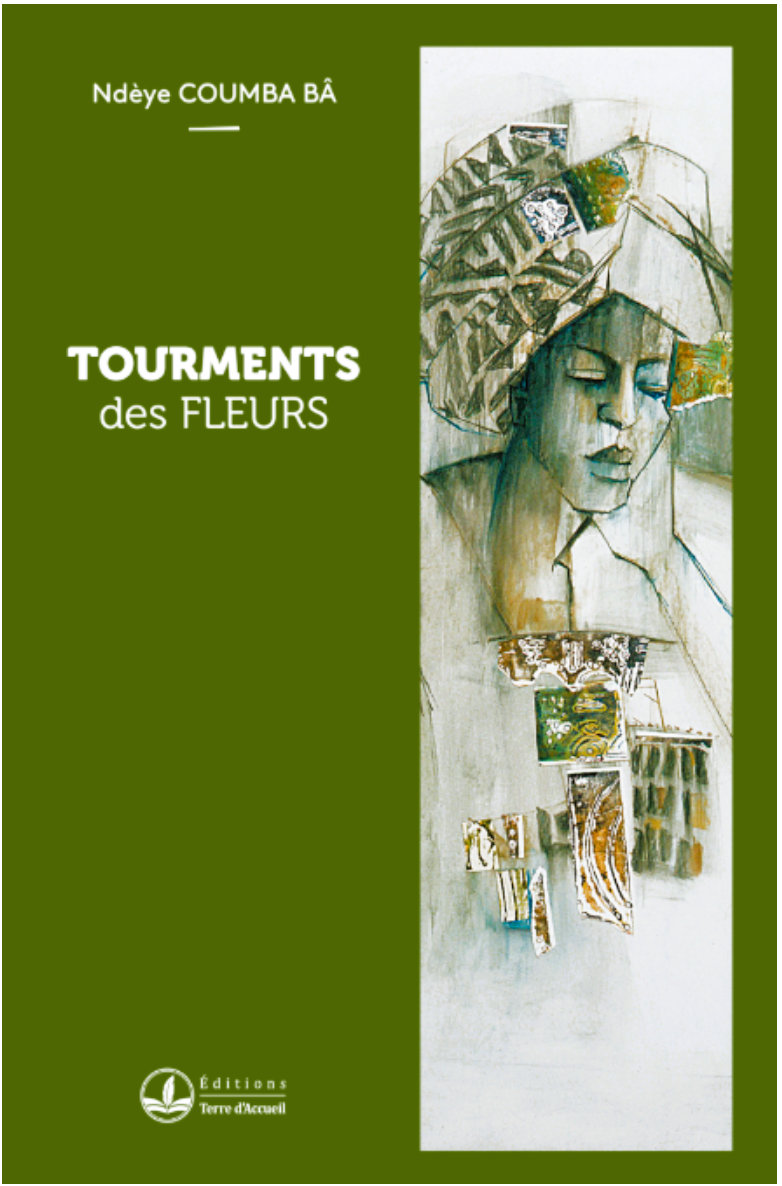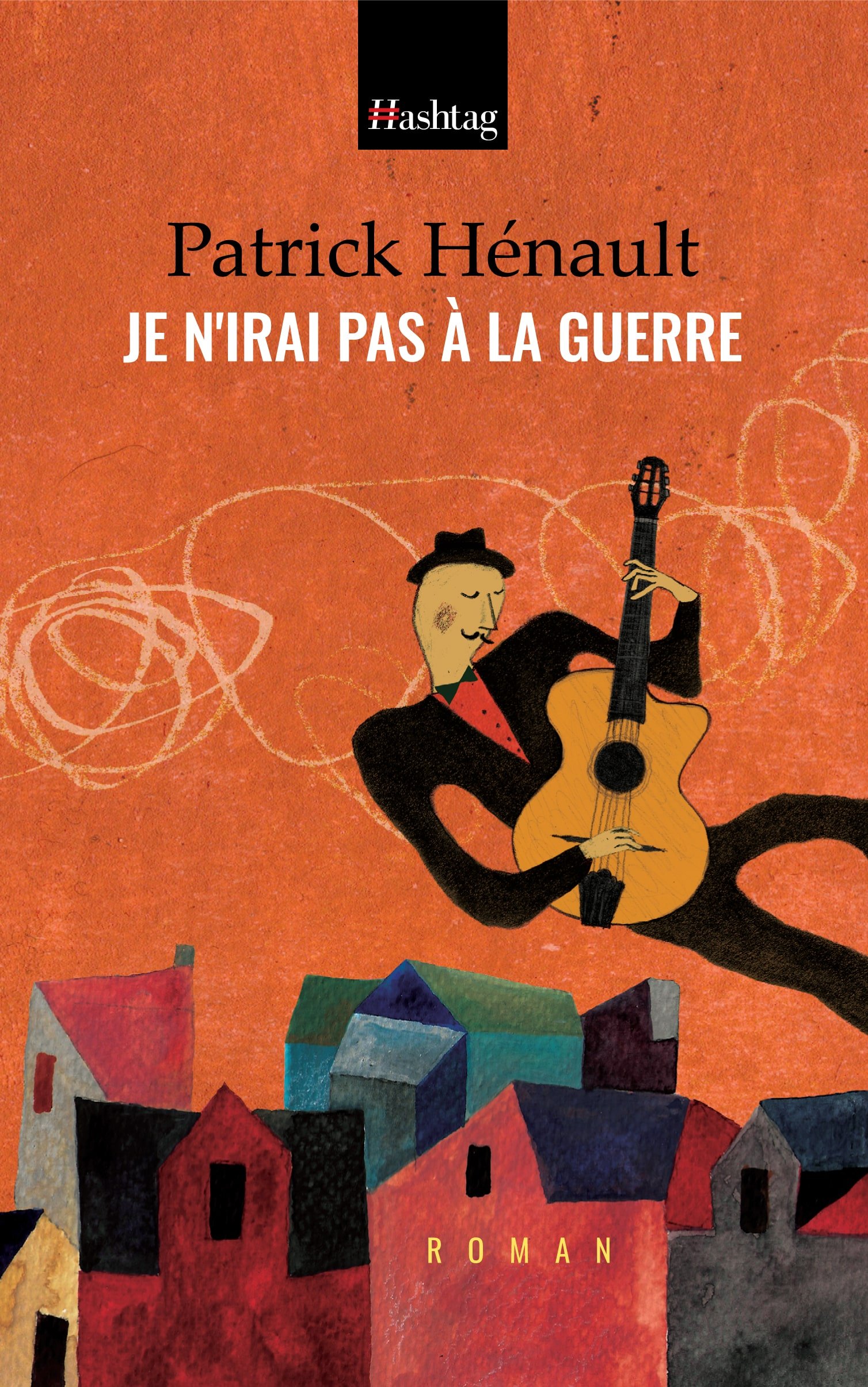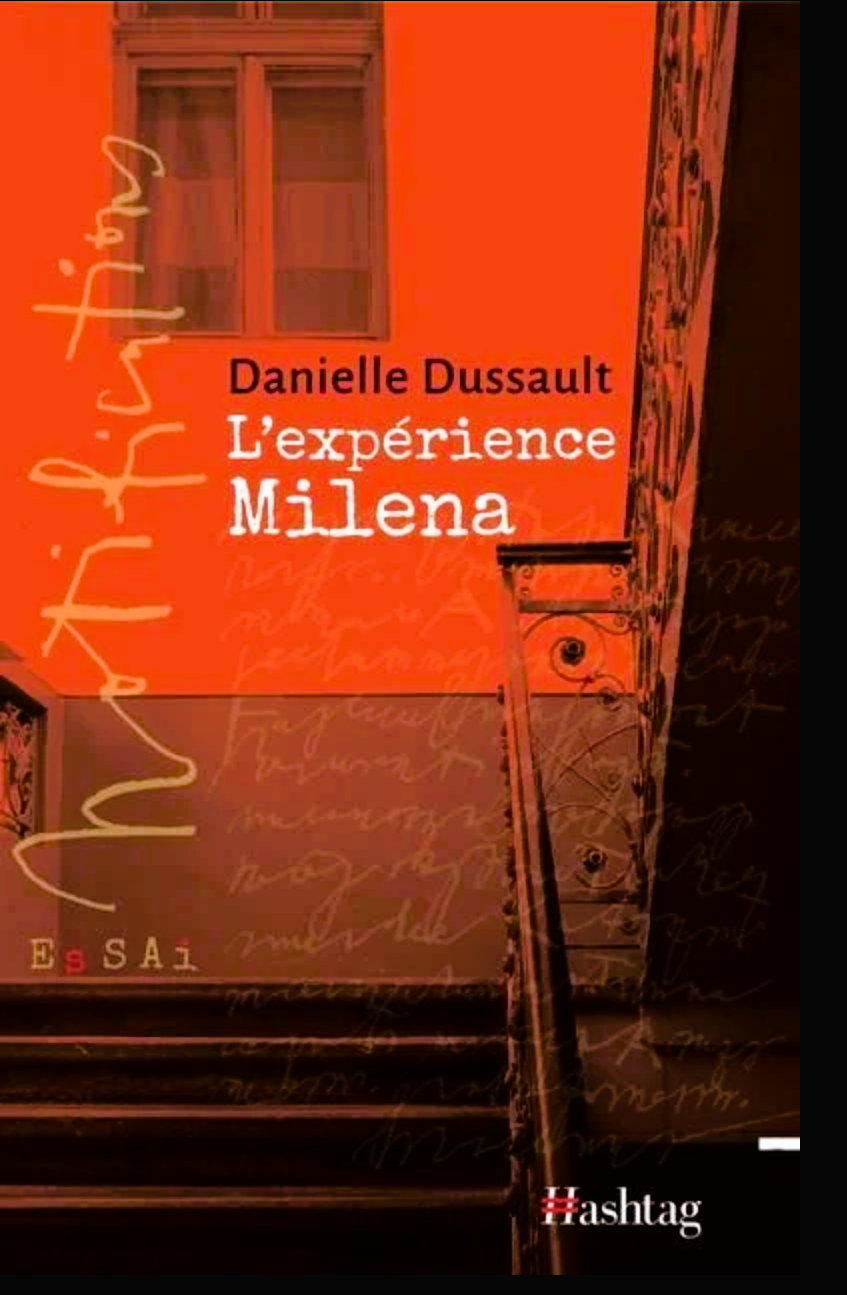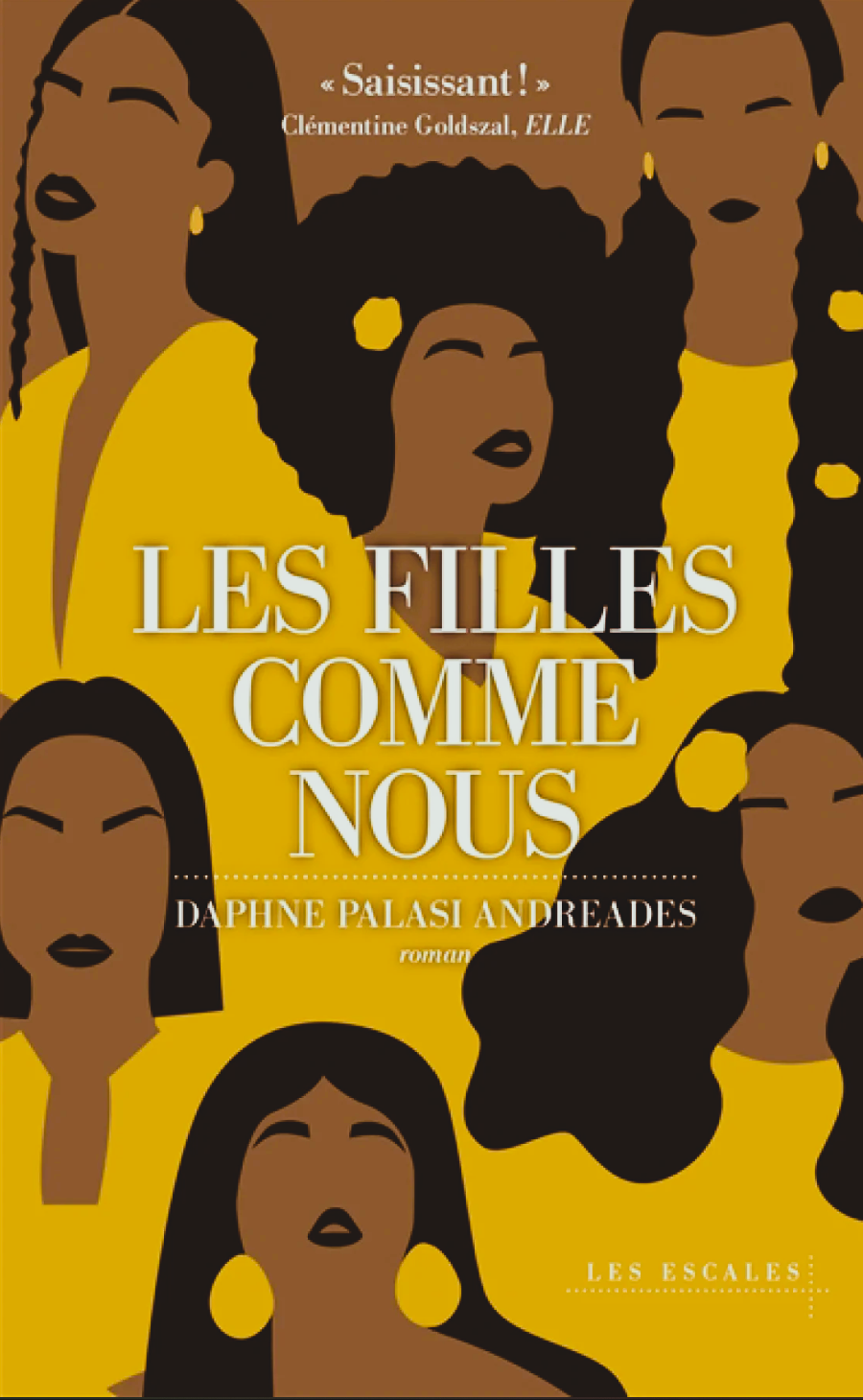Quand les mères deviennent des livres : une dérive entre deux rives
Je me souviens du jour où j’ai ouvert Anne Hébert, si tu veillais ma tristesse. Ce n’était pas un jour ordinaire, les livres qui parlent des morts ne se lisent jamais les jours ordinaires. On les lit en silence, en dedans, là où la tristesse a déjà bâti ses quartiers.
J’étais dans l’autocar en route pour mes recherches sur les femmes, les pionnières. Dès la première page, j’ai eu l’impression qu’Anne Peyrouse était avec nous, assise quelque part au fond peut-être, ou bien juste à mes côtés. Elle semblait là avec ses deux mères : Nicole Derail (la chair, le sang, le silence) et Anne Hébert (la phrase, la blancheur étale, la fiction). Je me suis laissée glisser dans cette triade troublante, flottante, presque mystique.
Des questions ont émergé : peut-on écrire pour nos morts ? Comment hérite-t-on d’un·e écrivain·e comme d’un parent ? Et si, comme chez Peyrouse, l’hybridité n’était pas une posture, mais un deuil en forme de style ?
Écrire la mort, réécrire la mère
Anne Peyrouse écrit dans les cicatrices. C’est une littérature de la plaie, du manque. En la lisant, j’ai cru entrevoir qu’elle ne panse pas, elle expose. Sa mère, Nicole, est retrouvée morte, le corps découvert, mais l’histoire non conclue. Il n’y a pas de fin, il n’y a que du continu : la douleur coule, se prolonge, se propage dans les lignes.
« Écrire, c’est malmener la mort », dit-elle. C’est aussi la transgresser. C’est se venger d’elle.
Cette phrase me rappelle Marguerite Duras dans La douleur : elle aussi écrivait sur l’attente, sur l’absence, sur les corps qu’on ne retrouve pas. Mais chez Peyrouse, la douleur devient dialogue. Elle incarne Anne Hébert comme une figure-mère secondaire, une marraine de la peine. C’est un jeu de filiation littéraire qui dépasse les siècles et la mort.
Entre mère originelle et mère originale : une double matrice
Il y a dans ce livre un battement binaire et intime qui structure tout : deux mères qui ne se contredisent pas, mais se superposent, s’entrelacent comme des lignes d’écriture en palimpseste.
La mère originelle : Nicole Derail, chair et sang
Nicole est celle qui a donné le corps, le souffle, les souvenirs de la Camargue, les racines biologiques et géographiques. Mais elle est aussi la mère perdue, découverte sans vie dans un silence pandémique, brutal, impossible à décoder. Quand Nicole meurt, ce n’est pas seulement une personne qui disparaît : c’est une origine qui s’effondre.
« Je brandis le prénom de ma mère dans des propositions d’échanges en vain… » (p. 13)
Ici, Nicole devient une monnaie de deuil, un nom qu’on essaie d’échanger contre un peu de présence. Mais le marché est fermé. La perte est irrémédiable. Reste le langage.
La mère originale : Anne Hébert, fiction et filiation littéraire
Face à la perte de Nicole, l’autre mère s’impose : Anne Hébert. Elle n’est pas née de la chair, mais de la lecture. Elle n’a pas porté l’autrice, mais elle l’a élevée dans la langue. Hébert n’est pas seulement un modèle littéraire ; elle est une incarnation. Peyrouse parle d’elle comme d’un corps :
« J’aimerais être ta complice. Que tu m’adoptes. Carrément. Pourtant, j’ai une maman. Tu serais une autre mère. Tu es une autre mère. Une autre Anne. »
C’est là que la distinction prend tout son sens : Nicole fait naître le corps, Anne fait naître l’écriture. L’une ancre, l’autre élève. L’une rappelle le passé, l’autre ouvre l’avenir.
Une hybridité comme archipel
Il y a dans ce livre un courant sous-jacent : celui de l’hybridité. Pas seulement entre les genres, prose et poésie, mais entre les mondes. C’est un livre-fracture, un texte-faille où cohabitent la Camargue de Nicole et les brumes de l’écriture d’Hébert, le Québec et la France, le réel et la fiction, le corps et le texte.
Cette façon de tresser plusieurs voix dans une même page me rappelle Édouard Glissant et sa notion de « relation ». Comme lui, Peyrouse ne cherche pas l’origine pure, mais le mouvement : elle vit dans la multiplicité, dans les racines entremêlées. C’est ce que Glissant appelait « le droit à l’opacité » : ne pas tout expliquer, juste coexister dans la complexité.
Cette bi-maternité refuse le deuil classique. Elle crée un deuil dialogique, où les mortes parlent encore, lisent encore, veillent encore :
« Nicole, tu flottes dans ce livre en état d’être et de non-être. Anne Hébert, aussi. » (p. 115)
Une littérature-monde, une littérature-mère
À la fin, j’ai compris : ce n’est pas seulement un hommage à une mère ou à une écrivaine, c’est une vision politique de la littérature. Une utopie. Page 43, Peyrouse écrit :
« Les manuscrits deviendront nos vêtements amples à porter et à tournoyer… Nous ne traverserons pas la vie mais les mots. »
C’est une déclaration d’amour à la littérature, mais aussi un manifeste. Comme Hélène Cixous, Peyrouse croit en la force féminine de l’écriture : un pouvoir de transformation, de soin, de résistance. C’est un matriarcat littéraire, un monde où la mère ne meurt jamais vraiment, parce qu’on la prolonge par l’écriture.
Ce livre n’est pas « terminé » comme on termine un roman. Il continue de résonner après la dernière page. Parce qu’on comprend, au fond, que nous aussi, nous avons des mères doubles — celles de la chair, et celles des mots.
Et qu’un jour peut-être, nous écrirons aussi : « Tu es une autre mère. Une autre Anne. »
Nathasha Pemba