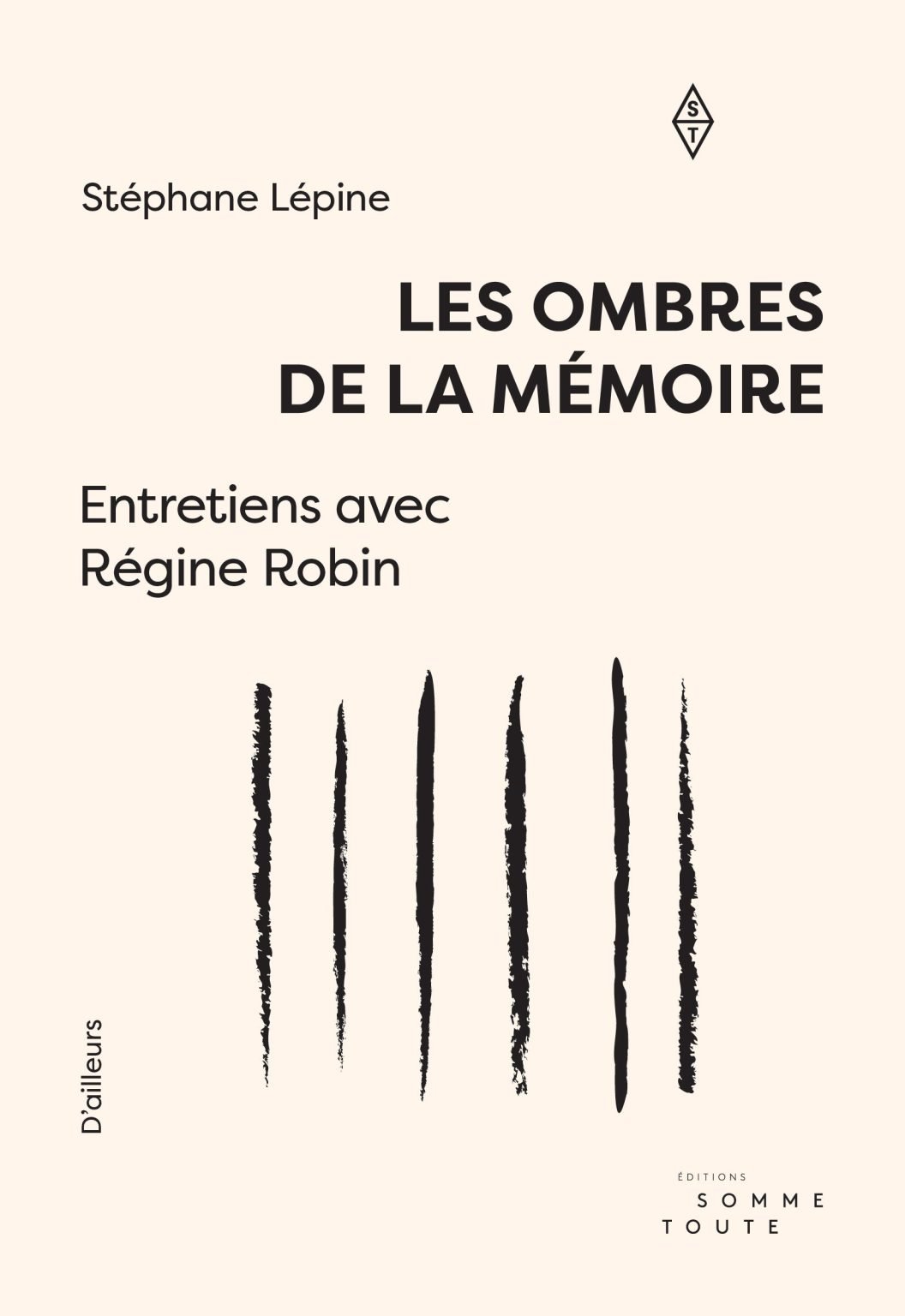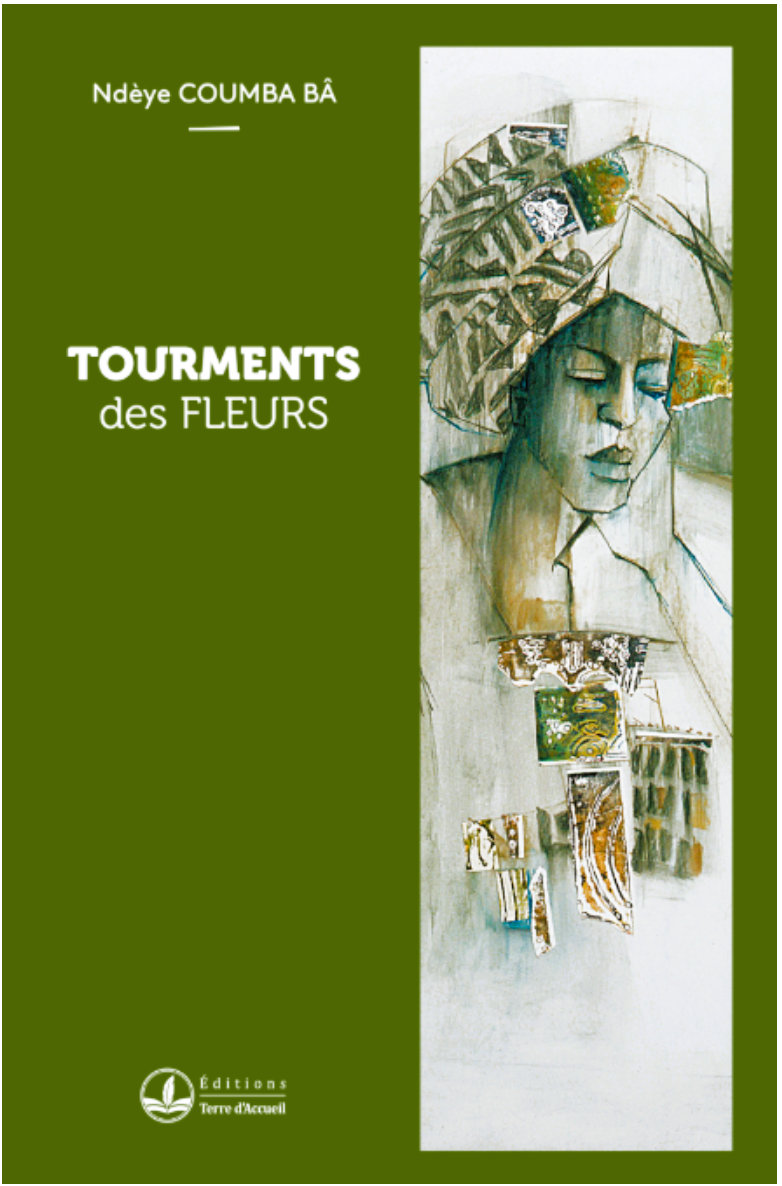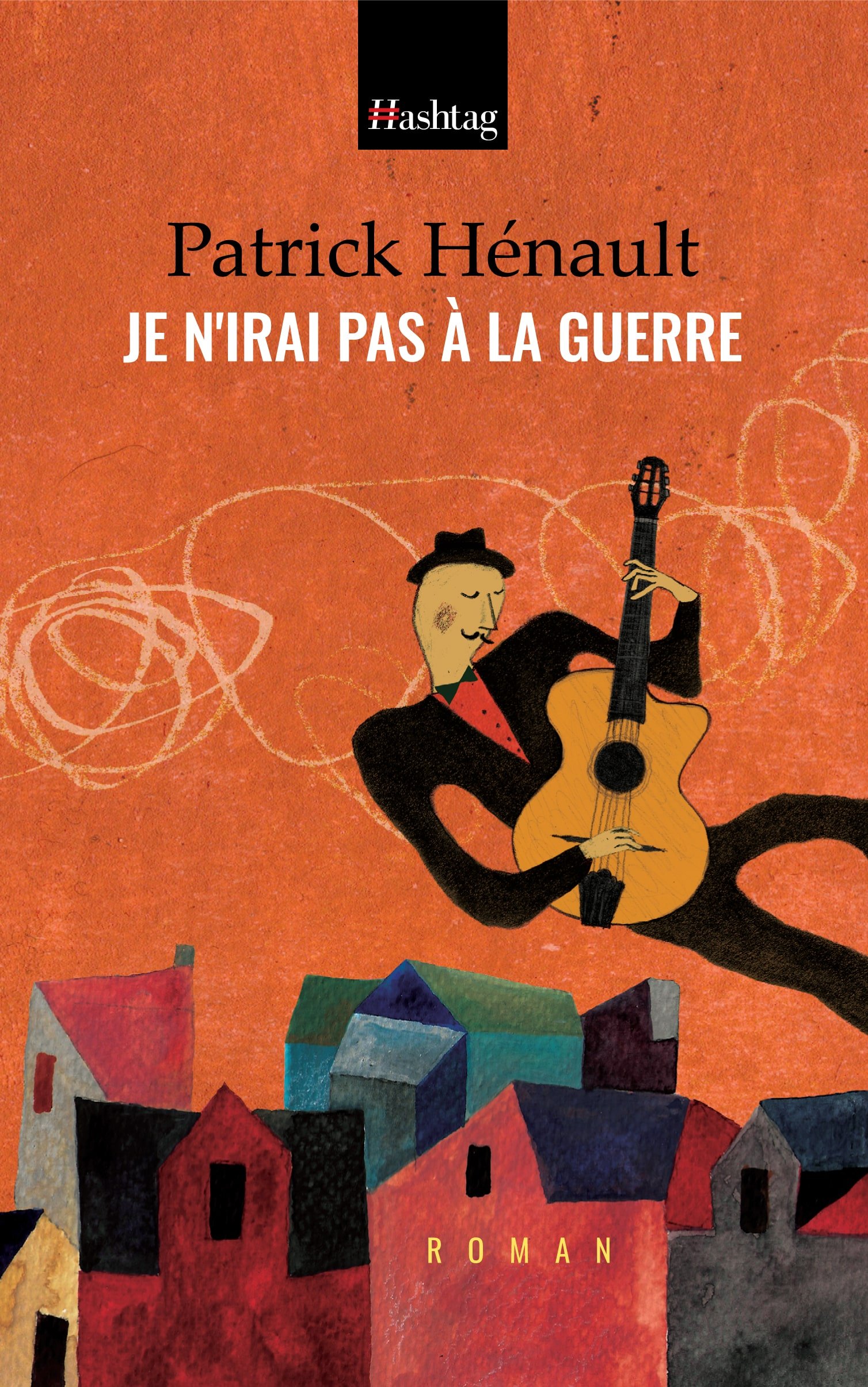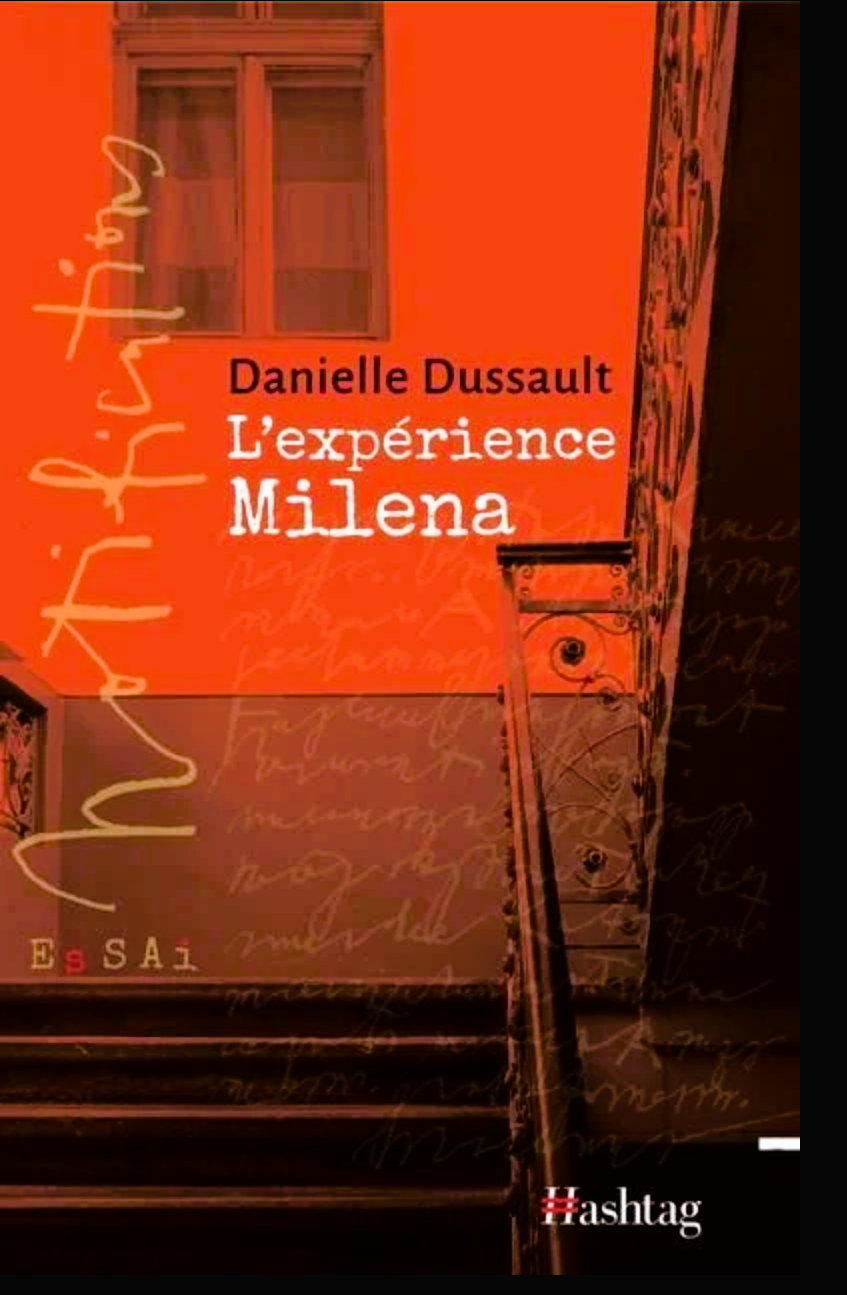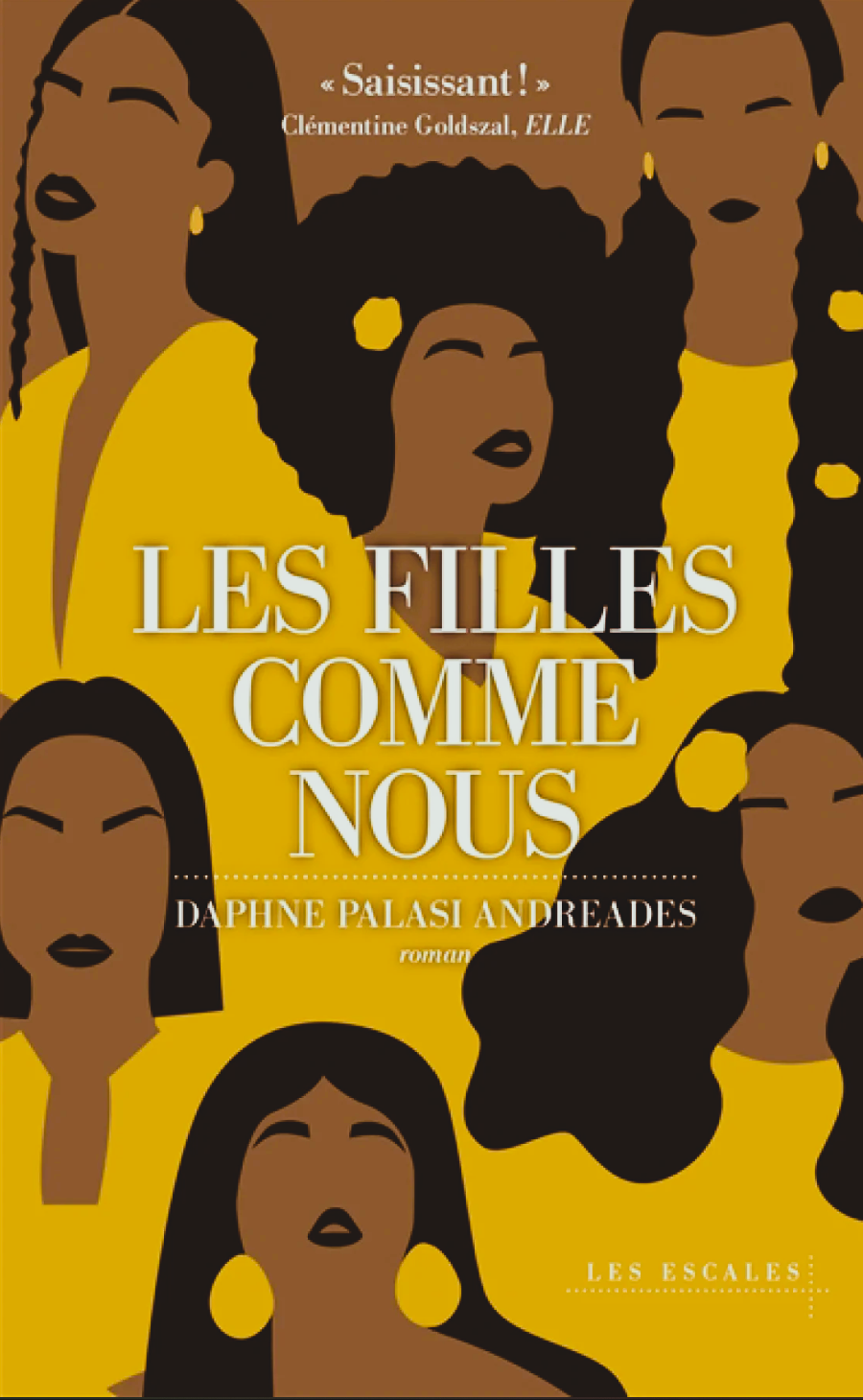Il y a des voix qui, même lorsqu’elles parlent doucement, laissent un écho tenace. Régine Robin était de celles-là. Pourquoi encore des entretiens, quand une bonne partie de ses livres portait déjà la marque de l’autobiographie ? Parce qu’ici, dans l’échange direct, sans la médiation du roman ou de l’essai théorique, Robin se déploie autrement : en archéologue de sa propre pensée, en témoin d’un parcours intellectuel qui traverse les frontières sans jamais s’y fixer.
Née ailleurs, façonnée par la diaspora, habitant tour à tour Paris, Montréal et le vaste monde, Robin cultive cette position d’extériorité comme un laboratoire d’idées. Son rapport au territoire, à l’identité et au langage ne cherche pas le refuge d’un enracinement, mais habite l’espace mouvant de la perpétuelle interrogation.
Ce livre révèle aussi une bibliothèque intérieure foisonnante où les références se télescopent : littérature, histoire, sociologie, mémoire juive, cultures urbaines. Montréal devient un motif central, une ville « multiple, bigarrée, hétéroclite », miroir de l’esprit de Robin, à la fois ancré et vagabond.
La force de ces entretiens réside dans leur capacité à éclairer le « discours de l’exil » sans le figer. Robin y évoque la langue comme une tension permanente : le français comme ancrage, mais toujours hanté par « l’impossibilité d’une langue autre » qui viendrait lui répondre. Cette fracture intime devient un moteur de pensée, une ressource critique pour interroger le récit national et ses exclusions.
Les ombres de la mémoire n’est pas seulement un hommage posthume. C’est un dialogue vivant avec une intellectuelle qui n’a cessé de questionner les certitudes, de scruter les marges pour comprendre le centre. On referme le livre avec le sentiment qu’il ne s’agit pas d’un adieu, mais d’une conversation suspendue — à reprendre, encore et encore.
Nathasha Pemba