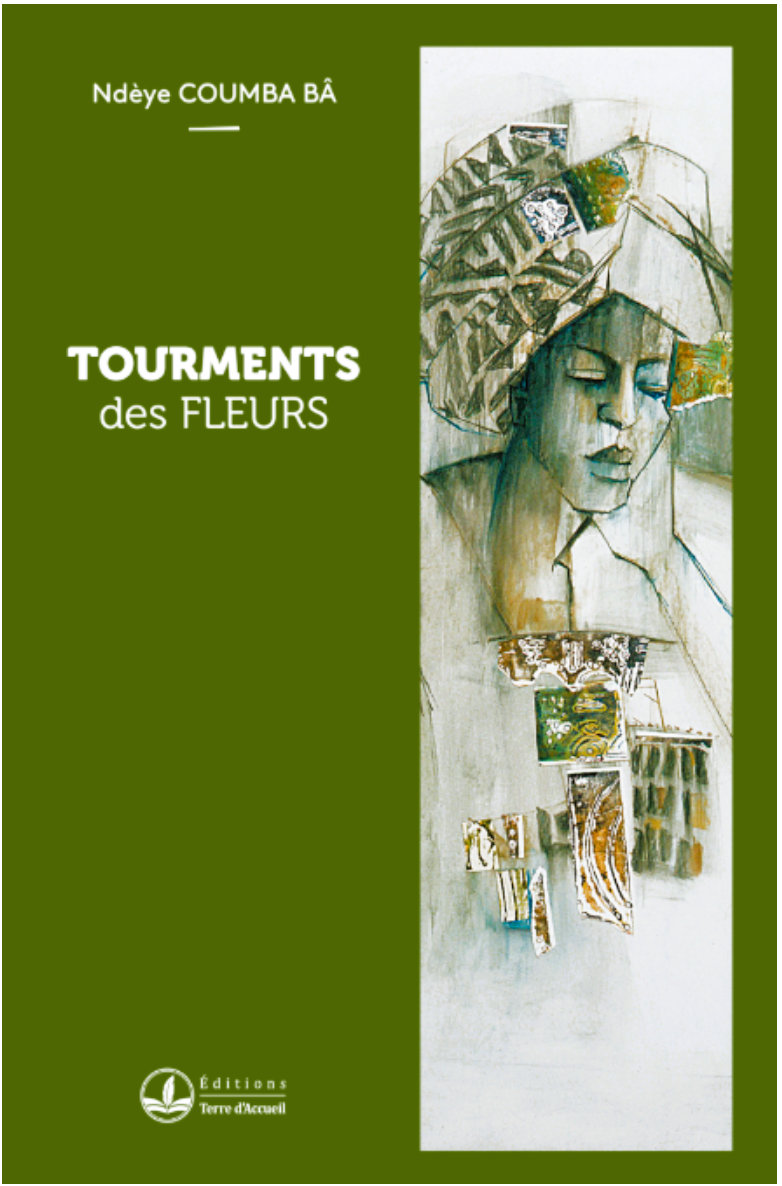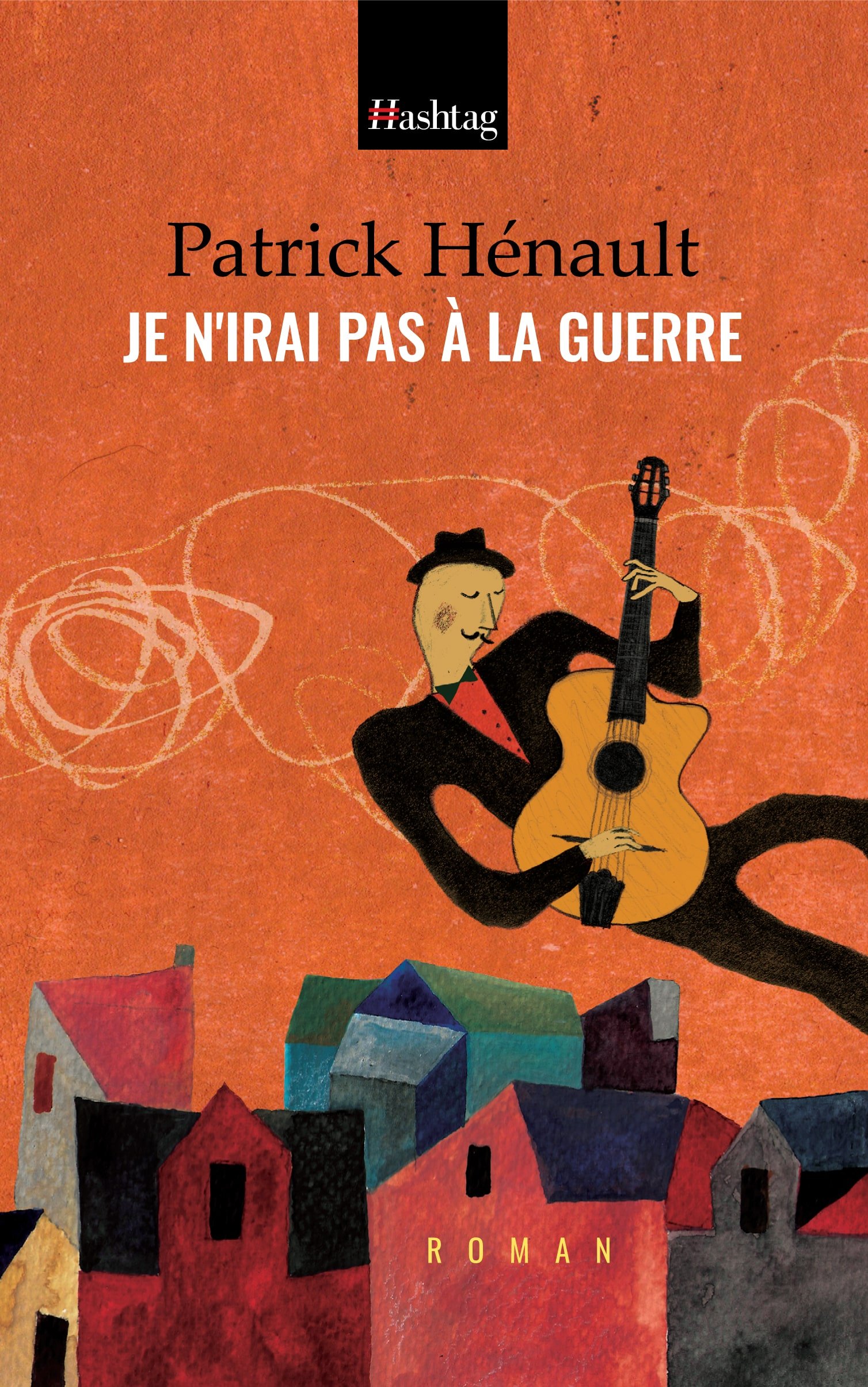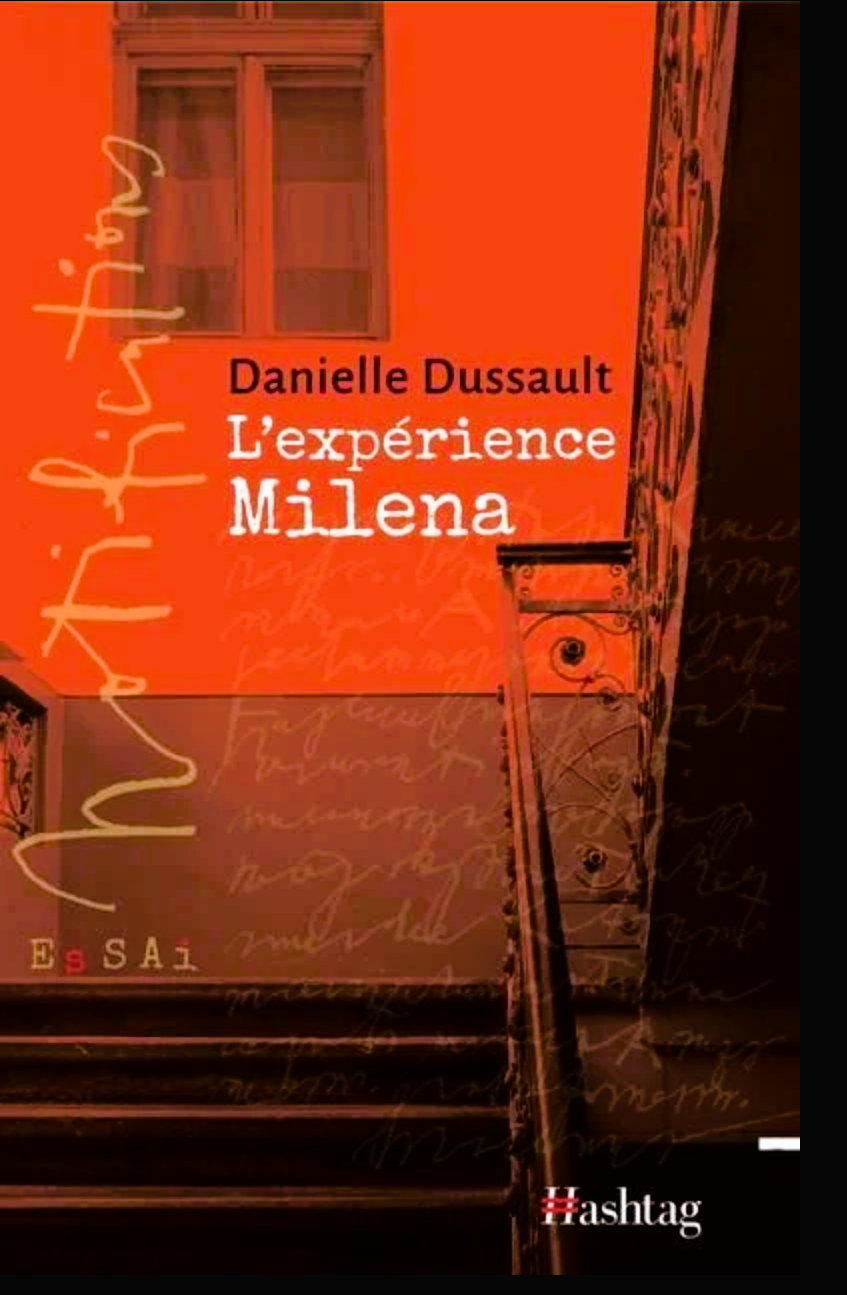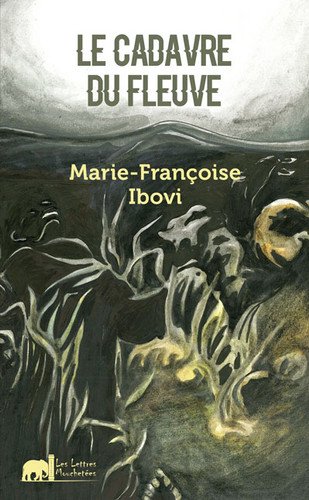Mémoire en flammes, amour en cendres
Le roman s’ouvre dans un monde déjà en ruine. Lulu et Salif, deux enfants rescapés, fuient les flammes d’un massacre. Dans leurs bras, les cendres de leurs proches. Leur objectif : rejoindre la hutte des ancêtres, lieu sacré et redouté, gardien de la mémoire. Ce geste inaugural, sacrilège pour certains, salvateur pour eux, signe le refus de l’oubli. Il me rappelle ce passage du Deutéronome 13,14 : « Alors, demain, quand ton fils te demandera : « Que fais-tu là ? », tu lui répondras : « C’est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte, la maison d’esclavage » ». Comme ce passage du Deutéronome, le livre de Sezibera s’inscrit dans cette tension : transmettre sans haïr, se souvenir sans se laisser emprisonner par la haine. Il transmet non seulement un récit historique, mais aussi une mémoire collective essentielle à l’identité du peuple. Le souvenir du génocide ne se limite pas à un fait passé : il est réactivé dans le présent à travers le rituel, pour qu’il vive dans la conscience des générations futures.
La cité de Kali, monde parallèle dans lequel se sont projetés Lulu et Salif, devient le théâtre d’une quête spirituelle, à la fois intérieure et collective. Ils devront y affronter Kali, déesse hindoue de la destruction et de l’illusion, incarnation d’une mémoire figée dans la peur et la violence. Le choix de cette figure n’est pas anodin : elle porte le temps, le changement, mais aussi l’effroi.
Le vrai voyage est cependant ailleurs. Ce que traversent Lulu et Salif, c’est une expérience radicale du mal, un monde où les repères moraux se sont effondrés, où l’humanité semble avoir déserté les corps comme les esprits. Et pourtant, c’est dans cet enfer que surgit l’interrogation la plus humaine : est-il encore possible d’aimer ?
Le corps des femmes, champ de guerre et de sacrifice
Dès les premières pages, le roman frappe fort. Je suis touchée par cette image : une femme s’interpose entre sa fille et le soldat venu violer cette dernière. Elle se donne à sa place, se sacrifie dans un acte d’amour absolu et tragique. Le soldat est bouleversé : « Tu es une bonne mère. Si j’avais eu une mère comme toi, peut-être que je serais devenu un autre homme. »
Pour moi, ce geste constitue l’un des sommets éthiques du roman. L’amour maternel y devient résistance, ultime rempart contre la barbarie. Il me fait penser aux mots du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui depuis des années « répare les femmes » victimes de violences sexuelles dans l’est de la République Démocratique du Congo. Mukwege affirme que dans ces corps martyrisés réside une mémoire du monde, que violer une femme, c’est tenter d’anéantir un peuple. Le roman, de son côté, met en scène cette réalité, mais va plus loin : il fait du corps une frontière entre la haine et l’humanité, entre la mécanique de la guerre et l’éthique du soin.
Le récit ne s’enferme pas dans une représentation univoque du bourreau. Le soldat-agresseur confesse, dans une scène bouleversante, l’enfer de son enfance, sa quête désespérée d’amour :
« J’ai cherché l’amour de ma mère au travers de tant de femmes, mais même les plus belles n’ont jamais été à la hauteur… Je me suis mis à les haïr. »
L’échec de l’appel éthique
Mais le soldat, malgré l’émotion, viole quand même. Non par plaisir, mais par habitude, par automatisme, comme si son corps n’était plus relié à sa conscience. Cette scène déchirante pose une question vertigineuse : qu’est-ce qu’un homme qui sait ce qu’il fait, mais le fait quand même ? Que reste-t-il de l’éthique lorsqu’on a désappris à ressentir ?
Le roman dialogue ici avec Emmanuel Lévinas, pour qui le visage de l’Autre est le fondement de toute éthique. Face à cette femme, ce soldat voit enfin un visage. Un amour qu’il n’a jamais reçu, qu’il désire mais ne peut accueillir. Son crime n’est pas seulement un acte de violence : c’est l’échec d’un appel éthique, le moment où l’homme choisit de ne pas répondre à la responsabilité que lui impose la présence de l’autre.
Cet échec n’est pourtant pas total : quelque chose résiste. La mémoire de cette mère le hante. Il la hait précisément parce qu’elle incarne ce qu’il n’a pas eu. C’est toute la complexité de la violence : elle naît aussi de la frustration de l’amour manqué.
Mémoire et rédemption : la blessure du temps
Le lien avec Paul Ricoeur, notamment dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, devient ici fécond. Le roman met en scène des personnages en lutte contre une mémoire traumatique qui menace de les figer dans le ressentiment. Lulu et Salif doivent traverser la mémoire, non pour la nier, mais pour l’habiter autrement. Le récit devient une allégorie de la résilience, où l’oubli n’est pas négation, mais travail sur la mémoire, « l’oubli gardien de la mémoire », dirait Ricoeur.
Le pardon n’est ni immédiat, ni facile, ni même certain. Mais il demeure possible. Et cela suffit pour que l’amour, la solidarité et la reconstruction soient pensables.
La mémoire comme poison ou comme passage
Le roman nous révèle que la mémoire peut tuer autant qu’elle peut sauver. On peut lire : « Le peuple a oublié son histoire. Et voici que quelqu’un a profité de son manque de mémoire pour planter la haine dans sa tête. »
La haine devient ici une construction mémorielle trafiquée, une mémoire falsifiée, utilisée comme arme politique. La cité de Kali, ce monde suspendu entre vie et mort, est en réalité une métaphore du travail de mémoire : un purgatoire où il faut faire face aux démons du passé pour pouvoir renaître.
Une filiation réparée : femmes de mémoire, femmes de futur
La relation mère-fille devient le cœur battant du récit. Transmettre la vie, protéger l’innocence, donner une chance au futur : telles sont les missions que s’attribuent ces femmes, même dans la boue, même dans la peur. Le lien entre Rada et sa mère, entre Lulu et la figure maternelle symbolique, recompose une filiation blessée mais tenace.
Cette solidarité féminine évoque ces « mères de la mémoire » qu’on retrouve au Rwanda, en Argentine, en Bosnie, ces femmes qui, souvent premières victimes, deviennent aussi les gardiennes d’un récit plus juste.
Une poétique du sacré et de la reconstruction
La structure même du récit, hybride entre le mythe, la fable et la parabole, renforce sa puissance symbolique. L’auteur convoque des éléments de la cosmogonie, du sacré ancestral, tout en inscrivant son œuvre dans une modernité critique. Le pays n’est jamais nommé, mais le Rwanda est omniprésent, dans les collines, dans les silences, dans les non-dits. Trente ans après, ce roman s’inscrit dans une mémoire seconde, celle de la transmission. Il ne s’agit plus seulement de témoigner, mais de transformer la blessure en sagesse.
Dans son ouvrage Mémoire et identité, Jean-Paul II écrivait : « Le mal n’est jamais une force ultime ; la rédemption est toujours plus forte. » Cette conviction semble infuser le roman tout entier. La cité de Kali n’est pas un récit de vengeance, mais un chemin de transfiguration.
L’humanité, malgré tout
La cité de Kali n’est pas un roman sur le passé : c’est un livre sur l’après. Sur ce que l’on fait du mal qui nous a traversés. Sur la possibilité fragile mais réelle de retrouver en soi la lumière, ou au moins une braise. Il nous rappelle que la haine n’est pas inévitable, que le mal n’est pas une fatalité, et que la bonté peut recommencer, même dans un monde en ruines.
Dans ce roman bouleversant, l’auteur nous livre une fable à la fois poétique et impitoyable. Il n’offre pas de réponses faciles, n’idéalise rien. Mais il propose un chemin où la mémoire ne sert pas à justifier la vengeance, mais à reconstruire des ponts. Où l’amour n’est pas naïveté, mais courage. Où le pardon n’est pas une obligation, mais une possibilité ouverte par le regard de l’Autre.
En ces temps troublés, La cité de Kali est un cri, un chant, une prière peut-être. Et surtout, un appel à ne pas renoncer à l’humain.
Nathasha Pemba