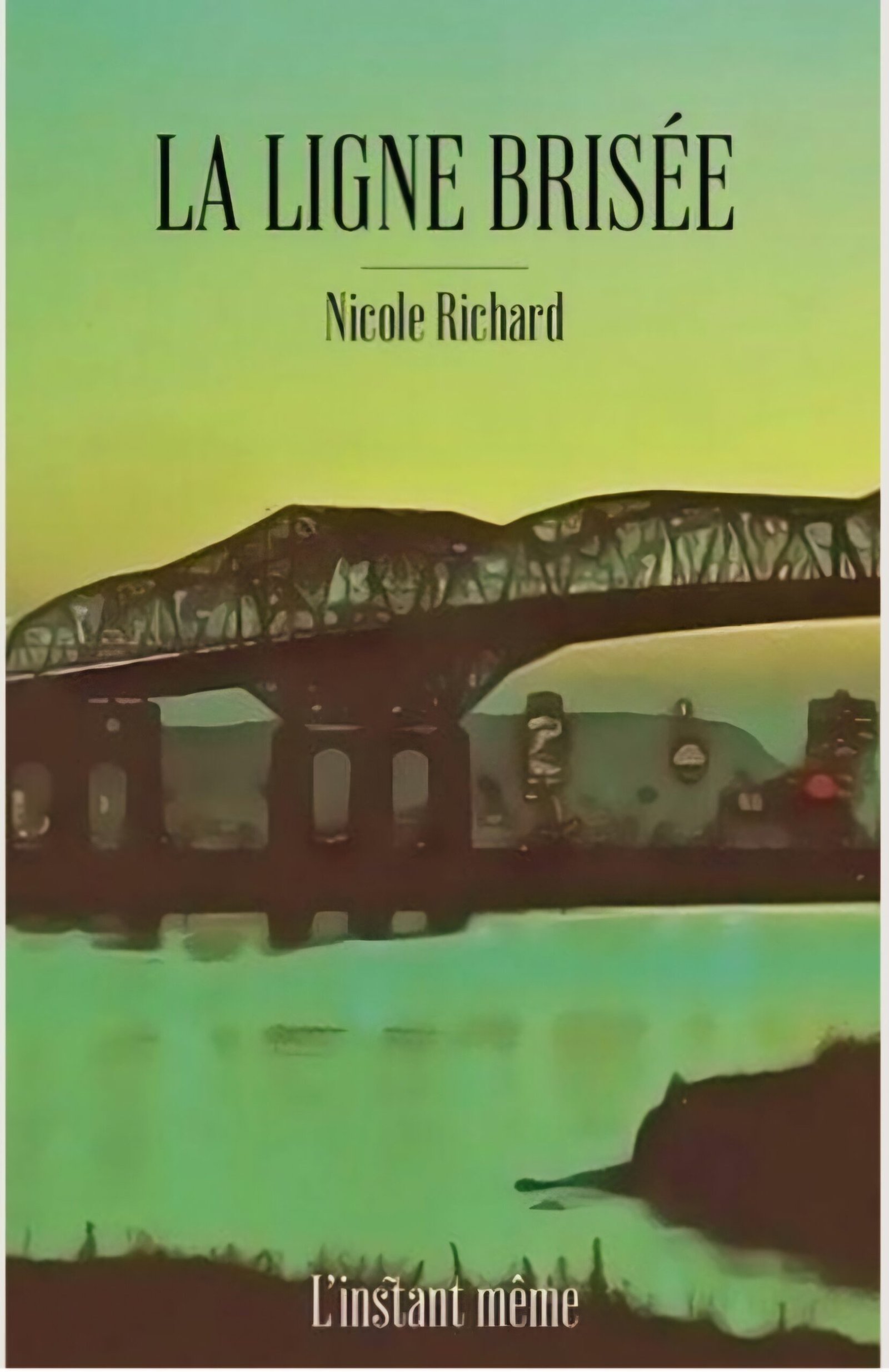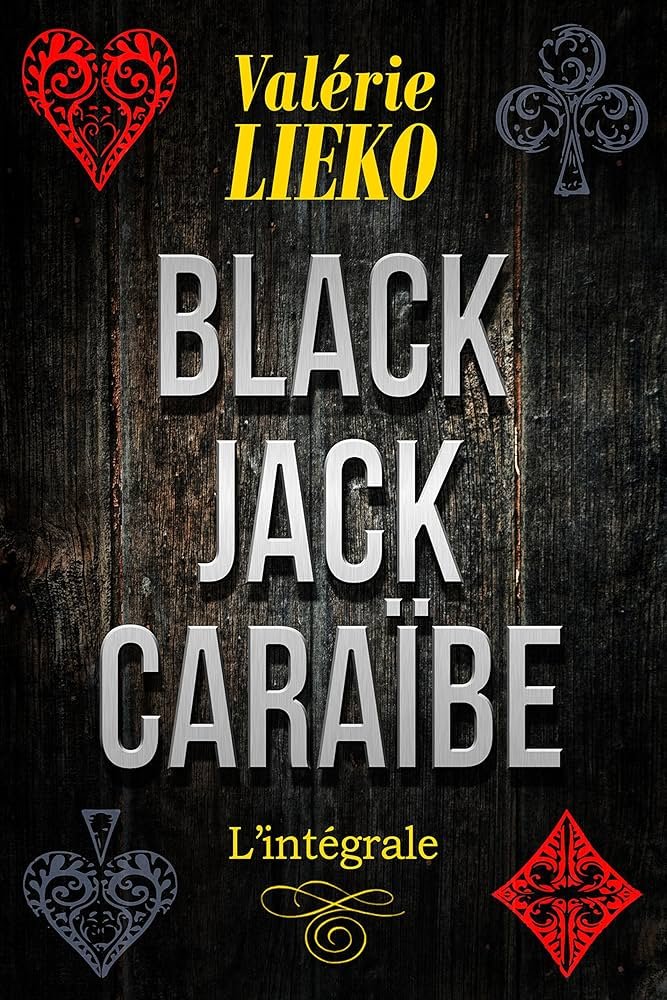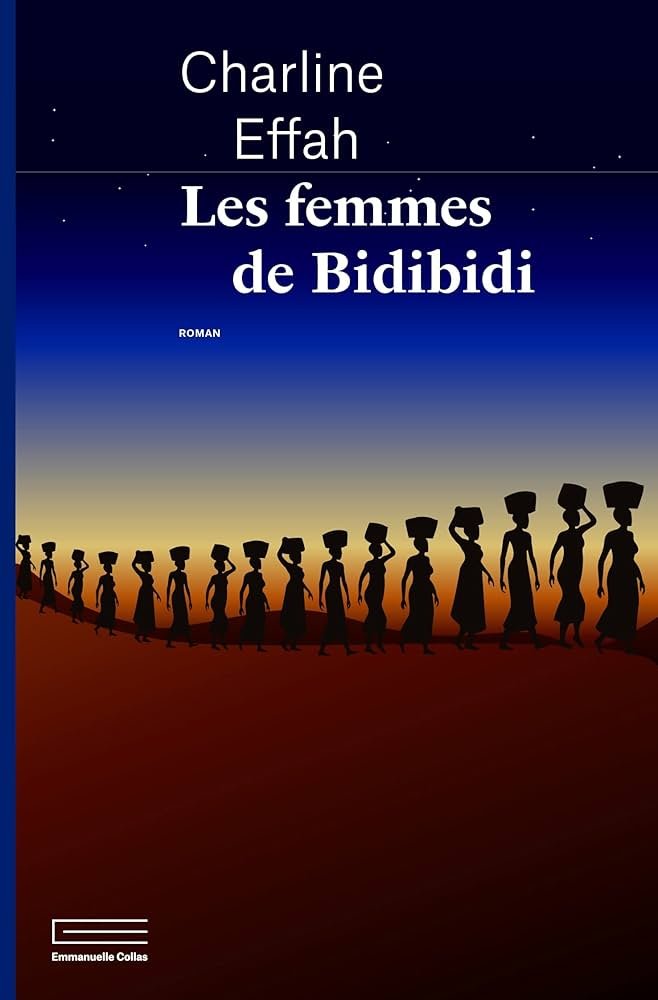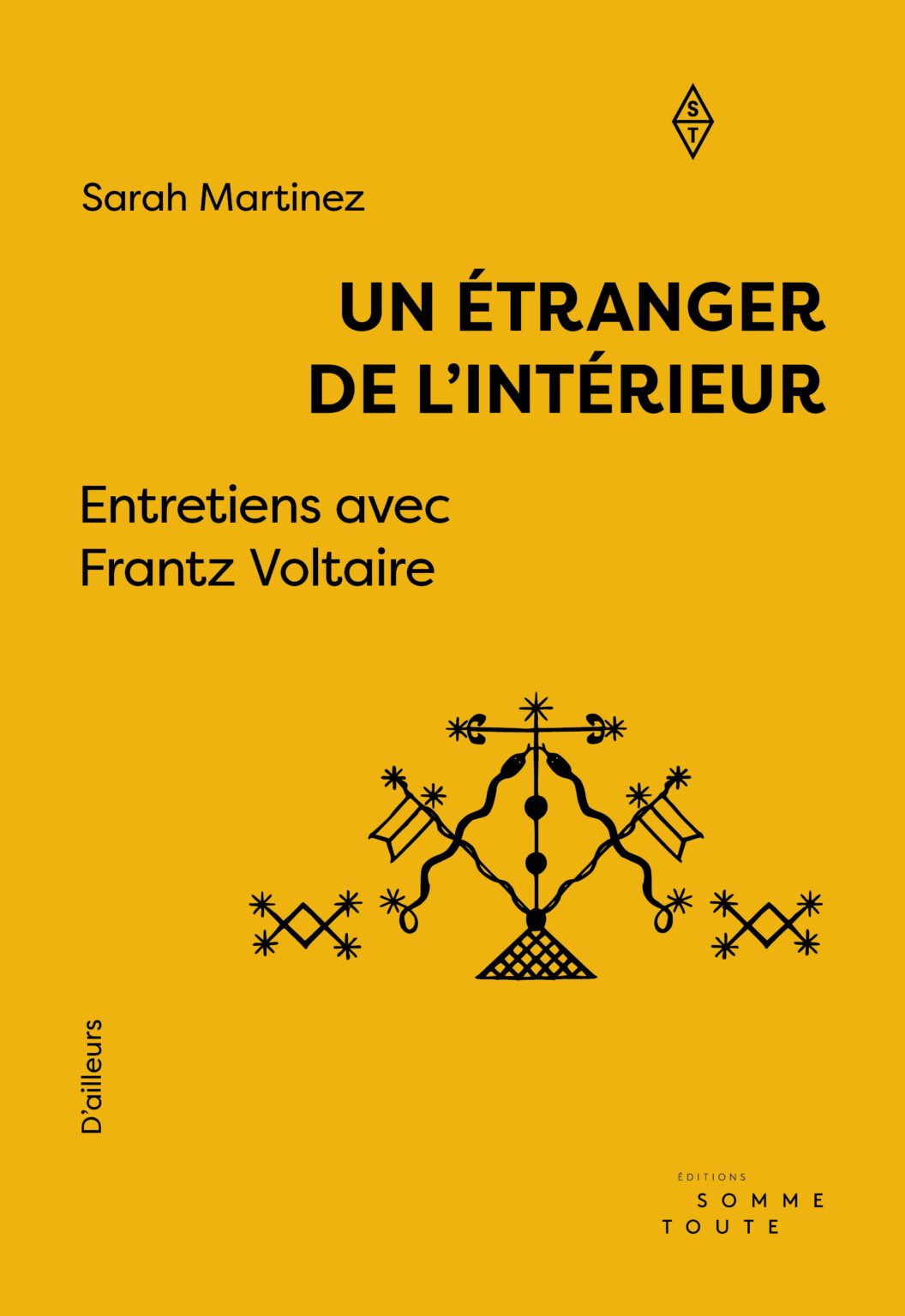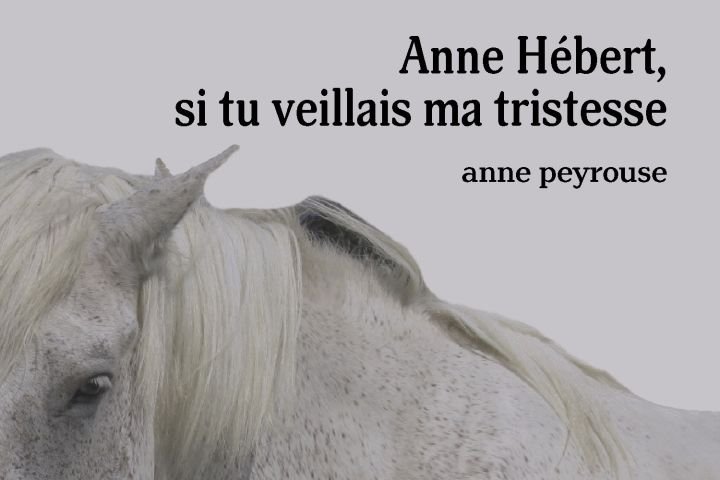Un récit d’émancipation à double temporalité
La ligne brisée s’inscrit dans la continuité du roman L’étincelle (2018), en reprenant la voix d’Eugénie, une narratrice sensible, lucide et en quête d’un espace à elle. L’originalité de ce second opus repose sur la structure en va-et-vient, entre un présent en Europe (Italie, Suisse) et un passé adolescent dans la banlieue de Montréal, sur la Rive-Sud. Ce montage narratif crée une temporalité éclatée qui donne au roman une qualité introspective, proche du journal de bord ou de la rêverie éveillée.
Eugénie raconte son adolescence dans un milieu familial étouffant, où l’absence de perspectives, l’instabilité affective et les non-dits maternels rendent la croissance difficile. Le roman devient ainsi un récit de formation, mais sans idéalisation : l’émancipation est un chemin escarpé, marqué par des ruptures émotionnelles, des exils intérieurs et une soif d’ailleurs.
Le choc des générations : entre déterminisme et liberté
Au centre du roman se trouve la relation conflictuelle entre Eugénie et sa mère Jeanne. Ce lien, tendu et souvent douloureux, illustre le choc des générations, mais surtout le poids des modèles féminins contraignants. Jeanne, marquée par ses propres renoncements et limitations, projette sur sa fille une vision étriquée de la féminité et de la réussite. Eugénie, quant à elle, cherche à inventer un autre chemin, sans nécessairement rejeter sa mère, mais en refusant de lui ressembler.
Cette tension peut être lue à la lumière de Simone de Beauvoir, pour qui l’émancipation des femmes suppose un dépassement du rôle prescrit, une sortie de la répétition des schémas maternels. Eugénie se construit ainsi dans une forme de négociation silencieuse avec l’héritage, cherchant à devenir sujet de sa propre histoire.
L’art du contrepoint narratif : lieux, rythmes et voix
Nicole Richard réussit avec justesse à entrelacer les souvenirs adolescents avec le présent du voyage, créant ainsi une polyphonie narrative discrète mais efficace. L’Italie et la Suisse ne sont pas seulement des décors : ce sont des lieux symboliques d’ouverture, où Eugénie peut observer sa vie avec distance. Le voyage agit comme un levier réflexif, un miroir temporel à travers lequel le passé se décante, s’éclaire, parfois se trouble.
Les paysages étrangers contrastent avec l’univers fermé et morne de la banlieue québécoise, soulignant ainsi la ligne de fracture, la « ligne brisée », entre deux mondes : celui de l’enfance contrainte et celui de la liberté adulte. Le titre du roman peut dès lors se lire comme une métaphore du parcours de la narratrice, mais aussi comme la faille intergénérationnelle, émotionnelle et sociale qu’elle tente de traverser.
Écriture poétique, regard lucide
L’une des grandes forces du roman réside dans l’écriture de Nicole Richard, à la fois limpide, sensorielle et poétique, mais toujours ancrée dans une grande justesse psychologique. Elle parvient à rendre les états d’âme de l’adolescence sans cliché, avec une attention rare aux détails, aux sensations, aux micro-ébranlements de l’être.
À travers une prose parfois méditative, Eugénie reconstruit son passé à la lumière du présent, sans tomber dans la nostalgie ni l’accusation. Ce travail de remémoration s’apparente à ce que Paul Ricœur nomme la “mémoire réparatrice” : il ne s’agit pas de condamner ou de venger, mais de reconnaître les failles, les douleurs, les silences, et de les habiter autrement.
Thèmes universels, voix singulière
La ligne brisée aborde des thèmes universels : la puberté, les premières amours, la quête de sens, la fuite du milieu d’origine, la construction de soi. Mais ce qui rend le roman touchant et fort, c’est qu’il les traite sans pathos ni surplomb moral. Eugénie n’est ni héroïne ni victime : elle est un sujet en construction, qui avance à tâtons, portée par quelques figures bienveillantes (notamment le couple d’enseignants) et par une soif irrépressible de liberté.
Dans un paysage littéraire souvent saturé de récits adolescents stéréotypés ou surdramatisés, Nicole Richard offre une voix d’une belle sobriété, d’une rare authenticité, qui trouve le ton juste entre l’émotion et la lucidité.
En somme,
La ligne brisée est un roman de formation subtil, à la fois intime et universel, poétique et engagé, qui interroge en profondeur ce que veut dire grandir en marge, devenir soi au sein d’un héritage blessé, et inventer un horizon là où rien ne semblait promis. Eugénie est une narratrice qui se souvient non pour se plaindre, mais pour comprendre ; qui écrit non pour régler des comptes, mais pour tracer, sur la ligne brisée de la filiation, une trajectoire propre.
Nicole Richard signe un texte délicat, sensible et philosophique, qui mérite d’être lu à voix haute, comme on écoute une confidence précieuse, ou une page de journal qu’on aurait oublié d’écrire.
Heidi Provencher