La corruption morale : quand le succès a un prix
Le mirage de l’ascension
Chérubin, personnage principal, incarne le jeune homme brisé par la frustration sociale. Sa volonté de sortir de la pauvreté l’amène à pactiser avec une figure trouble : Tonton Mam. Ce dernier, porteur d’une valise de 25 millions, propose bien plus qu’une aide, il incarne un système où l’argent se gagne au prix de l’âme.
La trajectoire de Chérubin évoque une version contemporaine du mythe faustien, où la réussite fulgurante cache une corruption spirituelle profonde.
De la misère à la monstruosité
Le roman va au-delà d’une simple critique sociale : il montre comment un être broyé par le système peut devenir lui-même bourreau. Chérubin, d’abord victime, finit par s’enfoncer dans une spirale de crimes, viols, meurtres, abus, devenant un rouage de l’horreur.
Engouang ne cherche pas l’effet choc gratuit. Il démonte les rouages d’une société où la misère ouvre la porte à toutes les compromissions, et où l’inhumanité devient stratégie de survie.
Thèmes majeurs : société brisée, corps marchandisé, famille détruite
La misère comme matrice du mal
L’auteur dépeint une pauvreté non seulement économique, mais aussi mentale et morale. Elle ronge la dignité et pousse aux pires renoncements. La réussite y devient suspecte, liée à des pratiques occultes où l’innocence est monnayée.
Corps sacrifiés, âmes vendues
L’univers du roman est traversé par des allusions aux crimes rituels, pratiques occultes où l’être humain, souvent enfant, marginal, vulnérable, est réduit à l’état de marchandise. Le roman interroge sans complaisance une réalité souvent tues dans certaines sociétés africaines contemporaines.
Un passage de la quatrième de couverture évoque crûment cette logique :
« Scrutez ceux qui vous entourent… D’où vient-il qu’un des membres soit attardé mental ? »
Ce soupçon latent devient ici une accusation littéraire, portée avec force.
Familles éclatées, enfances brisées
La figure de Rêve Ndem symbolise les ravages de l’abandon. Quand son père quitte le foyer, tout s’effondre. La mère, brisée, n’est plus un repère, et la fille sombre.
« La vie ne crée pas de démons. Elle fait naître des anges que la société s’évertue à élever ou à étouffer. »
Le mal n’est pas inné, mais socialement construit. La cellule familiale, quand elle éclate, laisse le champ libre à toutes les dérives.
Une écriture dense, sensorielle, suggestive
Le style d’Hallnaut Engouang est à la fois poétique et dérangeant. Sa langue, souvent baroque, donne corps à l’indicible :
« Silencieux tel un cortège funèbre, ils attendaient chacun son tour. Comme souvent, un fumet inodore […] envahissait leurs poumons sans qu’ils ne s’en rendissent compte. »
Cette image sensorielle évoque le mal insidieux, invisible, mais omniprésent. Le style suggère plus qu’il ne montre, rendant l’horreur plus efficace encore.
Une portée politique et sociétale
Critique des élites et du pouvoir occulte
Le roman sous-entend que derrière certaines fortunes, se cache le sang. L’élite corrompue repose sur des pratiques occultes, des complicités muettes, et une société complice.
Une réification organisée des corps
Les corps, féminins, mineurs, marginaux, deviennent des instruments : de pouvoir, de richesse, de domination. Le récit, sous couvert de fiction, agit comme un réquisitoire contre une société qui sacrifie les plus faibles sur l’autel de la réussite.
une œuvre lucide, un cri de l’ombre
La Nuit n’est pas simplement un roman noir : c’est une plongée dans les abîmes d’une société malade, où la misère ouvre la voie au sacrifice, et la réussite dissimule des crimes. Hallnaut Engouang signe une œuvre brutale, nécessaire, qui nous renvoie à cette vérité :
« L’être humain n’est pas une mécanique… On ne peut mesurer la durée de la douleur humaine. »
Un roman dérangeant, à lire non pour s’évader, mais pour regarder en face ce que l’on préfère souvent taire.
Nathasha Pemba

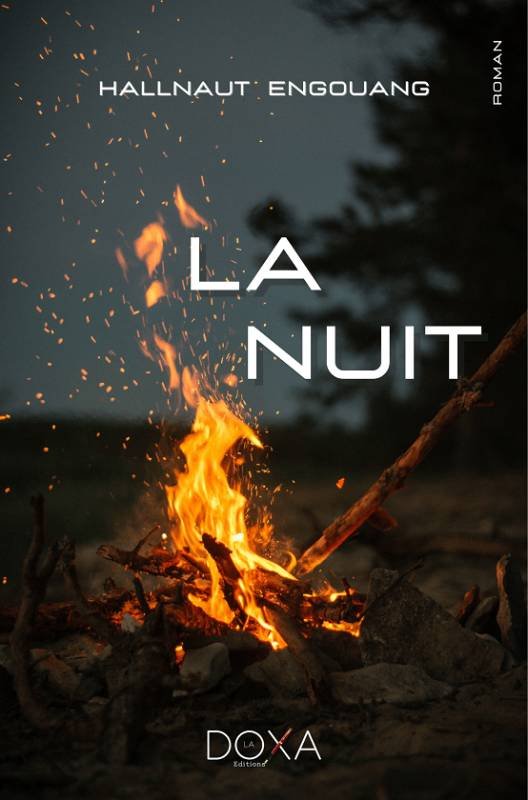
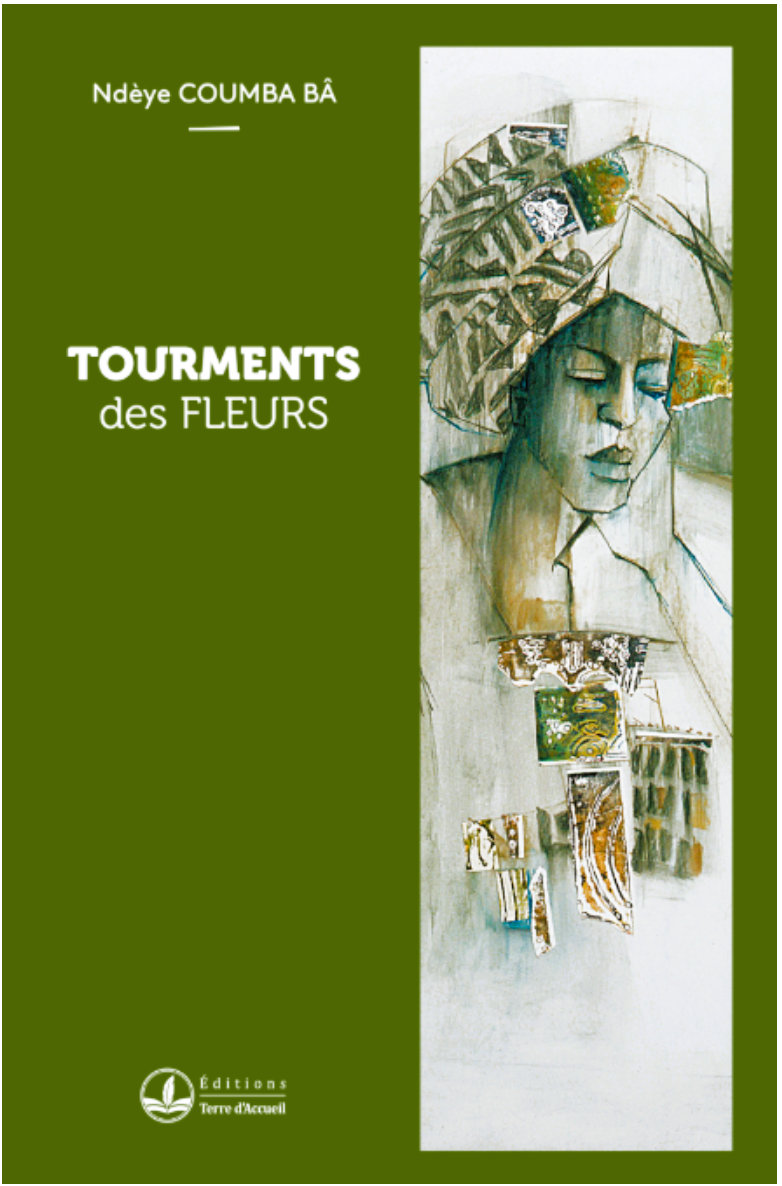
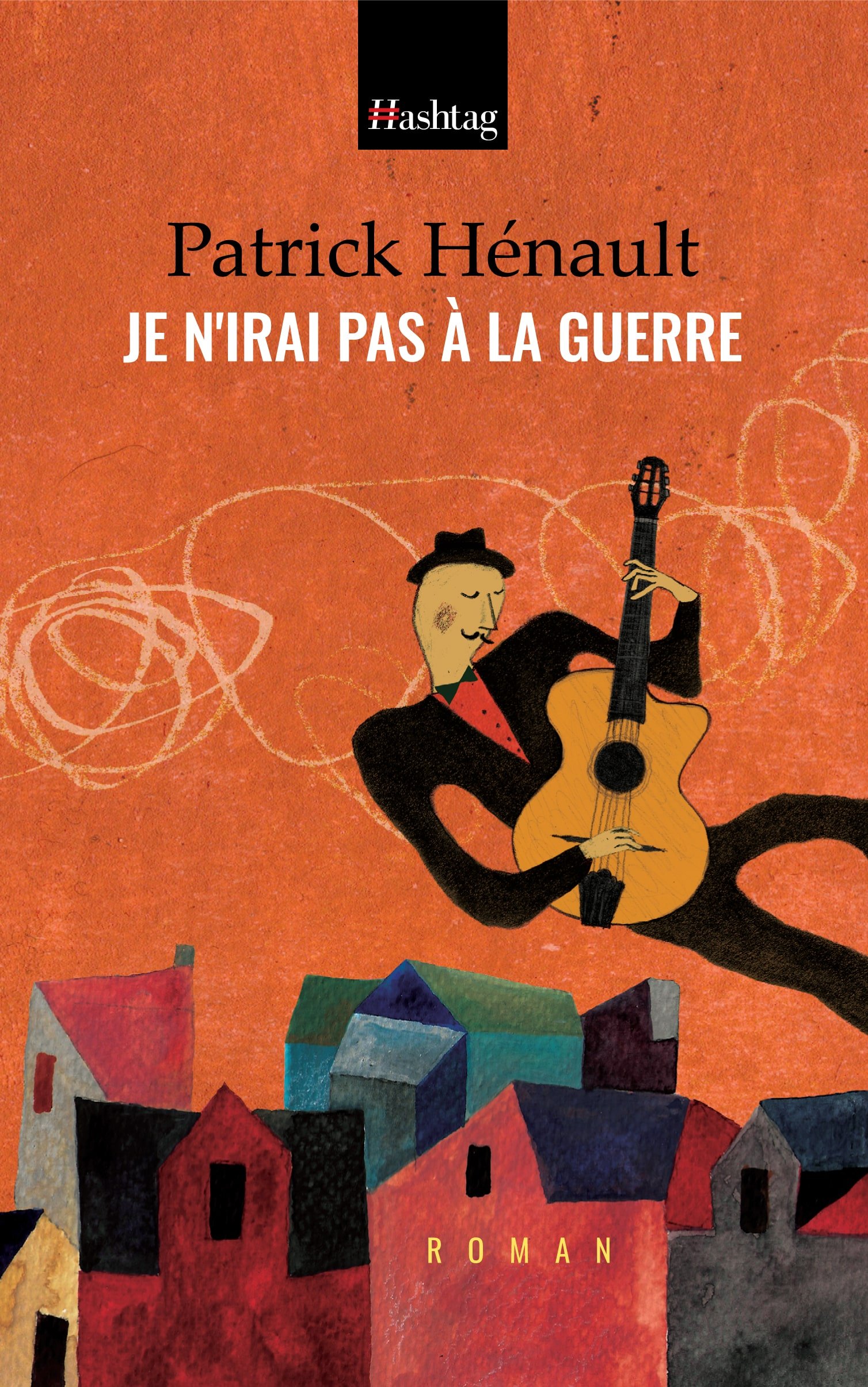
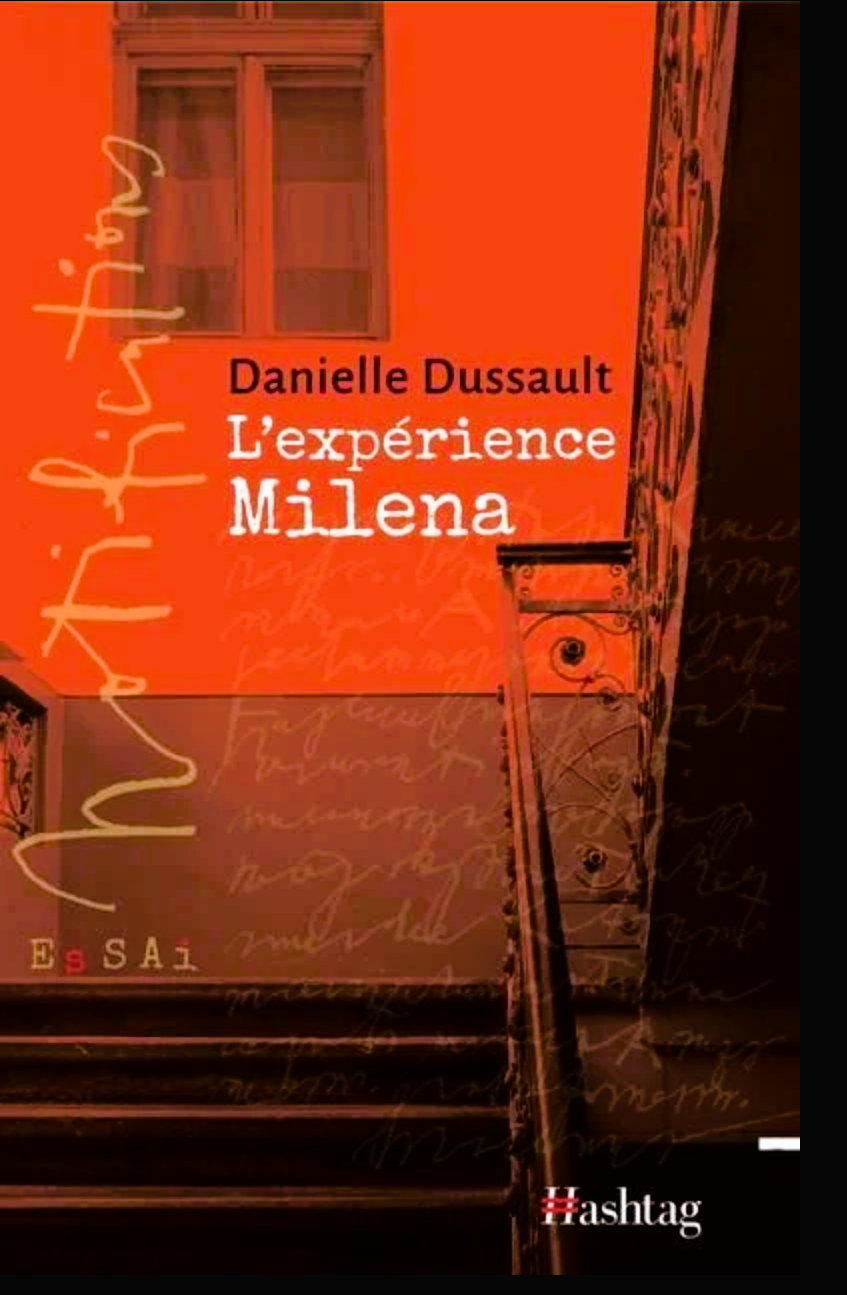
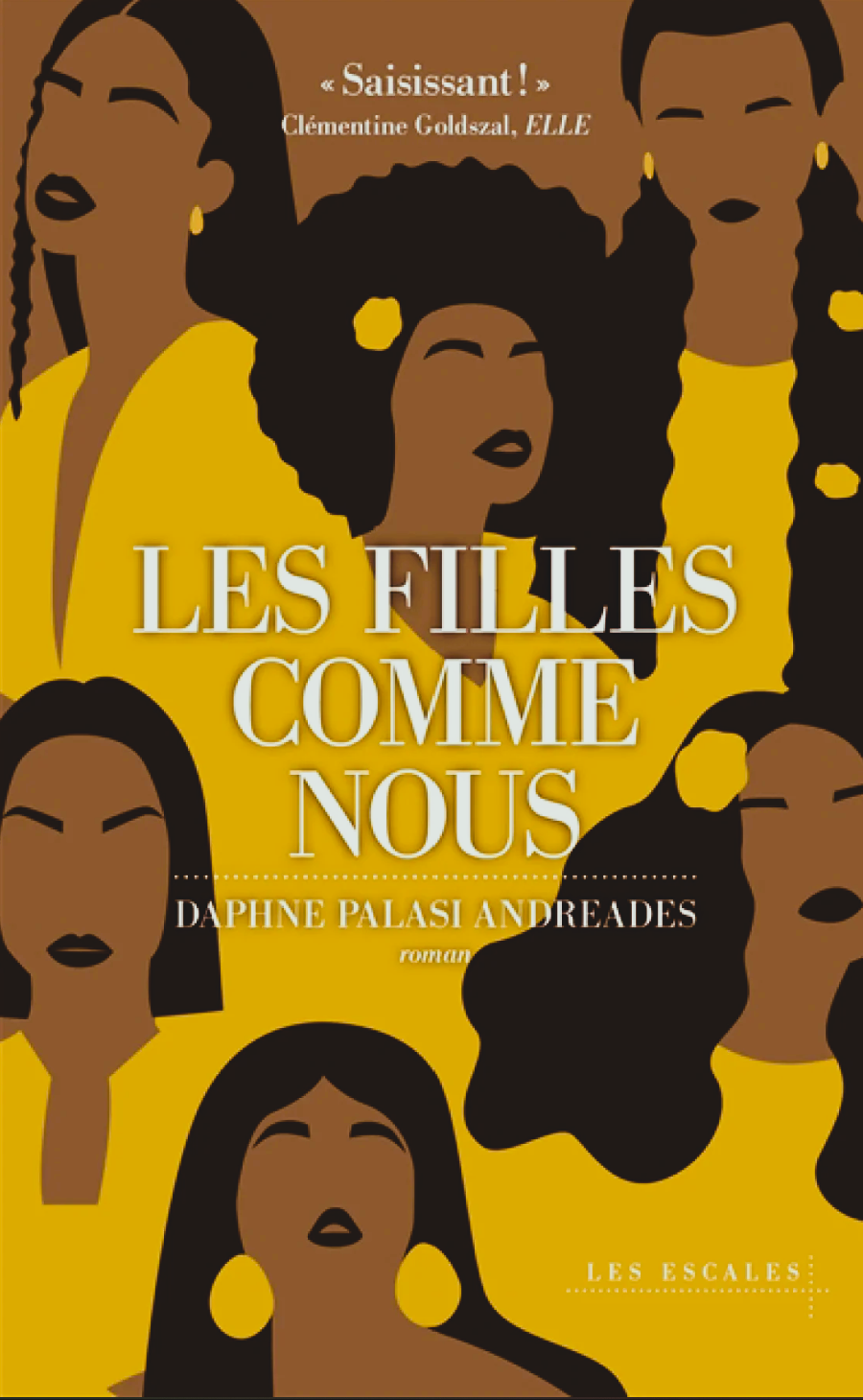




2 commentaires
Merci Nathasha pour la profonde lecture de ce texte que je découvre seulement. Tu as ressorti avec adresse et finesse les contours de cette nuit de tous les jours. Je t’en remercie.
Merci Hallnaut. Au plaisir