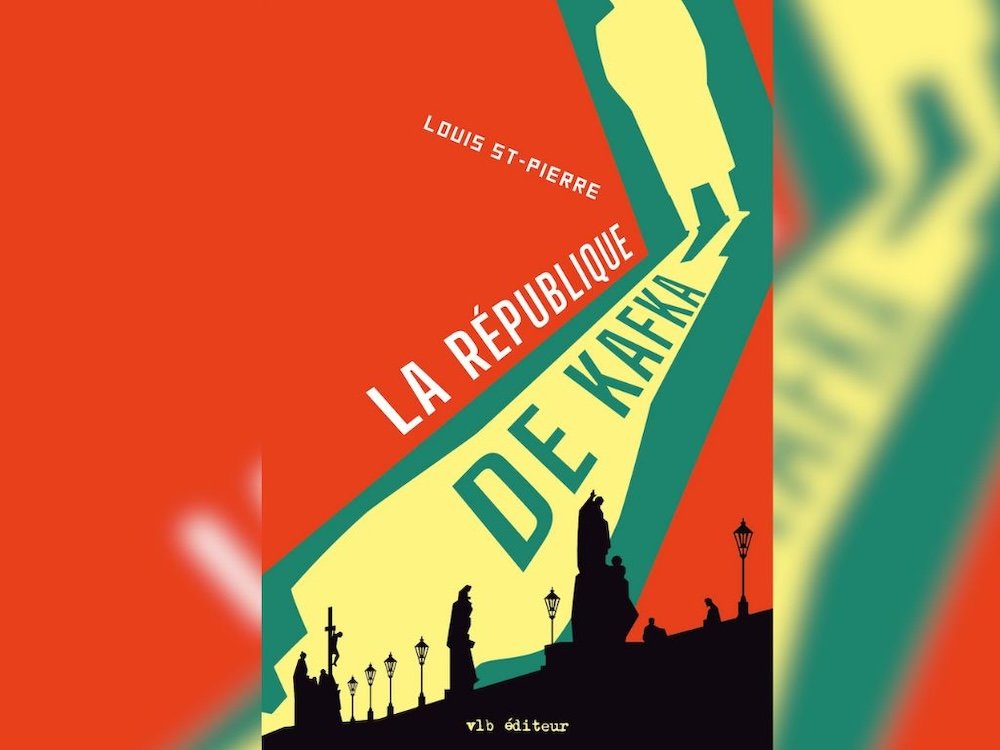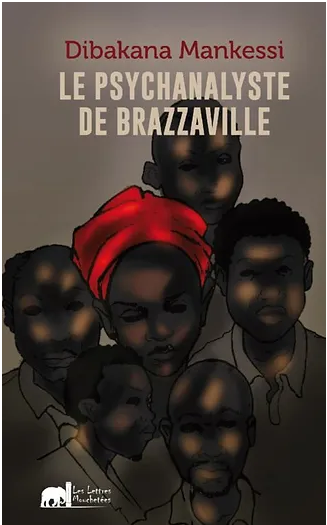En 1994, Meursault, contre-enquête, premier roman de Kamel Daoud, a obtenu le Goncourt du premier roman. Ce roman qui était considéré comme une réponse de Daoud à L’étranger de Camus a connu un énorme succès au point d’être traduit dans plusieurs langues.
Cette année, l’auteur revient avec Houris, une fiction qui retrace les massacres de la « décennie noire » en Algérie, entre 1992 et 2002, histoire interdite dans le pays.
Houris, chez les musulmans, désigne les jeunes filles promises au paradis.
Quatrième de couverture du roman : « Je suis la véritable trace, le plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en dix ans en Algérie. Je cache l’histoire d’une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. »
Aube est une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d’indépendance, qu’elle n’a pas vécue, et oublier la guerre civile des années 1990, qu’elle a elle-même traversée. Sa tragédie est marquée sur son corps : une cicatrice au cou et des cordes vocales détruites. Muette, elle rêve de retrouver sa voix.
Son histoire, elle ne peut la raconter qu’à la fille qu’elle porte dans son ventre. Mais a-t-elle le droit de garder cette enfant ? Peut-on donner la vie quand on vous l’a presque arrachée ? Dans un pays qui a voté des lois pour punir quiconque évoque la guerre civile, Aube décide de se rendre dans son village natal, où tout a débuté, et où les morts lui répondront peut-être.
L’intrigue se déroule entre Oran et le désert algérien.
Extrait du roman :
Après dix ans de tueries, nous n’avons rien pu obtenir comme butin, pas même des corps. Pas même une parole.
Une seule photo pour toute une guerre, je te la montrerai ce soir au retour. […]
Tu y verras une femme qui crie, bouche ouverte au-delà des mots, visage tordu, comme quand la douleur vous plonge dans le vide. La femme hurle, ou semble au bout d’un long hurlement, tout est desséché sur son visage. Elle ressemble à un vieux ruisseau inanimé qui montre ses entrailles de pierre. Sur sa tête, elle porte un foulard. Il dévoile une chevelure soyeuse qui suggère sa féminité et son malheur de mère, sauf que ce n’est plus une mère. On l’appelle la « Madone de Bentalha ». Bentalha, c’est le quartier d’Alger où, dans la nuit du 22 septembre 1997, on massacra et égorgea 400 personnes. Cette femme à la douleur sourde est au bras d’une autre qui la retient contre un mur et l’assiste pour accoucher de quelque chose de monstrueux. Le visage de la madone prend tout l’espace dans la tête de celui qui regarde cette photo. « C’est la Madone de Bentalha », répétait ma mère en lui cherchant la meilleure place sur notre mur d’entrée. La photo suspendue crie et le temps est tétanisé pour elle et pour moi et pour nous tous, et rien ne se passe pour nous défaire de ce saisissement. Le massacre a eu lieu dans les environs d’Alger durant la guerre, la mienne. C’est tout ce qui subsiste. Pour l’autre guerre, on trouve des milliers de clichés avec des soldats, des femmes, des mitrailleuses, des drapeaux, des manifestants, des combattants de la France, des vieillards, des enfants. Alors tu vois ? Nous, on n’existe pas ; moi je n’existe pas et toi si peu, et seulement pour quelques heures. (p. 116-117)
La rédaction