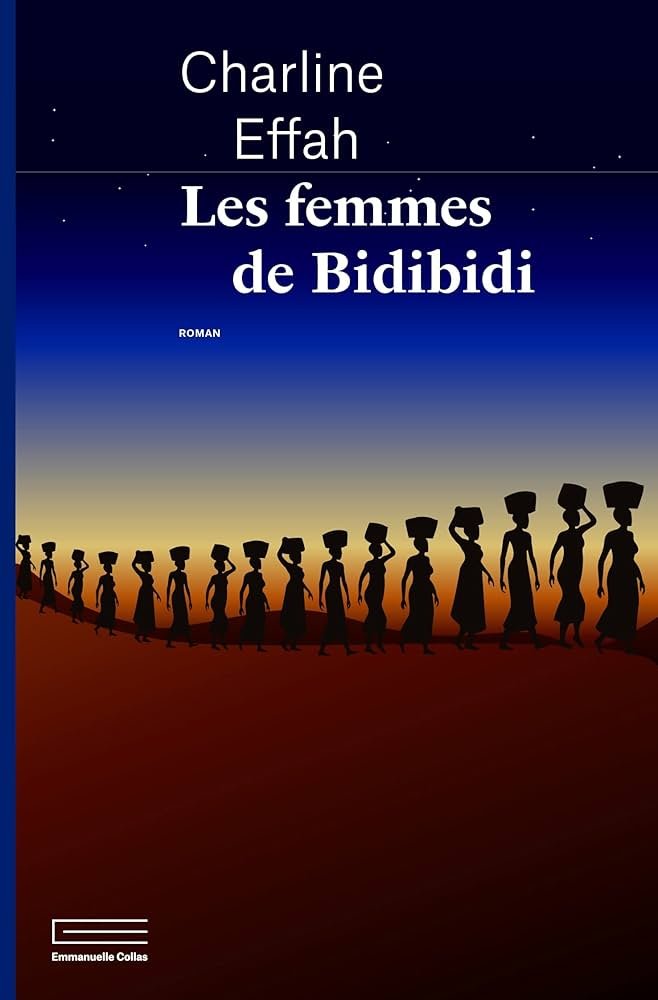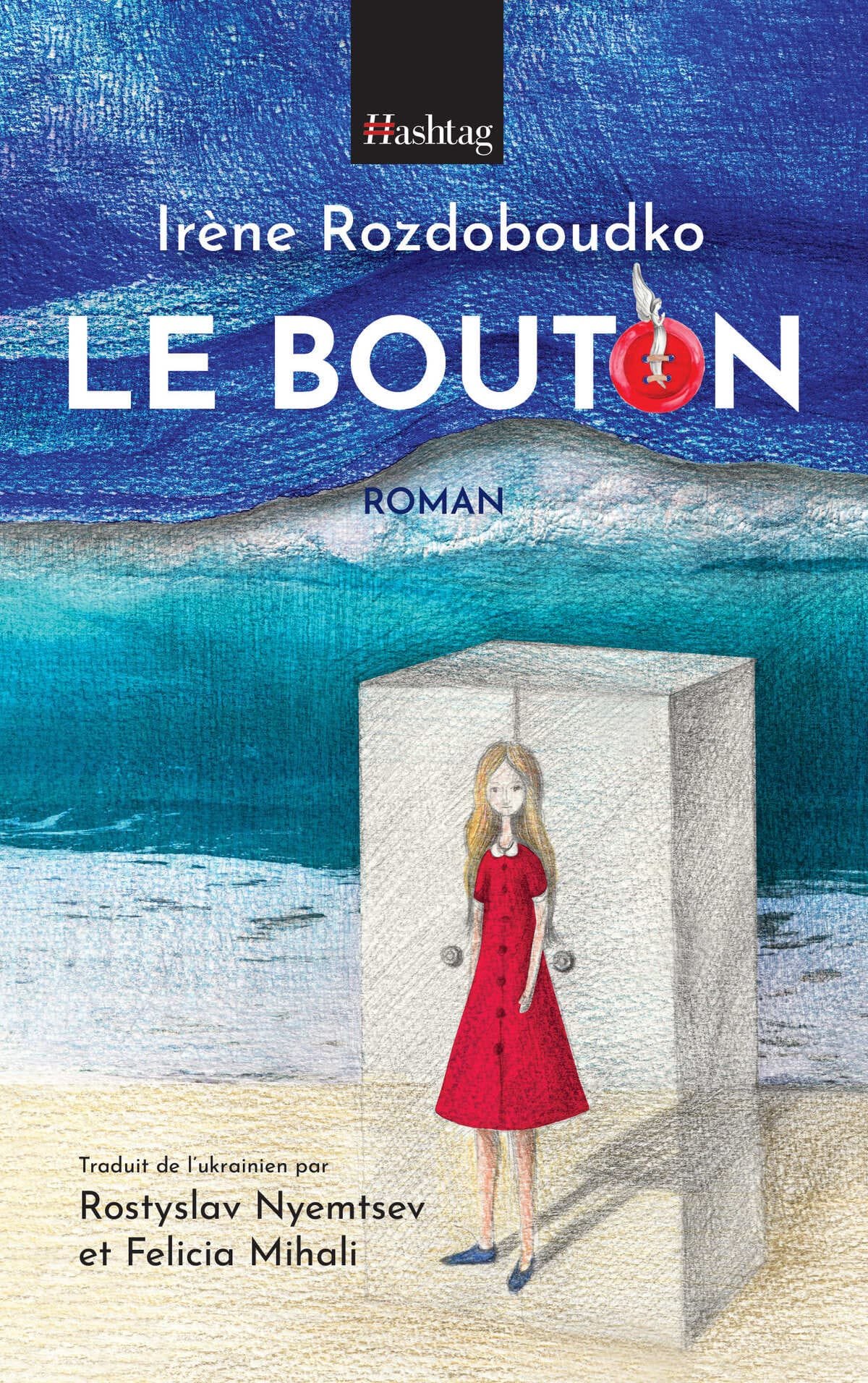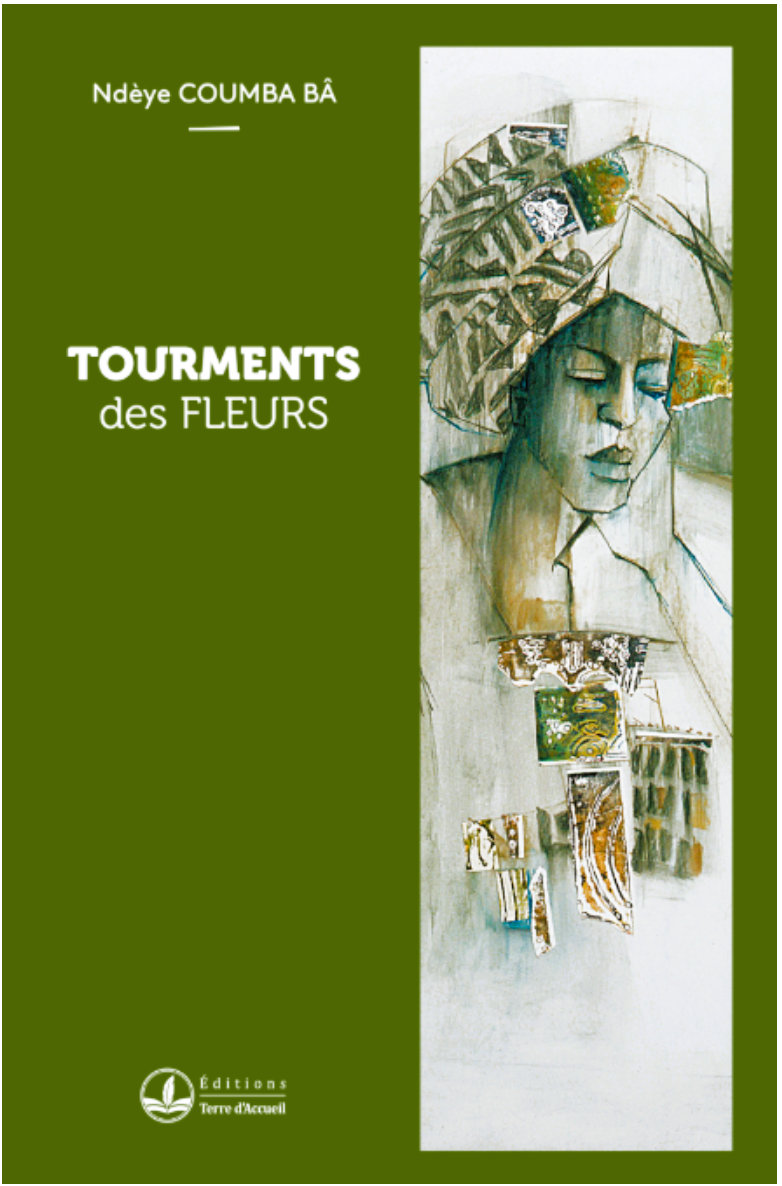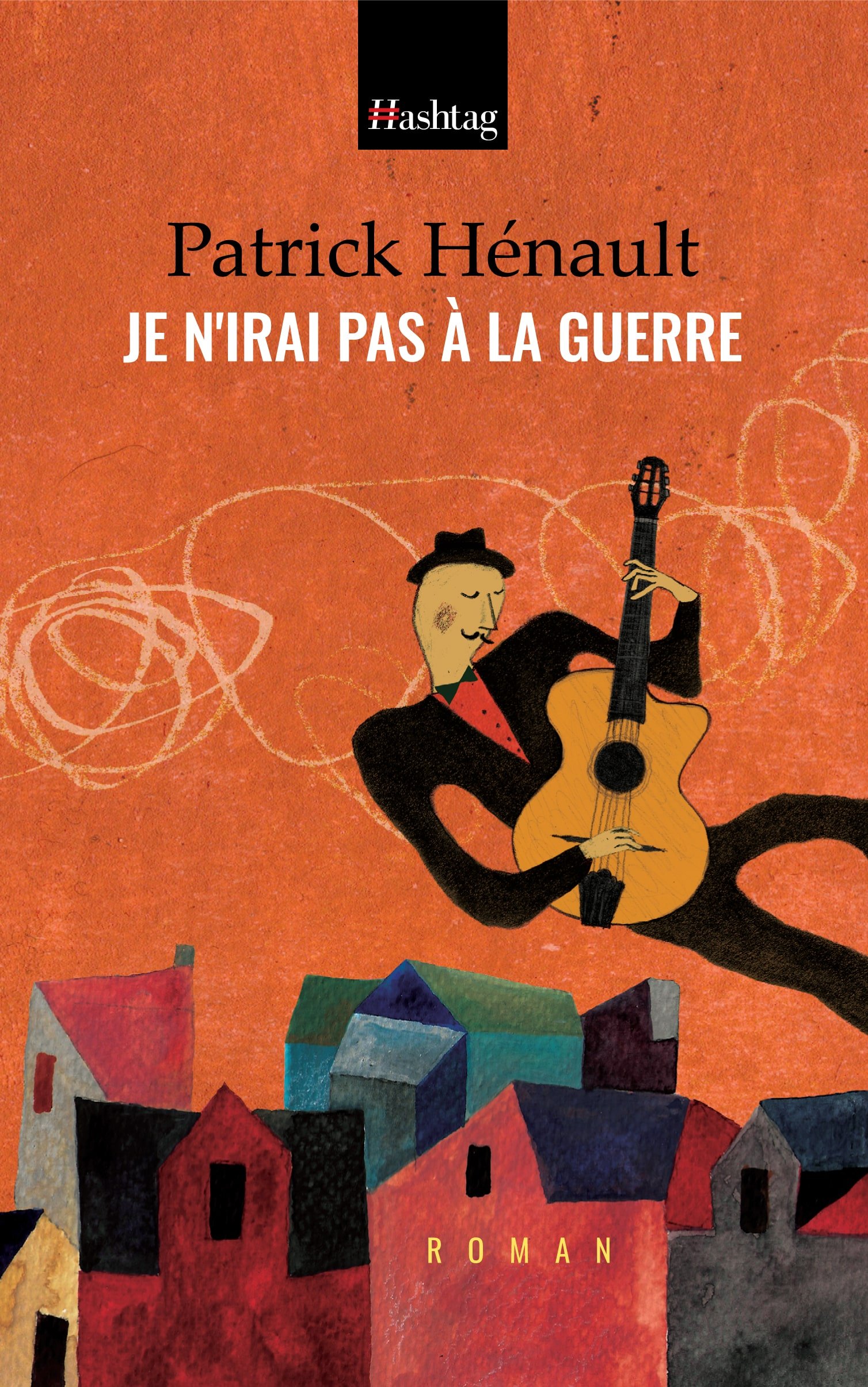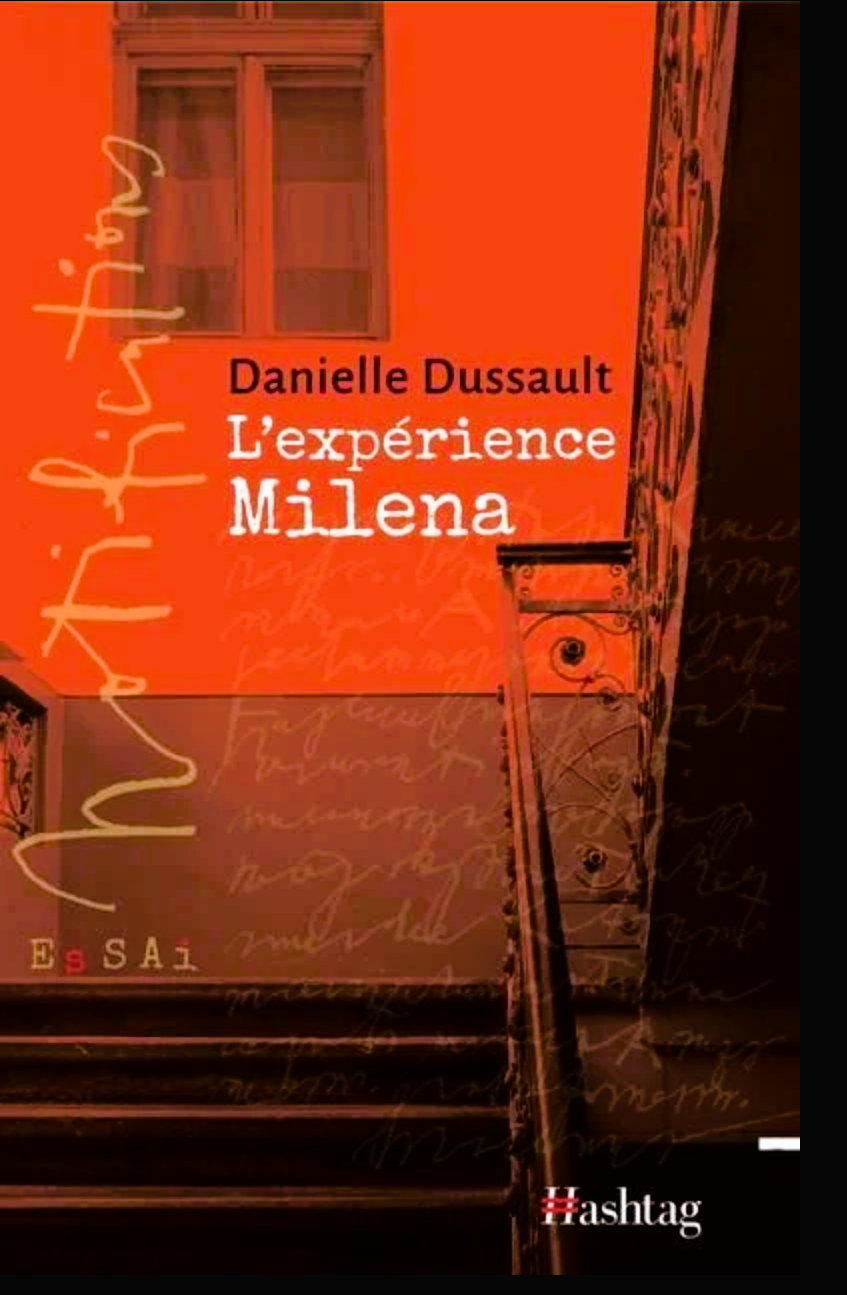Charline Effah est une autrice gabonaise installée à Paris, où elle dirige un organisme de formation tout en consacrant son temps libre à sa passion pour l’écriture. Sa plume m’a conquise dès la lecture de son roman N’être, paru en 2014 aux éditions La Cheminante. J’ai toutefois mis du temps à ouvrir son dernier livre, et une fois ma lecture achevée, il m’a fallu encore du temps pour être capable de vous en parler. L’autrice y aborde un sujet qui me touche intimement : même si mon expérience des violences domestiques remonte à plus de trente ans, j’en reste profondément marquée. Et je suis très loin d’être un cas isolé.
Les violences intrafamiliales constituent un fléau mondial. En France, où je réside, elles génèrent quarante-cinq interventions de la police chaque heure. Quant aux violences sexistes et sexuelles, elles sévissent partout avec une ampleur qui nous semble de plus en plus importante, car à l’heure des réseaux sociaux, les témoignages de victimes affluent de toutes parts. Je vous renvoie à la lecture de l’ouvrage de la journaliste féministe Alice Coffin, Le Génie lesbien, qui dresse un constat accablant et alarmant de la violence subie par les femmes. Charline Effah brise elle aussi plusieurs tabous dans son roman en choisissant comme héroïnes des survivantes de violences domestiques et de viols de guerre qui essaient de se reconstruire. Elle nous raconte notamment l’abandon de Minga par sa mère Joséphine lorsque cette dernière s’est enfuie de « sa prison conjugale ».
« Je lui pardonnais d’être partie. On peut haïr une femme. Mais on ne peut pas haïr une femme battue. » (page 33)
Après avoir quitté son époux violent, Joséphine a travaillé dans l’humanitaire durant quarante ans. Infirmière, elle s’était attachée à Rose, une réfugiée qu’elle avait soignée dans le camp de Bidibidi, en Ouganda. Au terme de sa mission humanitaire, Joséphine avait décidé de rester dans le camp auprès de sa protégée. À la mort de son père, Minga se lance sur les traces de Joséphine et entreprend le long voyage depuis Paris pour se rendre à Bidibidi et retrouver sa mère disparue. Situé à dix heures de route de la capitale ougandaise, Kampala, et proche de la frontière de la République démocratique du Congo, Bidibidi est « une ville transit, un espace hors du temps où vivent deux cent soixante-dix mille hommes et femmes qui ont quitté le Soudan du Sud ». Charline Effah sait de quoi elle parle puisqu’elle s’y est rendue elle-même pour nous offrir ce roman poignant.
« Sans pouvoir enterrer leurs morts, ils ont traversé des forêts et esquivé les balles des combattants en renonçant à ce qu’ils étaient hier. Ils se sont rassemblés dans le camp pour continuer à vivre. » (page 42)
Ces jours-ci, le conflit au Soudan s’est brutalement imposé dans l’actualité mondiale avec la diffusion d’images insoutenables sur les réseaux sociaux par ceux-là mêmes qui commettent des exactions : viols et meurtres de masse. Depuis, de nombreux journalistes et blogueurs nous abreuvent d’analyses expliquant le conflit entre le pouvoir arabe de Khartoum et les populations noires du Soudan du Sud, avec toujours en toile de fond le pillage des ressources naturelles du Soudan opéré par des opérateurs étrangers qui profitent du chaos pour s’enrichir. En 2023, le roman de Charline Effah apportait déjà un éclairage sur ce conflit que la plupart d’entre nous choisissions d’ignorer, car trop éloigné de nous et trop incompréhensible. L’autrice gabonaise y a déployé tout son talent de conteuse pour nous attacher à ses héros, et nous n’avons pas d’autre choix que de vivre à travers eux le drame qui se joue dans cette région du monde où « qu’elle ait deux ans ou quatre-vingt-dix ans, une femme n’est rien d’autre qu’un corps à profaner ». À l’instar de Rose, la protégée de Joséphine, qui finira par se révolter contre la brutalité de son ancien compagnon, Chadrac. La confrontation ultime entre Rose et son ennemi le plus intime me hantera longtemps après que j’aurai refermé le livre.
« Rose Akech traquait pourtant encore le bonheur au fond d’elle, car les rêves ne meurent jamais. Mais ils peuvent se briser en mille morceaux. Rose, elle, ne craignait pas de raccommoder ses rêves. Cette femme était un feu que la guerre avait allumé, que ni elle ni personne n’avait jamais su éteindre. » (page 125)
La résilience et la combativité de Rose constituent une belle leçon de vie que je vous invite tous à découvrir en lisant ce roman bouleversant.
Ayaba