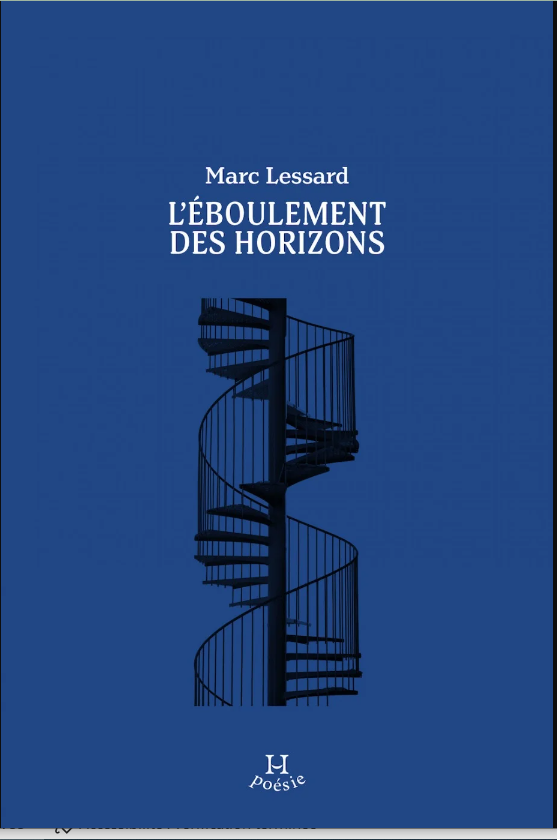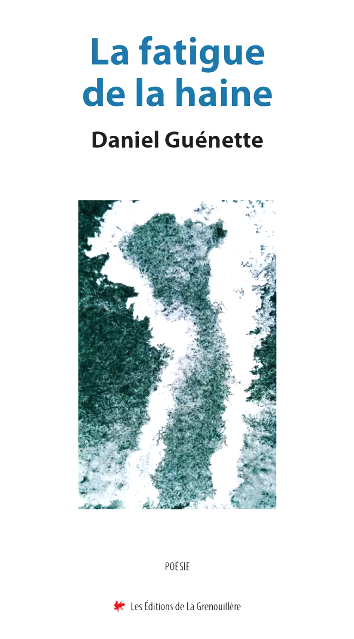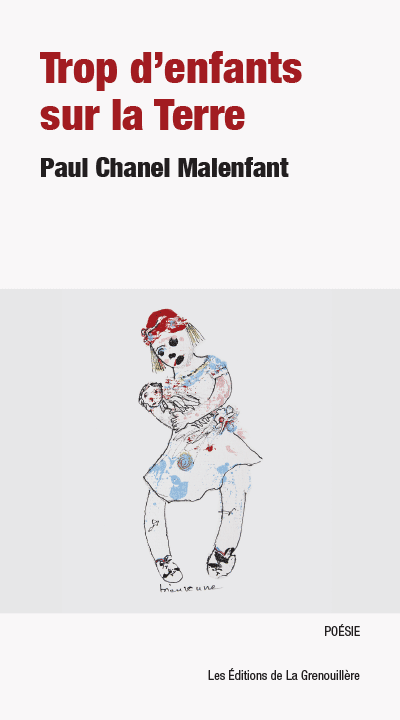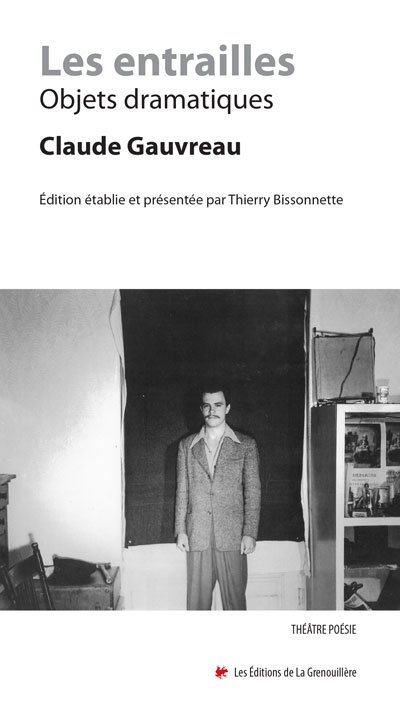Plonger dans le premier recueil publié d’un auteur, enseignant de philosophie, dont la relation avec l’écriture et les réalités existentielles, qu’elles soient palpables ou métaphysiques, est profonde. Je suis donc entrée dans ce texte en supposant que j’y trouverais non seulement une thématique, celle de l’épreuve dans la maladie (ici la sclérose en plaques), mais aussi l’acceptation d’une réalité difficile et l’acclimatation à une nouvelle condition. Entrer dans ce monde et rencontrer ses réalités, la nudité de l’être humain… C’est là certainement l’apanage d’un philosophe et d’un poète. Effectivement, quand on lit un philosophe, qu’il soit poète ou romancier, on s’attend toujours à ce qu’il y ait cette part de réalisme et cet horizon de transcendance qui permettent de regarder la vie autrement.
Tu me fends
Spasme après spasme.
Me permets-tu de mieux feuilleter le visage des jours ?
De mieux chercher ce qui pourrait me soulager ?
Je ne sais pas.
Je relate simplement les preuves que tu laisses dans mon groupe sanguin,
le long de ma moelle épinière,
de mon crâne,
dans mon foie,
dans mes reins,
dans mes os,
dans mes humeurs.
Une chose est certaine,
je me vois périr
Dans cette strophe qui traduit l’état du narrateur, Marc Lessard place le lecteur au cœur de l’introspection et de l’évocation d’une intensité émotionnelle, tout en explorant les liens entre le corps et l’esprit de manière essentielle. On y retrouve les thèmes de la douleur et de la fragmentation. L’image qui saisit de prime abord lorsqu’on lit ce poème est celle de la fêlure : Tu me fends, spasme après spasme. Cette image évoque une douleur présente, réelle, physique, palpable, mais qui, à cause de la maladie, atteint aussi le mental et l’émotionnel. La notion de spasmes renforce l’idée de fragmentation, car elle rappelle une souffrance saccadée, répétitive, qui finit par devenir cyclique, comme l’expérimentent généralement les personnes souffrant de sclérose en plaques.
Pourtant, dans cette quête, on entrevoit aussi une quête de sens et un besoin d’apaisement. La question existentielle et philosophique s’impose : Me permets-tu de mieux feuilleter le visage des jours ? On s’autorise ici à revenir sur la métaphore du feuilletage du temps, qui est empreinte de lyrisme et de délicatesse, suggérant une recherche permanente de compréhension, un désir continu d’explorer le quotidien dans le but de trouver du répit, de l’ataraxie, voire de la consolation : De mieux chercher ce qui pourrait me soulager ?
Comme le suggère l’état de santé, la réponse à cette préoccupation demeure incertaine, ambiguë, voire absente : Je ne sais pas. Comment savoir, lorsqu’on est porteur d’une maladie dégénérative ? Avec quels regards peut-on envisager l’avenir de la corporéité ? Pour Marc Lessard, la douleur est reliée au corps, à l’intériorité physique. La description des traces de la maladie laisse la douleur dans la corporéité (organisme — sang, moelle épinière, organes). De ce fait, la souffrance n’est pas une idée abstraite, mais quelque chose de tangible et d’omniprésent, laissant le corps totalement envahi par la douleur.
Ceux qui sont proches des personnes souffrant de sclérose en plaques savent que, pour elles, la conscience de la mort demeure présente : Je me vois périr, écrit le poète. C’est inéluctable, car le malade reste conscient jusqu’à la fin et devient témoin privilégié de la dégénérescence de son corps. Il demeure lucide face à sa finitude. Attendre ou accueillir sa propre dégradation ouvre à la résignation.
Bien évidemment, on garde toujours dans un coin de son cœur un espoir, une lueur d’espoir, un miracle peut-être, mais parfois on se dit qu’on va aller jusqu’au bout. Pourtant, la maladie et la dégradation nous ramènent sans cesse à la réalité. À la manière d’un Espérant, si l’on veut, quoique en usant d’un trait très réaliste, moins immédiatement ou obstinément rêveur. Quoiqu’il en soit, le langage de Marc Lessard dans ce recueil est direct. On pourrait dire qu’il est même clinique par moments, car l’auteur décrit avec détails les parties du corps touchées par la maladie. On y retrouve des métaphores qui introduisent dans cette réalité tangible une dimension métaphysique de la douleur.
La strophe choisie plus haut est marquée par des phrases à la fois courtes et longues, toutes percutantes, qui accentuent le sentiment de fragmentation vécu par le narrateur. C’est un poème d’introspection qui culmine dans l’acceptation du dépérissement. Le je intensifie la subjectivation du poème, rappelant le lieu de la souffrance : intériorité, intimité, voire huis clos. Pourtant, c’est une intimité mêlée à l’universel (la souffrance). La souffrance est un trait de l’humanité qui crée parfois une dualité entre l’esprit et le corps. C’est, à mon sens, l’une des forces de ce texte, qui réside aussi dans cette fusion entre le réel et le surréel, un mal physique qui touche les profondeurs de l’existence de l’existant.
Le reste du temps je cherche des sorties de secours
dans les plissures de mon crépuscule
afin de mourir proprement.
Je ne finis jamais de crever tant que je ne mourrai pas vraiment,
ce qui n’arrive pas souvent,
surtout vers la fin.
Si on se réfère au caractère dégénératif de la sclérose en plaques, on ne parlerait pas de la vie, ni d’émotions, ni de sentimentalité. Pourtant, dans ce qui peut sembler une détresse, le narrateur explore d’autres horizons comme l’échappatoire : Le reste du temps je cherche des sorties de secours. Il y a là une quête inlassable de solutions, voire d’échappatoires. Le poète cherche un lieu, une possibilité de sortir de l’insupportable, qui pourrait être la douleur ou l’angoisse existentielle. Sortir se présente comme une urgence, une nécessité presque désespérée, même si ces lieux semblent inaccessibles. La plissure du crépuscule évoque une image puissante, car le crépuscule symbolise souvent la fin, et les plissures suggèrent des failles où l’on pourrait s’enfuir ou se sauver de la souffrance. Chercher à s’en sortir jusqu’au dernier moment afin de mourir proprement témoigne d’une volonté de dignité, même dans la dégradation la plus ultime. La mort n’est plus ce que l’on récuse, mais plutôt un rituel que Marc Lessard veut accomplir avec élégance et maîtrise.
Cependant, la contradiction revient aussitôt : Je ne finis jamais de crever tant que je ne mourrai pas vraiment. Mourir sans vraiment mourir, alors que la mort serait une libération des souffrances de la maladie. Vivre devient alors une ambiguïté, car ce qui n’arrive pas souvent, surtout vers la fin introduit une forme d’ironie. La mort semble présente, mais elle tarde à venir, surtout vers la fin, où l’on s’attend à ce qu’elle survienne. La mort est reportée, et l’agonie devient la maîtresse. Pour une personne qui souffre, cela peut devenir frustration et désespoir, car l’attente, à force de durer, devient insupportable.
Il y a ici un espoir/désespoir exprimé sous une forme d’ironie teintée de détachement, de lucidité et de désir de libération. Mais bien sûr, la mort finira par arriver, dans sa temporalité, à travers les souffrances d’un poète que l’on dirait déjà tourné vers d’autres horizons de la vie, car la mort fait partie de la vie.
Il faut dire qu’un écrivain n’écrit jamais sans raison. C’est le cas de Marc Lessard, qui voit sa vie prendre une tournure inattendue lorsqu’il est diagnostiqué de sclérose en plaques. C’est curieux comme le sujet de sa thèse sur l’habiter chez Merleau-Ponty peut avoir des résonances avec sa maladie.
Chez Merleau-Ponty, la notion d’habiter est au cœur de sa phénoménologie de la perception, qui met en avant la relation entre le corps et le monde. La notion de corps chez le philosophe transcende la dimension biologique et s’incarne dans l’idée de corps propre, qui constitue l’être-au-monde. L’habiter est donc ici une compréhension de la manière dont le corps est présent dans le monde et la façon dont il structure l’expérience de celui-ci. Il est donc essentiel de comprendre que le corps, chez Merleau-Ponty, n’est pas séparé de la conscience.
Comme les lecteurs pourront le constater, j’ai volontairement choisi de mettre en lumière certains aspects du recueil de Lessard, qui regorge pourtant de multiples thématiques et questionnements essentiels, non seulement dans la mécanique à l’œuvre dans sa poésie, mais aussi dans ce qu’induit tout geste créateur authentique et toute disposition intérieure à rencontrer le monde par l’expérience de l’écriture. Merci à Marc Lessard d’avoir offert à la communauté des lecteurs son expérience et sa vision de cette étape cruciale.
Je recommande vivement la lecture de ce recueil
Nathasha Pemba