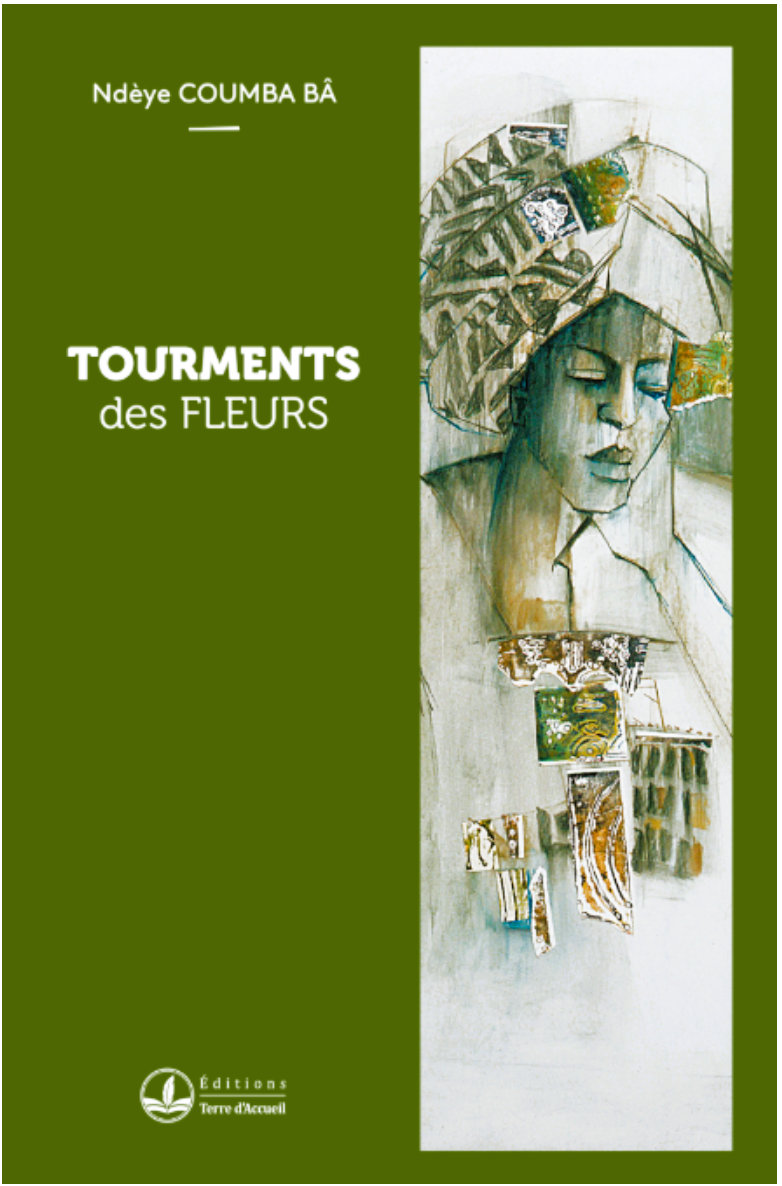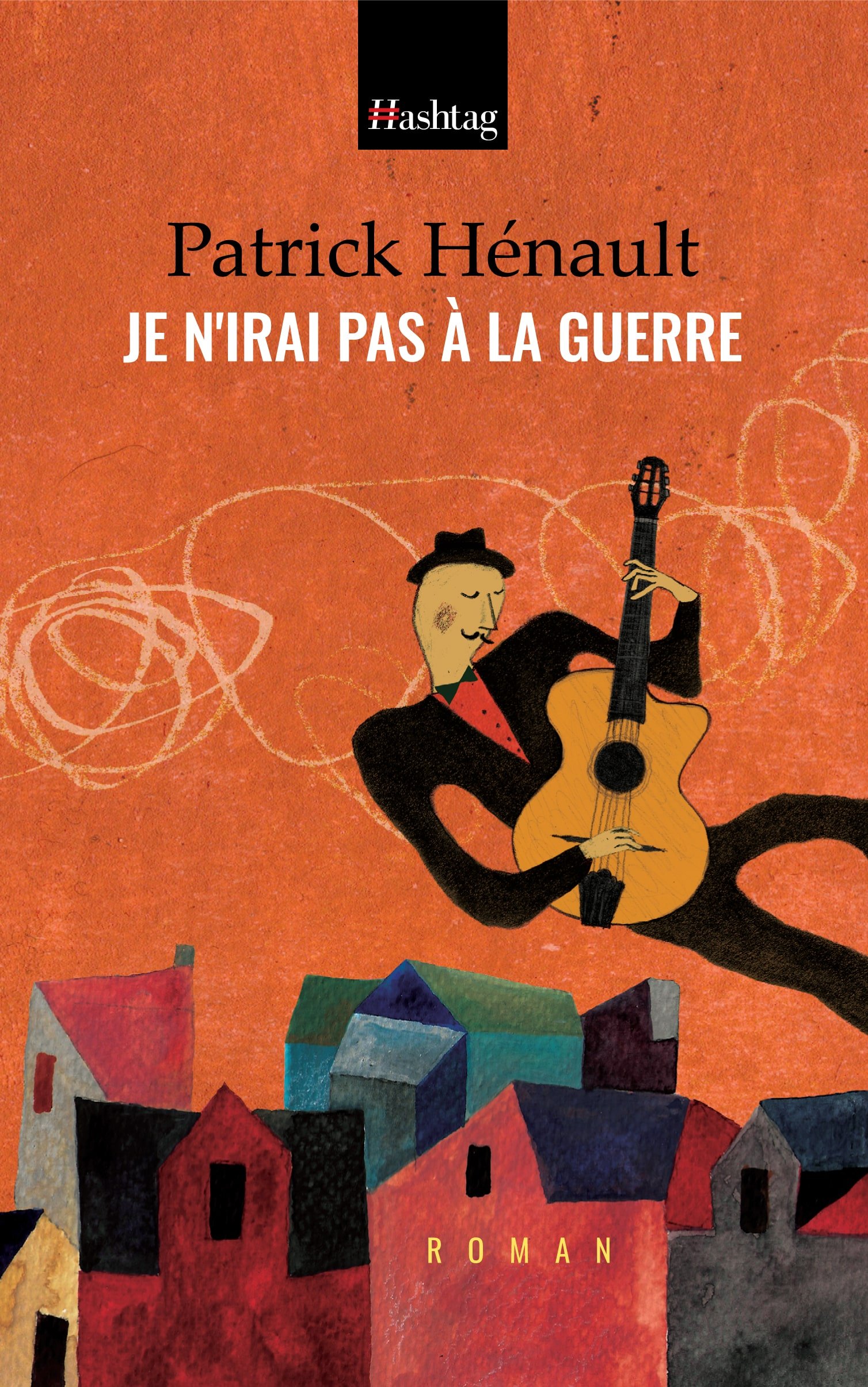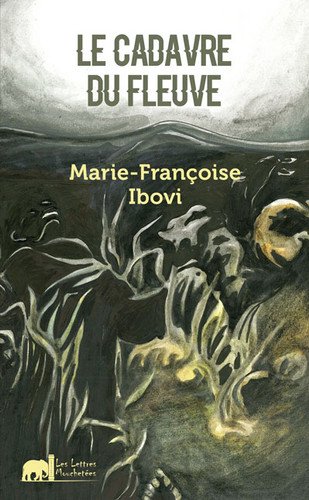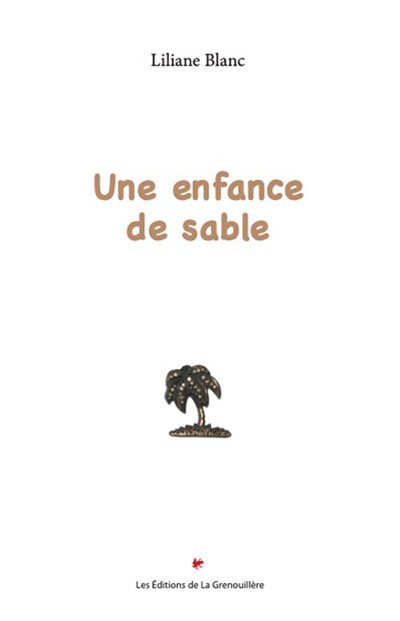Un récit, qui, page après page, nous rappelle, de manière lancinante, l’axiome de Faulkner: « Le passé n’est jamais passé; d’ailleurs il n’est même pas passé. »
Boniface Mongo Mboussa
Il existe bien des manières de dire l’histoire d’un peuple. L’une d’entre elles consiste à l’écrire : l’écrire pour la transmettre dans le temps et dans l’espace; l’écrire pour que désormais, on se réfère à elle pour penser le futur. L’autre consiste à la raconter oralement. Et cela, François Ondai Akiera l’a fait. Et, à l’appui de cette histoire, il y a la préface d’un des plus grands témoins contemporains de la culture orale et écrite du peuple congolais : Boniface Mongo Mboussa.
À cette mesure, Mwana okwèmet, le fétiche et le destin est donc une œuvre historique très réussie, car il met en avant des personnages non connus de tous; des personnages ayant marqué le parcours du peuple congolais dans la partie nord précisément. Commençons par dire que Et l’une des forces de la plume de François Ondai Akiera, c’est qu’elle se place au-delà du jugement, ce qui est d’ailleurs le propre de l’historien ou de celui qui rapporte des faits historiques. Il raconte.
Dans les premières lignes de l’œuvre, on se serait presque attendu à une mise en avant des personnages, tout simplement. Pas du tout, car la surprise se trouve exactement là; l’auteur met en évidence les querelles et contradictions d’une société esclavagiste près d’un demi-siècle avant la décolonisation.
Avec ce pan de l’histoire de l’esclavagisme, il aurait certainement été facile à l’auteur de se soumettre aux caprices d’un lectorat en quête de vengeance, toujours prompt à crier, à dénoncer, à pointer les maux de l’esclavagisme, le racisme ou autre chose du même acabit. Bien au contraire, Ondai Akiera se situe dans la mémoire et dans le souvenir pour éclairer le présent. Aussi, la principale qualité de ce roman totalement historique et totalement engagé, tient-elle peut-être à cette forme de narration qui met parfois dans le cœur du lecteur la nostalgie du conte ou d’un cours d’histoire informel. La jonction d’un talent manifeste pour le détail, les dates, les faits, l’importance des noms et pour la transmission comme mode d’accès aux événements dans ce qu’ils ont de primordial et de véridique, donne donc matière à ce roman authentique, maîtrisé, mémorable, mais dont chaque lecteur devrait se souvenir.
De quoi Mwana okwèmet est-il le nom ?
Pour le savoir, il faut revenir à Oba’mbe Mboundjet de Bèlet, l’un des personnages centraux du roman. Oba’mbe Mboundjet est un grand nom, un grand nom de ce début du 20e siècle. Comme tout grand chef de son époque, il a quatorze épouses et il possède le droit illimité d’enfanter. Lembo’o, l’une de ses épouses, est désespérée de ne pouvoir donner lui un enfant. Lorsqu’elle tombe enfin enceinte, A’Mbolo’o, l’oracle du village, prédit que la fille qui sortira de ses entrailles, Mwana Okwèmet, va traverser l’histoire et le siècle. Par ailleurs, Lembo’o est heureuse de donner enfin naissance à sa fille, Mwana Okwèmet.
En somme, Mwana Okwèmet est le nom d’un redoutable fétiche… que le chef Oba’mbe Mboundjet, donne son nom à sa fille pour la mettre sous la protection du fétiche…
Le roman de François Ondai Akiera est un roman qui regorge de diverses qualités comme le rappelle Mongo Mboussa dans sa préface :
Malgré le nombre vertigineux de ses personnages (certains sont sommaires), qui nécessiterait peut-être un glossaire, Mwana okwèmet est un roman séraphique par son ton soutenu, sa langue ronde, la puissance de ses dialogues, l’usage dosé de l’ironie, le refus du pathos, etc. Autant d’ingrédients qui participent de la réussite de ce beau récit.
Si un apparent ennui nous envahit au milieu de la lecture, il s’agit en réalité d’un ennui qui au fil des pages constitue l’une des principales vertus du roman : un travail fouillé, précis et logique. Car si cette façon intentionnellement tangible ou allégorique de rapporter des faits, dont certains sont enfouis, voire dramatiques, consent à contenir habilement le lecteur dans une médiation délicate, elle semble surtout méthodique. Moyennant quoi, le style peut parfois apparaître un peu académique à force d’être référencé, et donner l’impression d’être dirigé vers le domaine didactique. Autrement dit, le besoin de l’exactitude et de la recherche. Or, c’est là où se trouvent aussi l’empreinte et le charme du roman. Autrement dit, pour un lecteur minutieux, la consistance du roman est entre les lignes, dans chaque détail, dans chaque mot. Ce qui autorise d’ailleurs quelques admirables bouts d’énergie, telle la référence à l’esclavage dans cet extrait ci-dessous :
La société mbochie n’étant pas à une contradiction près, l’esclavage, le déracinement et la transplantation des habitants étaient admis et tolérés, mais l’enlèvement à proprement dit était considéré comme un acte criminel qui exposait son auteur à des représailles
Entrer dans Mwana okwèmet Le fétiche et le destin sollicite donc le lecteur bien davantage que ce que la complaisance intrinsèque du récit pourrait lui laisser présupposer. Car il est question d’un roman historique qui mobilise des notions et un style qui demande une certaine attention. Le ton adopté permet à l’histoire de Mwana okwèmet, témoin, victime, femme puissante et héroïne, de mêler une histoire clanique au panorama historique de la République du Congo en général et du peuple mbochi en particulier. C’est un roman dont je recommande vivement la lecture.
P.S. L’auteur a prévu un glossaire des personnages à la fin du livre
Nathasha Pemba, 22 mai 2022