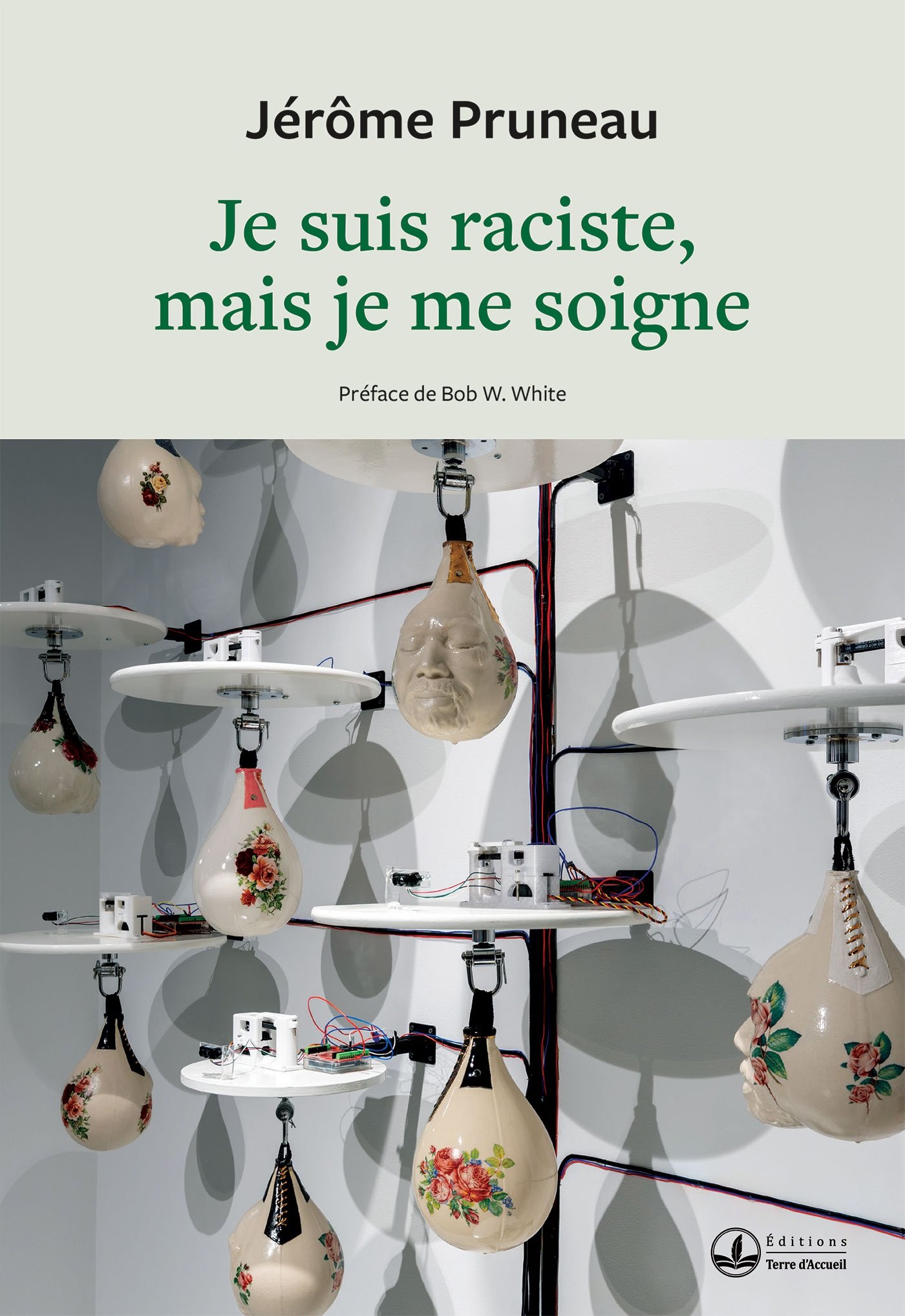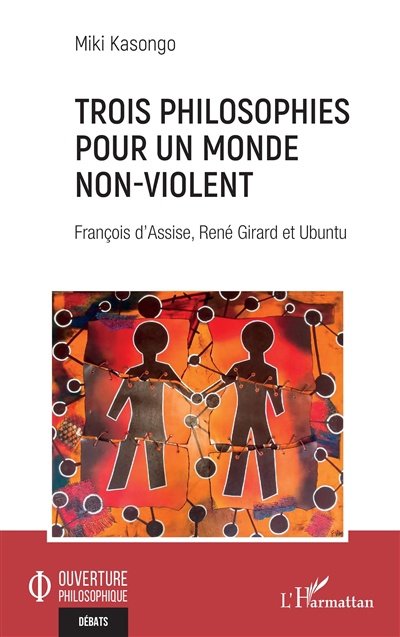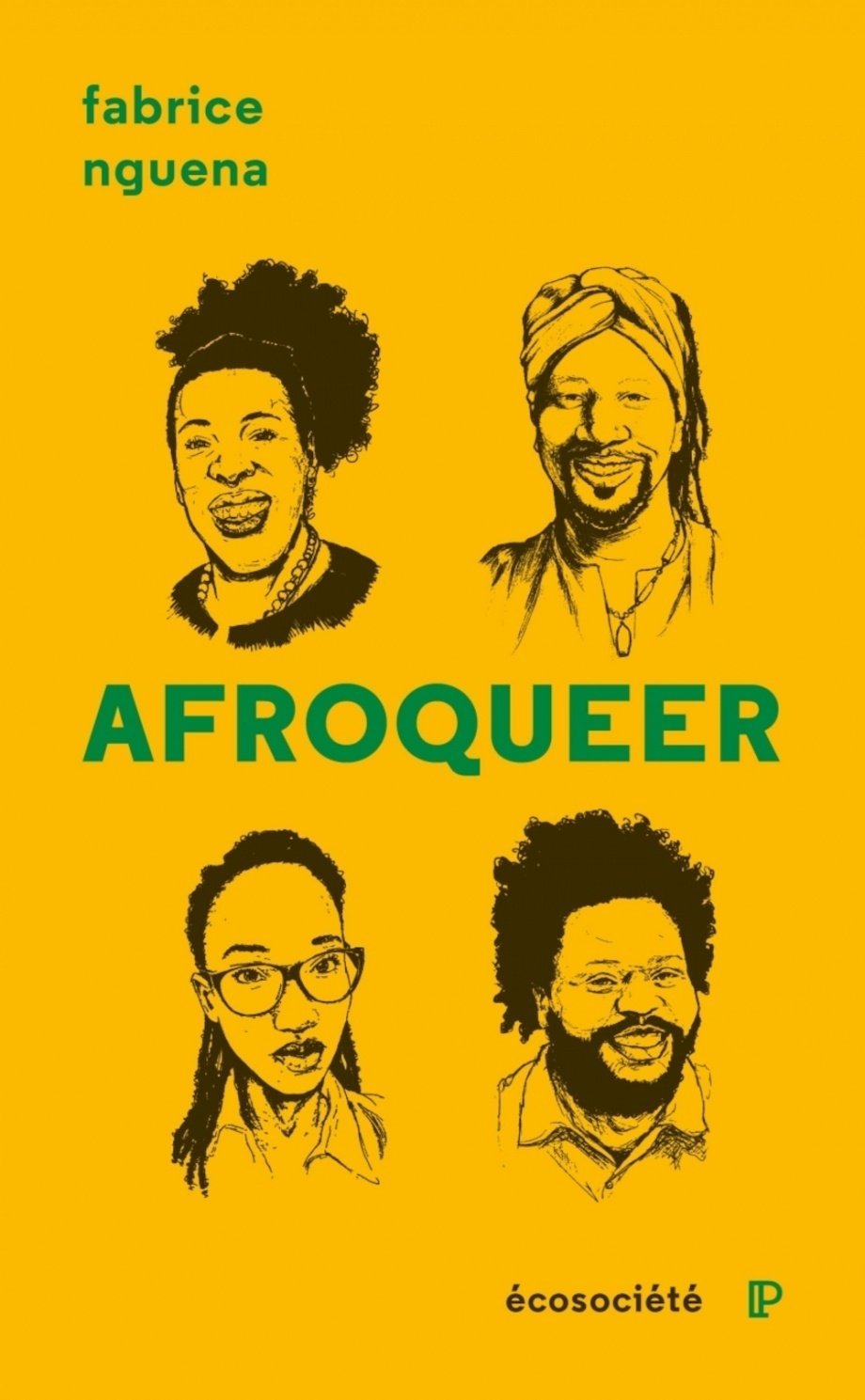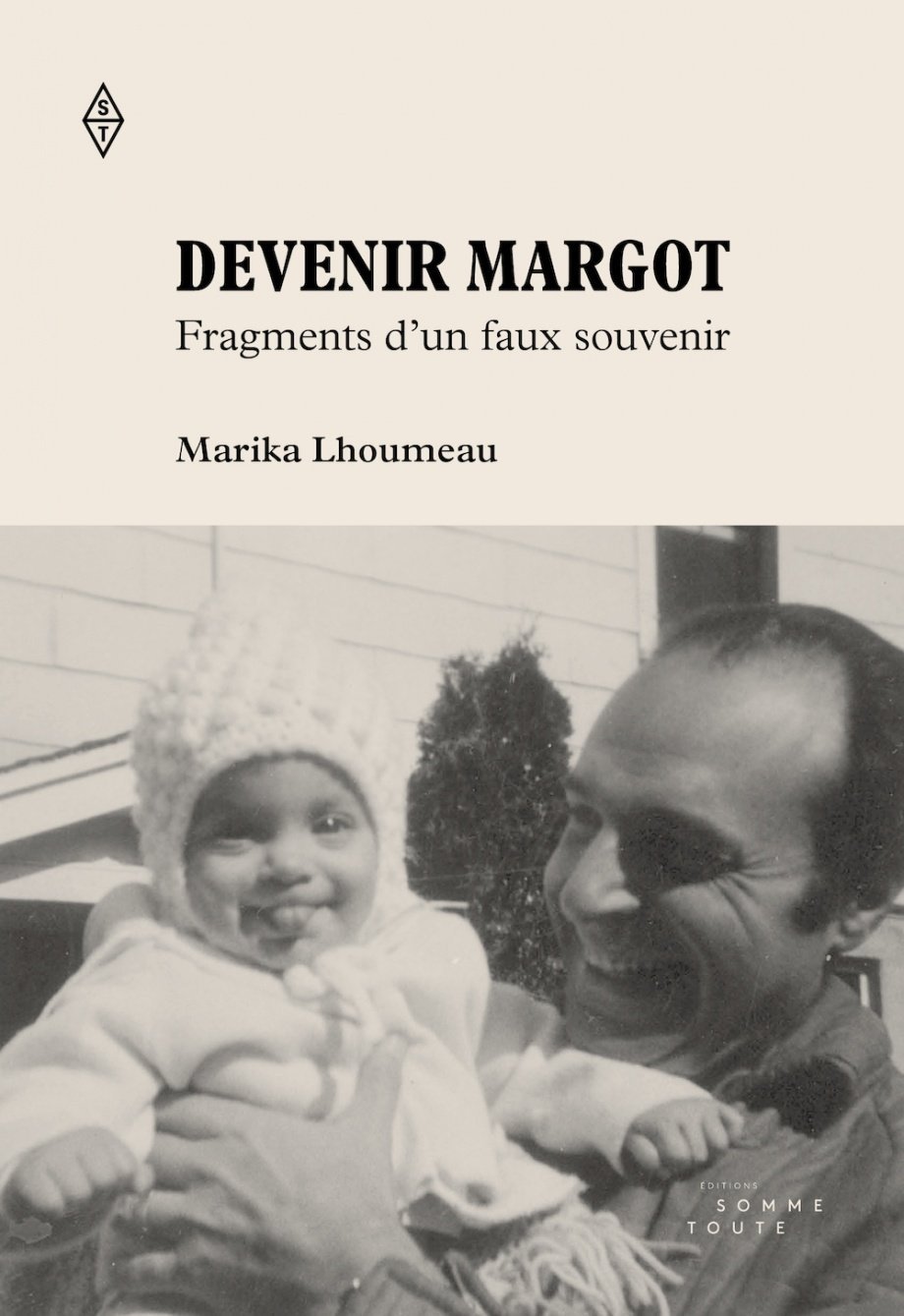Je remercie l’éditeur pour le service de presse de cet essai. J’ai lu ce livre à trois reprises. Je voulais, en tant qu’immigrante et philosophe (sociale et politique de formation travaillant sur l’interculturel et les questions du vivre-ensemble), me situer dans ce texte. Je ne sais pas si j’ai réussi, mais je peux avouer que le livre est très riche, une expérience personnelle (la famille de l’auteure) croisée avec celles d’autres, mais aussi avec le Canada son pays et le Québec sa Province.
Le récit contre-récit : identité narrative et reconnaissance (Ricœur)
Au cœur de Nous, les autres se trouve une tension narrative : celle qui oppose le récit national dominant, qui se veut inclusif, égalitaire et accueillant, au contre-récit des exclus, celui des immigrants, souvent perçus comme une menace culturelle ou économique.
Toula Drimonis écrit :
« Nous aimons croire que nous sommes accueillants et gentils à l’égard des nouveaux arrivants. C’est l’histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. »
Ce passage évoque directement la problématique ricœurienne de l’identité narrative : toute collectivité construit son identité à travers un récit partagé. Mais ce récit peut devenir un instrument d’exclusion, lorsqu’il marginalise certaines voix ou efface des épisodes dérangeants. Drimonis adopte ici une posture critique proche de celle que Ricœur appelle « la mémoire blessée », et qui appelle une justice narrative.
La reconnaissance, chez Ricœur, ne se limite pas à l’acceptation abstraite de l’Autre : elle implique le travail de mémoire, la reconnaissance des torts, et la réintégration des voix oubliées dans le récit collectif. En dénonçant les lois discriminatoires comme la Loi 21 ou les discours politiques qui essentialisent l’immigrant comme « parasite » ou « menace », Drimonis réclame une telle reconnaissance.
Appartenance et reconnaissance : la politique du respect (Taylor)
Charles Taylor a défendu l’idée que la reconnaissance des identités culturelles est un besoin humain fondamental. Le déni de cette reconnaissance produit des effets d’aliénation, d’invisibilité sociale, et parfois, de radicalisation.
Dans cette optique, Nous, les autres apparaît comme un manifeste pour la reconnaissance, et non la simple tolérance. Toula Drimonis insiste :
« Il est temps que nous arrêtions de dicter aux immigrants leurs comportements et, en fin de compte, leur avenir. […] Considérons-les comme une partie du tout. »
Ce que Taylor appelle « la politique de la reconnaissance » repose sur l’idée que l’État, loin de neutraliser les différences, doit les valider publiquement. Or, la Loi 21 sur la laïcité, en interdisant certains signes religieux dans l’espace public, est perçue par Drimonis comme un refus de reconnaissance active, déguisé en neutralité.
Elle rejoint ici Taylor dans sa critique des conceptions trop rigides de la neutralité républicaine, qui tendent à exclure les différences visibles et à instaurer une hiérarchie culturelle implicite, où la norme est toujours celle de la majorité.
Multiculturalisme et justice libérale : Kymlicka et l’éthique de l’intégration
Toula Drimonis revendique explicitement une posture multiculturaliste. Elle refuse l’assimilation comme horizon indiscutable de l’intégration. Ce refus ne traduit pas une opposition au vivre-ensemble, mais un attachement à une forme de justice pluraliste.
Will Kymlicka, dans ses travaux sur le multiculturalisme libéral, soutient que les droits individuels ne suffisent pas à garantir la justice si l’on ignore les conditions culturelles de leur exercice. Les individus ne peuvent exercer leur liberté qu’au sein d’un cadre culturel reconnu. Cela suppose que l’État n’est pas neutre face aux cultures : il doit activement soutenir la diversité culturelle comme infrastructure du choix.
Drimonis reprend cet argument sur un mode journalistique et personnel :
« Il n’existe pas de recette infaillible pour une politique d’immigration idéale, parce que les ingrédients et les invités changent constamment. »
Elle reconnaît la complexité de la cohabitation culturelle, mais s’insurge contre l’exigence d’assimilation unilatérale imposée aux immigrants, souvent au nom de la sécurité, de la cohésion sociale ou de la laïcité. Ce faisant, elle rappelle que la diversité n’est pas un problème à résoudre, mais une réalité à accueillir politiquement.
Une éthique de l’altérité : au-delà de la tolérance
En filigrane de tout l’essai se dessine une éthique de la responsabilité envers l’Autre, proche de celle d’Emmanuel Levinas. Toula Drimonis affirme :
« Une chose n’a pas à être écartée ou crainte simplement parce qu’elle est différente. »
Ce refus de la peur de l’altérité, ou de la suspicion automatique envers ceux qui ne partagent pas les codes majoritaires, fonde une véritable éthique de l’hospitalité. L’Autre ne doit pas être réduit à une identité figée, à une catégorie administrative ou à un stéréotype culturel, mais reconnu dans sa singularité évolutive.
L’essai devient alors un plaidoyer pour une démocratie de la coexistence, où la différence n’est ni folklorisée, ni contenue, mais traitée comme co-constitutive de la société.
De la mémoire blessée à la citoyenneté partagée
Nous, les autres est bien plus qu’un essai politique ou journalistique : c’est une interpellation philosophique adressée à nos institutions, à nos récits fondateurs et à notre conception de la citoyenneté.
À la croisée de Ricœur, Taylor et Kymlicka, l’ouvrage appelle à :
- revisiter notre mémoire collective, pour y intégrer les récits d’exclusion (Ricœur) ;
- repenser la reconnaissance comme pilier de la dignité humaine (Taylor) ;
- reconfigurer nos institutions pour soutenir activement la pluralité culturelle (Kymlicka).
Ce faisant, Toula Drimonis nous contraint à répondre à une question essentielle : qui a le droit de dire “nous” dans une démocratie pluraliste ? Et, corollairement, qui reste toujours “les autres” ?
Mots-clés : xénophobie, reconnaissance, multiculturalisme, immigration, loi 21, Québec, Ricœur, Taylor, Kymlicka, altérité, citoyenneté.
Nathasha Pemba