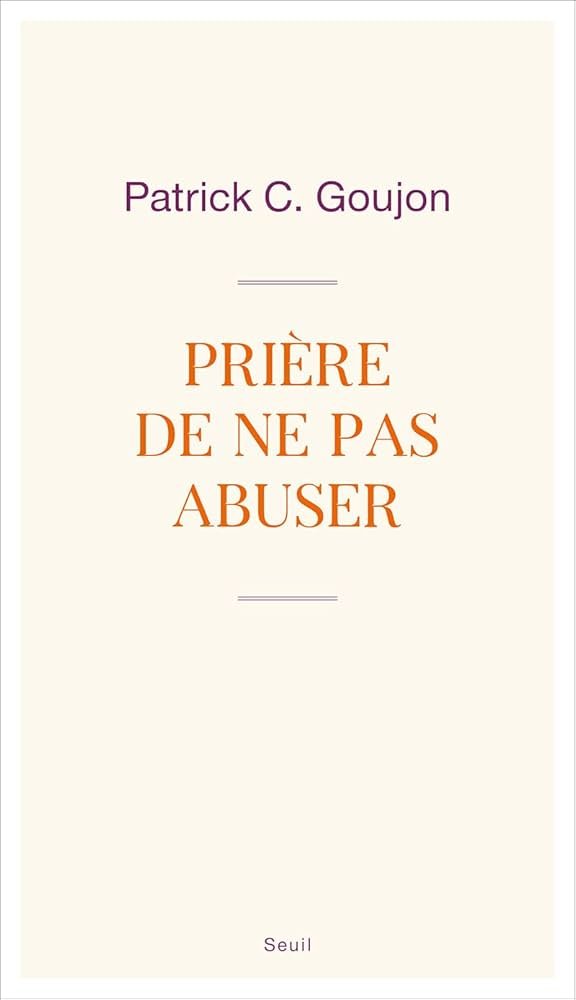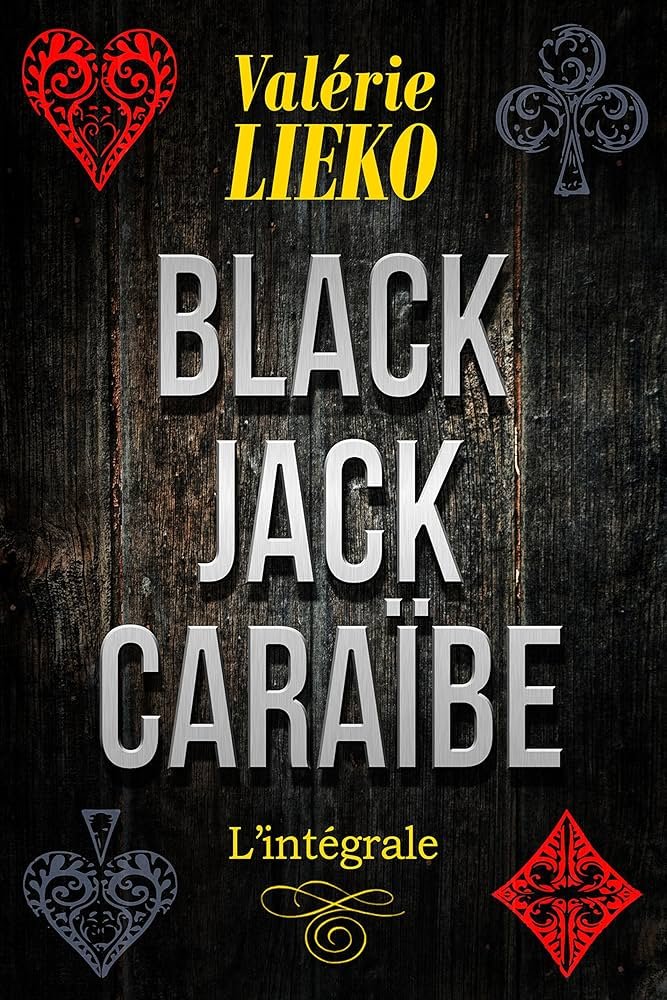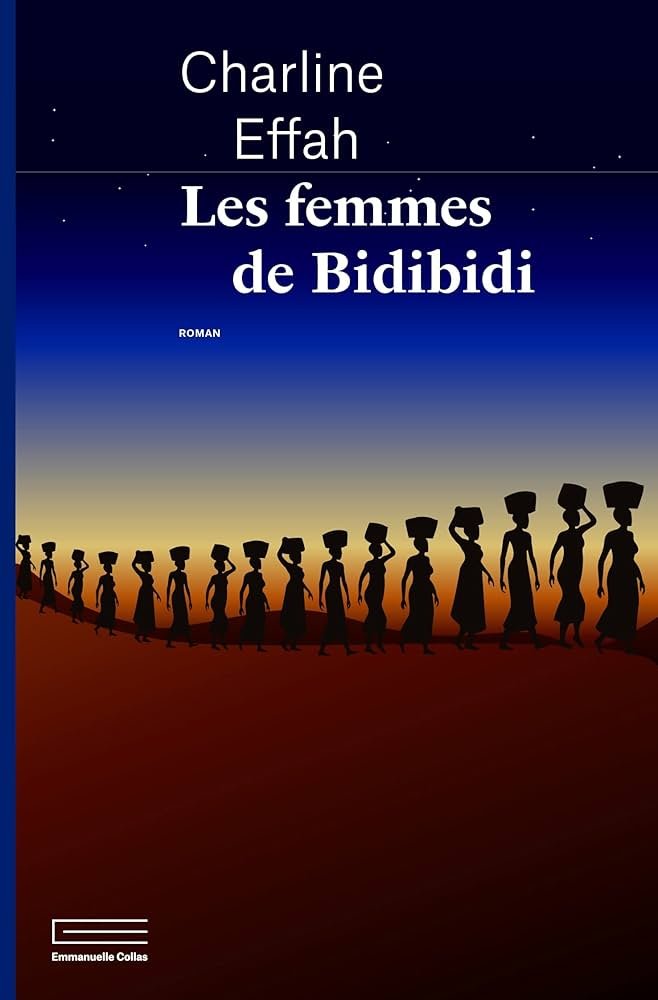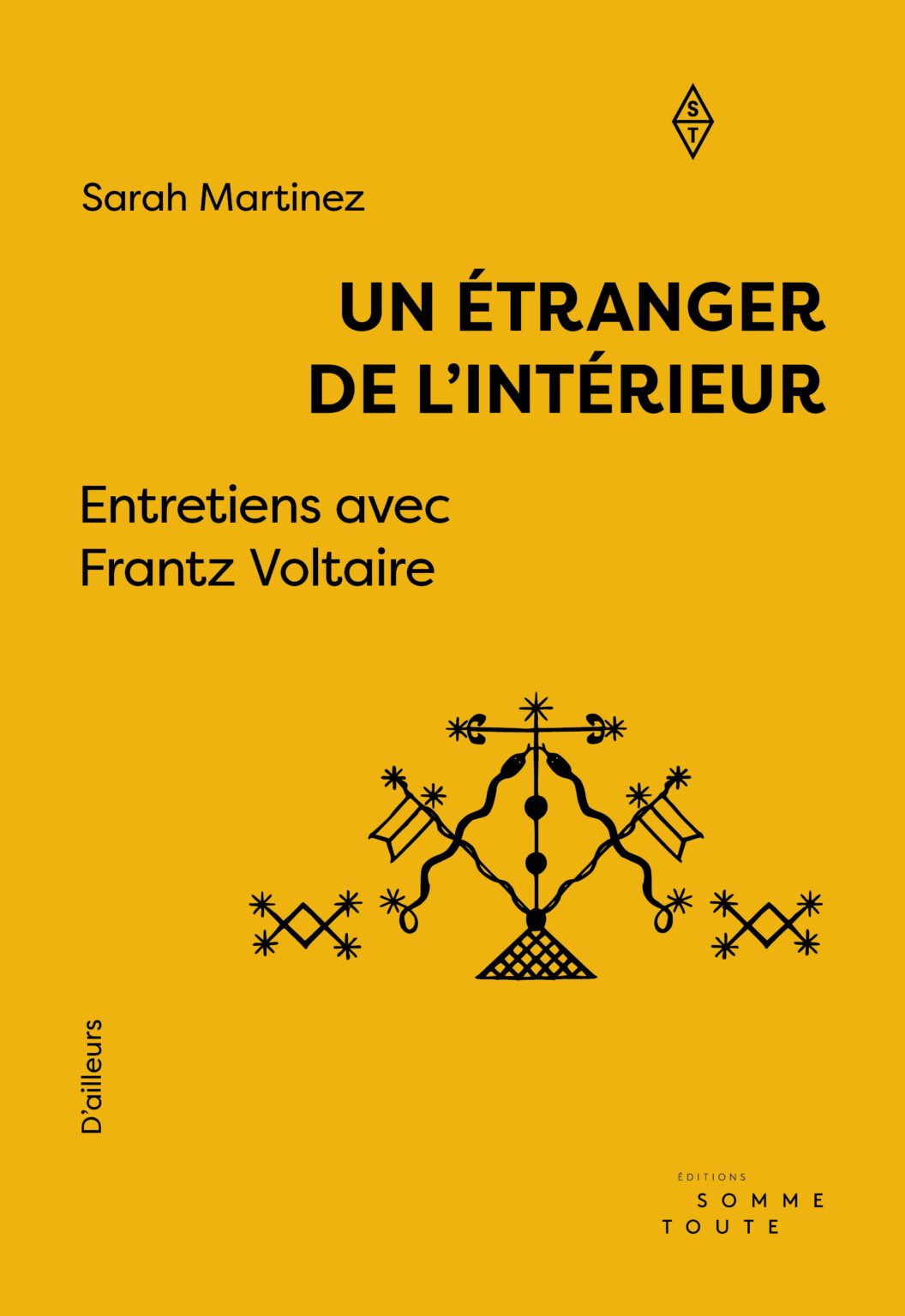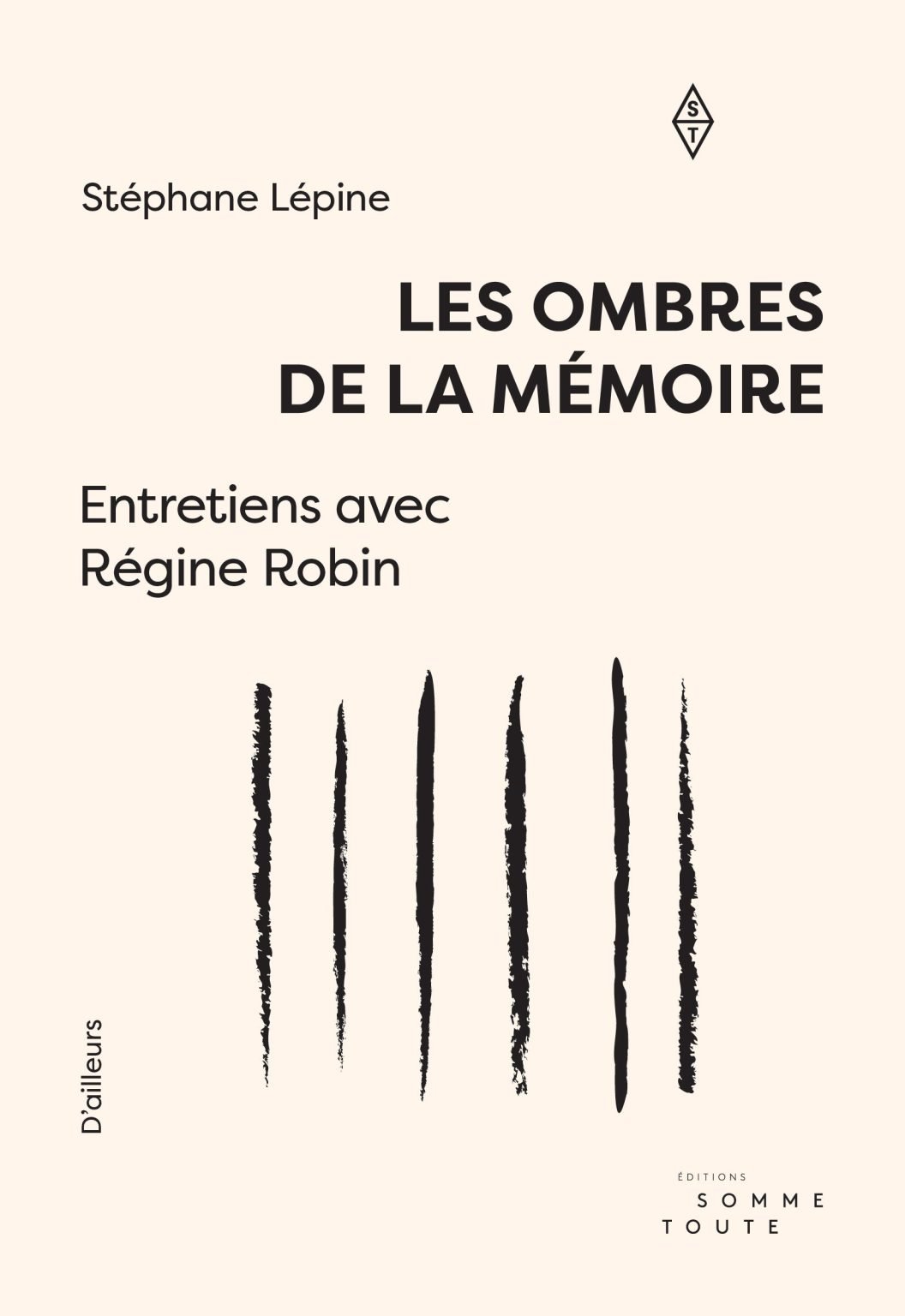Briser le silence, affronter la mémoire
Dans Prière de ne pas abuser, le jésuite et théologien Patrick C. Goujon livre un récit d’une sobriété saisissante : celui d’un homme confronté à la résurgence d’un trauma enfoui depuis l’enfance, l’agression sexuelle dont il a été victime de la part d’un prêtre. À travers une parole intime et d’une lucidité implacable, l’auteur retrace la lente émergence de la vérité, les ravages du déni, les douleurs physiques et psychiques, et surtout, le vertige existentiel de devoir reconstruire son identité à la lumière de cette révélation tardive.
Ce livre transcende le simple témoignage pour devenir une véritable exploration des mécanismes du trauma, un travail d’archéologie intérieure où se croisent psychologie, spiritualité et écriture poétique. Il s’inscrit dans la lignée des œuvres qui interrogent les liens complexes entre mémoire individuelle et responsabilité collective.
Le corps témoin : quand la chair se souvient avant l’esprit
L’un des aspects les plus remarquables du récit réside dans la manière dont Goujon décrit la somatisation du trauma. Bien avant que les souvenirs ne remontent à la conscience, c’est le corps qui témoigne : douleurs lombaires chroniques, tensions cervicales, inflammations inexpliquées, crises somatiques récurrentes.
« Le déni travaille : il fait grincer le corps entier. »
Cette inscription corporelle du trauma fait écho aux travaux de Judith Lewis Herman sur les Traumatismes et rétablissement, mais aussi aux recherches de Bessel van der Kolk sur Le Corps n’oublie rien. Comme ces auteurs l’ont démontré, le corps devient un territoire de mémoire, parfois plus fidèle et persistant que la conscience. Chez Goujon, cette dimension somatique n’est pas accessoire : elle constitue le fil rouge qui mène vers la reconnaissance de la vérité enfouie.
Le silence imposé à la mémoire finit par se loger dans la chair, révélant que la vérité traumatique n’est pas uniquement affaire de souvenirs narratifs, mais aussi de sensations, de blocages corporels et de symptômes inexpliqués qui résistent aux tentatives d’oubli.
L’identité fracturée : reconstruire le récit de soi
L’auteur ne se contente pas de relater un événement passé : il explore les conséquences existentielles profondes de l’abus sur la construction identitaire. L’événement, longtemps nié, revient avec une force dévastatrice, bouleversant l’ensemble du récit de vie, y compris le sens donné à son propre choix de devenir prêtre.
« Je me retrouvais face à un miroir brisé. »
Cette métaphore du miroir brisé symbolise l’explosion de l’unité du soi. L’enfant abusé, l’adulte croyant, le religieux engagé : toutes ces figures identitaires se télescopent dans une confrontation douloureuse. Cette fragmentation rappelle les analyses de Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre sur l’identité narrative : comment maintenir la cohérence d’un récit de vie quand un événement traumatique vient rétrospectivement en réorganiser tout le sens ?
Le récit devient alors une tentative patiente de réconciliation entre ces parts éparpillées de l’être. L’auteur refuse la solution de facilité qui consisterait à « tourner la page » ; il choisit au contraire de relire l’histoire à la lumière d’une vérité désormais assumée, dans un travail de réappropriation narrative qui évoque les réflexions d’Aldo Naouri sur la reconstruction après le trauma.
Une foi éprouvée, purifiée par l’épreuve
L’un des aspects les plus puissants du livre réside dans la manière dont la foi demeure présente, non pas intacte, mais épurée, interrogée, traversée par la douleur. Patrick C. Goujon ne rejette pas son appel à la vie religieuse ; au contraire, il le soumet à l’épreuve de ce qu’il a vécu, avec une honnêteté rare. Il questionne le sens du célibat, de la vocation, de l’institution ecclésiale – non pour démolir, mais pour purifier une foi incarnée.
« Le Dieu qui vient à nous est de chair et de souffle. Le chercher n’exile pas le religieux loin de son corps. »
Cette phrase résume un enjeu théologique central du livre : réconcilier le corps et l’âme dans la quête spirituelle, en refusant une religion désincarnée, oublieuse de la réalité du trauma, et parfois complice du silence institutionnel. Cette démarche fait écho aux travaux de théologiens comme Henri Nouwen ou Jean Vanier sur la vulnérabilité comme chemin spirituel, mais aussi aux réflexions de Marie Balmary sur les liens entre psychanalyse et spiritualité.
Une écriture de la retenue : la pudeur comme force poétique
Le style de Patrick C. Goujon frappe par sa retenue, sa densité, et une forme de poésie douloureuse. Il ose une parole « précaire », hésitante, mais profondément humaine. À travers des métaphores saisissantes (le miroir brisé, le son sourd du bloc, les ongles coupants du souvenir), il donne corps au trauma sans jamais verser dans le pathos ou l’exhibitionnisme de la souffrance.
Cette économie de moyens rappelle l’écriture de Charlotte Delbo dans Aucun de nous ne reviendra, ou plus récemment celle d’Édouard Louis dans ses récits autobiographiques. Il ne cherche ni à accuser gratuitement, ni à se complaire dans la douleur. Il écrit pour comprendre, nommer, et témoigner. La pudeur du style renforce paradoxalement la puissance du propos : c’est précisément parce que l’écriture ne crie pas qu’elle touche en profondeur.
Dénoncer sans s’enfermer : l’éthique de la parole imparfaite
Ce récit constitue aussi un acte de responsabilité civique et morale. Patrick C. Goujon finit par écrire à l’évêque pour dénoncer son agresseur. Il choisit de rompre le silence, tout en assumant courageusement la fragilité de sa mémoire, les « trous » inévitables dans le récit, les incertitudes qui demeurent.
« Ne pas laisser l’incertitude saper la détermination à dire. »
Cette phrase condense le courage de l’auteur : parler malgré le doute, risquer une parole imparfaite mais nécessaire. Cette éthique de la parole incomplète rejoint les réflexions de Giorgio Agamben sur le témoignage dans Ce qui reste d’Auschwitz, ou celles de Shoshana Felman et Dori Laub sur la nécessité de témoigner malgré les lacunes de la mémoire.
Le livre devient ainsi un acte de justice intérieure autant que publique, une manière d’ouvrir un espace de parole pour d’autres victimes prises dans le même silence.
Une œuvre d’urgence spirituelle et sociale
Prière de ne pas abuser est bien plus qu’un témoignage sur les abus dans l’Église : c’est un ouvrage spirituel et existentiel d’une rare profondeur qui dépasse largement le cadre du scandale ecclésial. Il nous parle de mémoire enfouie, de silence institutionnel, de reconstruction identitaire, et de foi mise à l’épreuve. Il nous rappelle que la vérité n’est jamais donnée d’emblée, mais qu’elle se travaille, s’arrache parfois au prix du corps et de l’âme.
Ce récit bouleversant, pudique et courageux mérite d’être lu non pas seulement pour « comprendre » les mécanismes du trauma, mais pour écouter une parole authentique sur la possibilité de renaître après la destruction. Il s’inscrit dans la lignée des grands témoignages sur la résilience humaine et la capacité de transformation du mal en chemin de vérité.
Suggestions de lectures complémentaires :
- Judith Lewis Herman, Traumatismes et rétablissement (sur les mécanismes psychologiques du trauma)
- Bessel van der Kolk, Le Corps n’oublie rien (sur la dimension somatique des traumatismes)
- Paul Ricœur, Soi-même comme un autre (sur l’identité narrative)
- Marie Balmary, Le Sacrifice interdit (sur les liens entre psychanalyse et spiritualité)
- Jean-Pierre Winter, Transmettre l’interdit (sur la transmission traumatique)
- Anne Lécu, Marcher vers l’innocence (sur la reconstruction après l’abus)
- Henri Nouwen, Le Retour de l’enfant prodigue (sur la vulnérabilité spirituelle)
- Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra (pour la comparaison stylistique)
- Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz (sur l’éthique du témoignage)
Nathasha Pemba