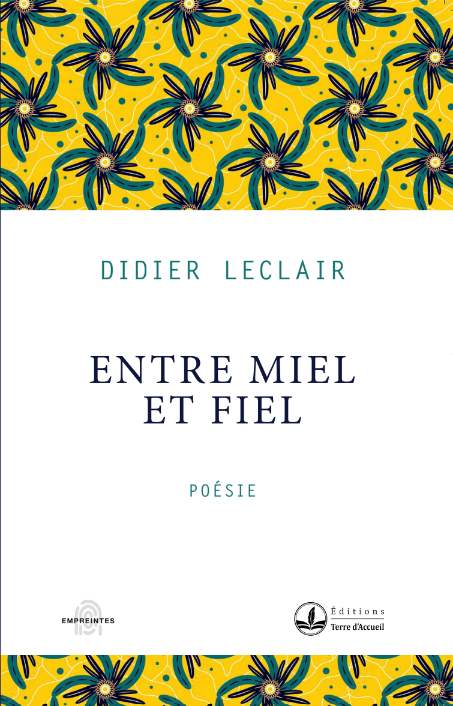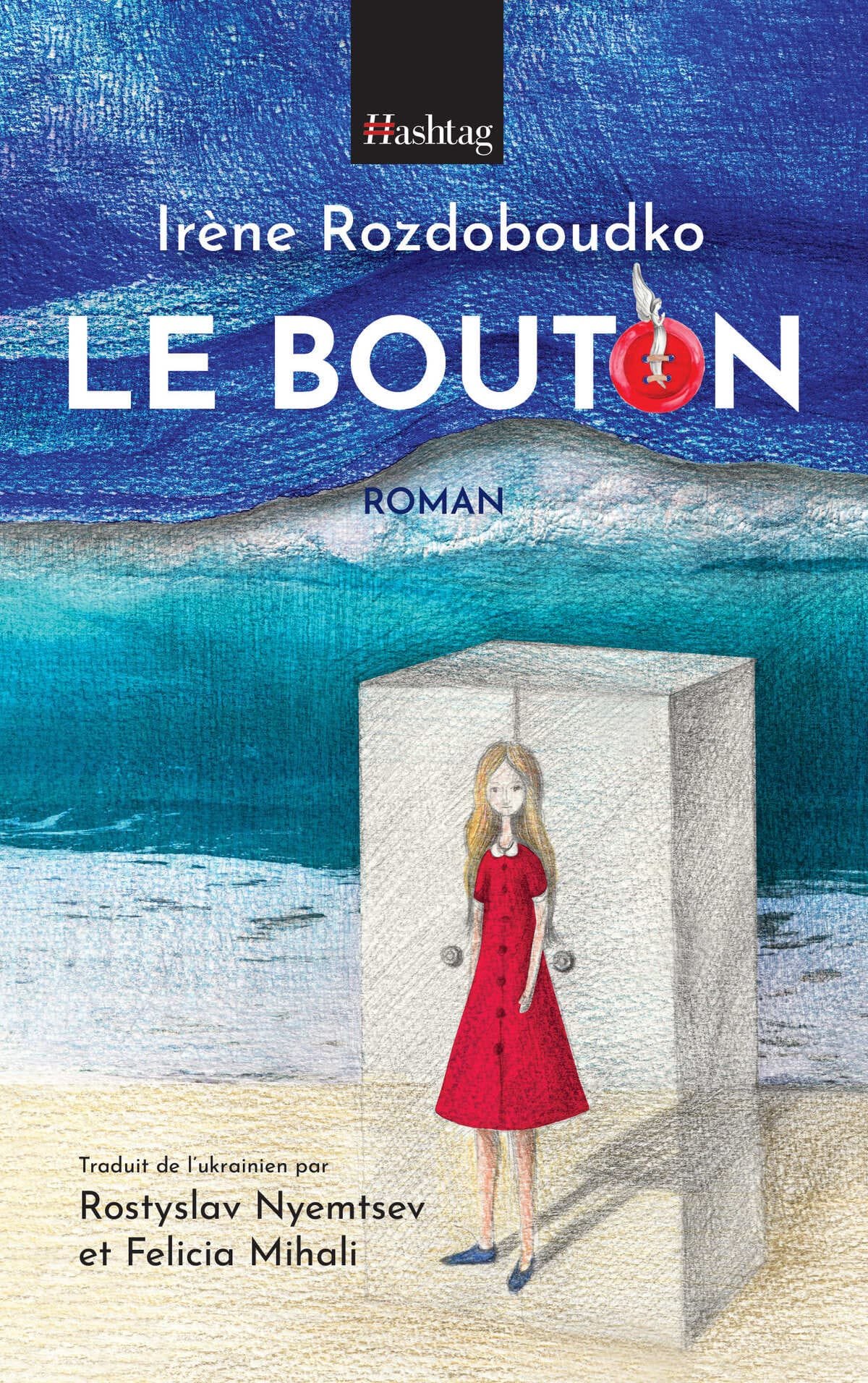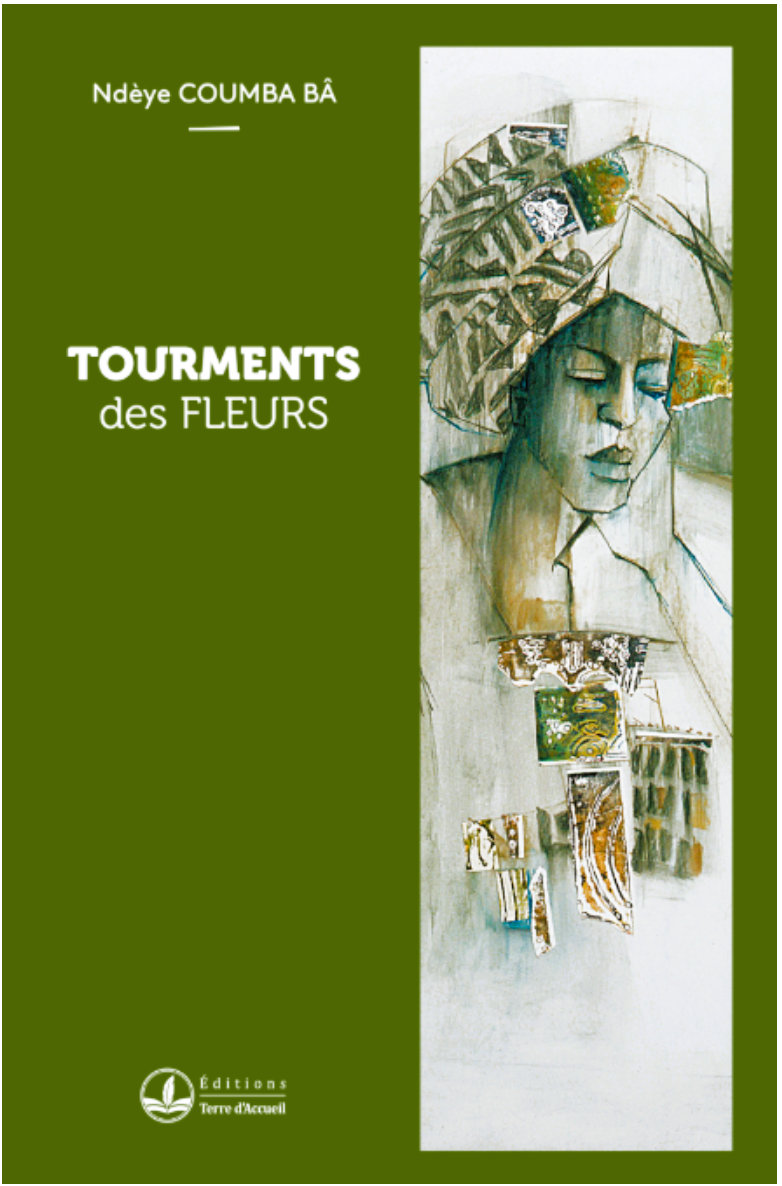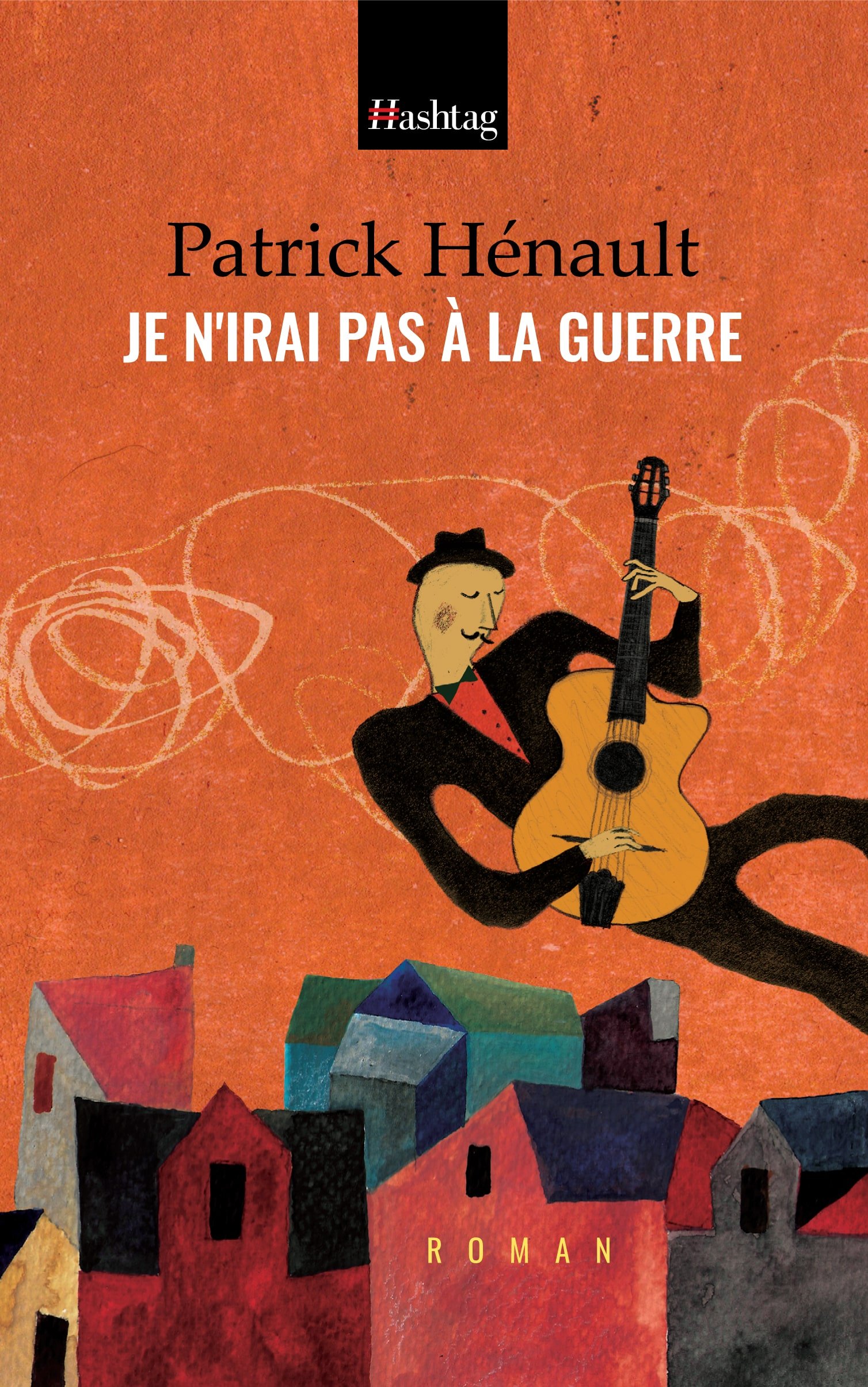Écrire une note de lecture sur un recueil de nouvelles est toujours un exercice délicat pour moi. Il me semble essentiel d’en dégager la thématique, de restituer l’essentiel sans trop en dévoiler. En même temps, mes lectures de fiction se teintent souvent de mes expériences en philosophie ou de mon amour du cinéma, qui m’amènent à ouvrir des brèches, tisser des liens, interroger les réalités. À ce titre, Vivre ou presque soulève des questions existentielles d’une rare acuité. Certaines nouvelles m’ont littéralement prise à la gorge…
Nicolas Weinberg ne se contente pas de raconter des histoires : il explore des existences en tension, en marge, suspendues entre ce que signifie vivre et ce que cela coûte. Les nouvelles qui m’ont le plus marquée reposent sur la fragilité de l’être et les tentatives, parfois vaines, de réconcilier le désir de vie avec la réalité brute de l’existence, mais aussi la question de ce que deviennent les organes d’un mort après qu’il soit parti.
Les sept textes partagent un même fil conducteur : la difficulté d’habiter pleinement sa propre vie. Ce n’est pas un hasard si la quatrième de couverture évoque une expérience de lecture qui « prend par la main ou à la gorge » : Weinberg joue sur cette oscillation entre l’intime et l’insoutenable, entre la tendresse et l’étreinte suffocante.
De Plotin à Heidegger : la difficulté d’exister
Le recueil dialogue subtilement avec deux figures philosophiques : Plotin et Heidegger.
Plotin, philosophe néoplatonicien, ressentait une forme de honte d’être dans un corps. Cette idée transparaît dans les récits de Weinberg, où les personnages sont enfermés – non seulement dans leur chair, mais aussi dans des relations, des émotions ou des situations qui les paralysent. Ils cherchent une échappatoire : dans l’amour, la mémoire, le parfum d’un monde plus doux, ou encore dans le silence…
Mais là où Plotin visait l’élévation vers un monde des Idées, les personnages de Weinberg sont ancrés dans une immanence douloureuse, plus proche de Heidegger. Exister, chez lui, c’est être « jeté-dans-le-monde », confronté à l’angoisse, à la mort, à l’absurde. C’est exactement ce que vit Réjean dans la nouvelle-titre. Atteint d’une maladie incurable, il expérimente la proximité de la fin non comme un anéantissement, mais comme un réajustement du regard. Il se détache de l’immédiat pour penser l’après – non pas le sien, mais celui des autres, notamment de son fils. Il devient presque survivant de son propre futur… presque trop tolérant.
Weinberg réussit ici une prouesse : faire de la mort non un événement, mais une condition existentielle et spirituelle. Elle annonce, prépare, sauve, rend la vie plus aiguë. Une question implicite traverse la nouvelle : comment vivre, en sachant que nous allons mourir ? Et surtout, que transmettre de ce qui doit durer ? Peut-on transmettre la parentalité elle-même ?
Une esthétique du sensible : l’odeur comme ontologie
La nouvelle Le Parfumeur du Comte, quant à elle, m’a emmenée ailleurs. Elle m’a prise par la main pour m’ouvrir à une sensualité discrète. L’odeur – ni bonne ni mauvaise – devient ici vecteur de mémoire, de désir, de soin. Le personnage de Marcus, en quête de senteurs, renoue avec une tradition philosophique rare : celle d’une phénoménologie du sensible, proche de Gaston Bachelard et de sa Poétique de l’espace. Pour Bachelard, chaque recoin, chaque texture, chaque odeur même, porte en lui un imaginaire.
Dans La Poétique de la rêverie, Bachelard affirme que l’odeur « a des racines plus profondes que nos simples souvenirs – notre enfance témoigne de l’enfance de l’homme ». L’odeur sans nom évoquée par Cendrine, l’amie de Marcus, devient promesse d’étreintes futures, ouverture vers une utopie douce. Là où la première nouvelle affrontait la rudesse de l’adieu, celle-ci parle de résistance, de beauté prolongée. Dans un monde de bruit, Weinberg choisit le murmure : celui d’une boîte, d’un buvard, d’un parfum.
Une écriture de seuil
Ce qui relie toutes les nouvelles, selon moi, c’est la position liminale de leurs personnages : entre vie et mort, entre enfance et maturité, entre naturel et artificiel. Weinberg écrit sur ces zones de bascule, ces instants où un geste, un mot, une odeur, peuvent tout faire chavirer. Il ne cherche pas à clore, mais à ouvrir : à laisser place à l’inconfort, à l’indéfini.
Vivre (ou presque), mais penser entièrement
Vivre ou presque mérite d’être lu non pour ses intrigues seules, mais pour sa portée existentielle. Il nous renvoie à nos propres lignes de fuite, à nos nœuds silencieux. Entre l’angoisse de la finitude selon Heidegger et la sensibilité au monde de Bachelard, Weinberg transforme la nouvelle en espace philosophique, sans jamais verser dans l’abstraction.
À lire comme on respire une odeur rare : lentement, intensément.
Je le recommande.
Nathasha Pemba