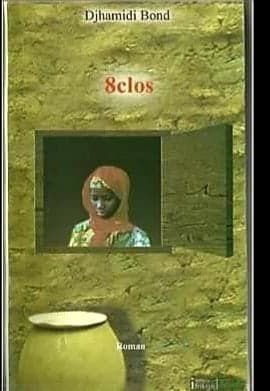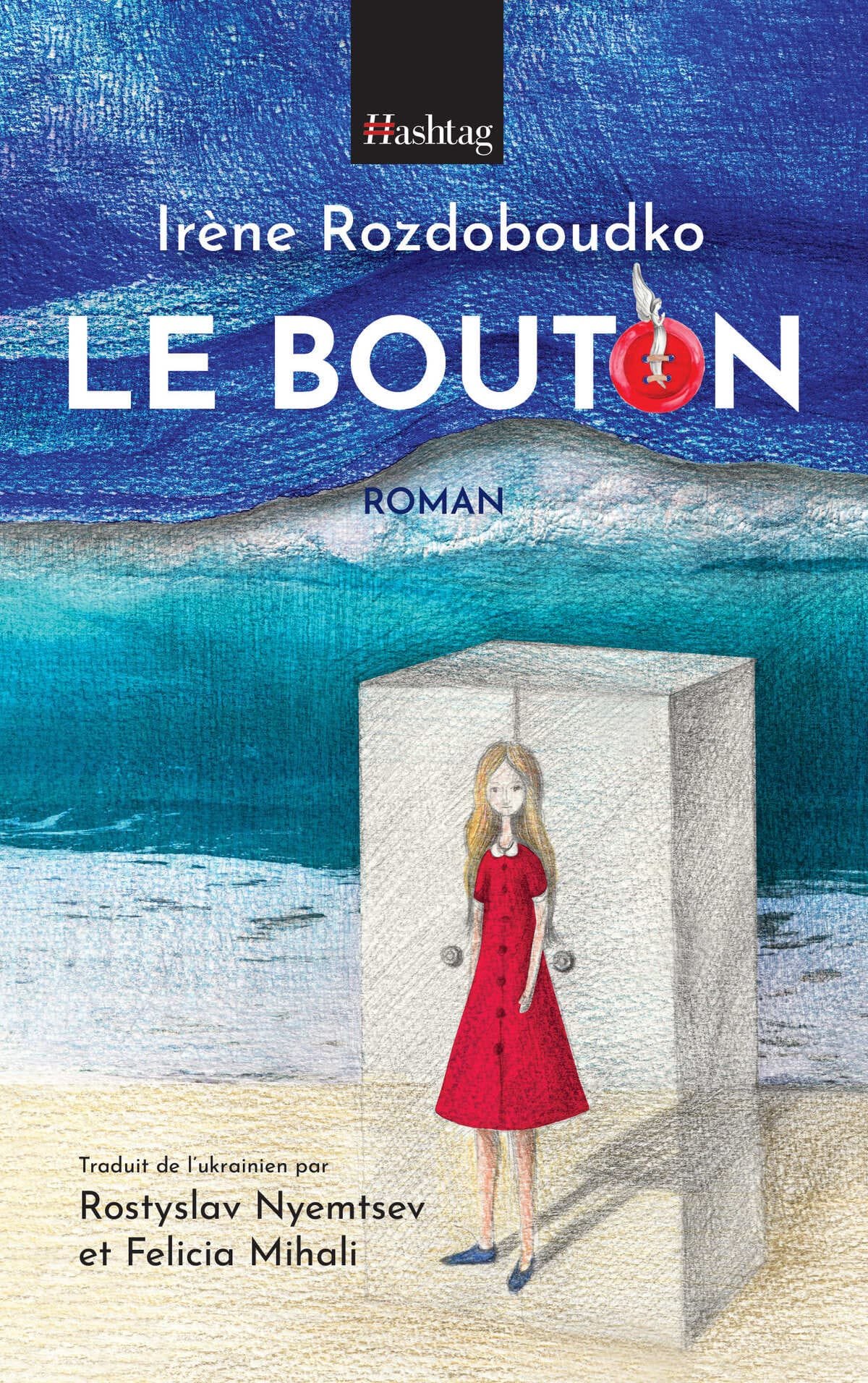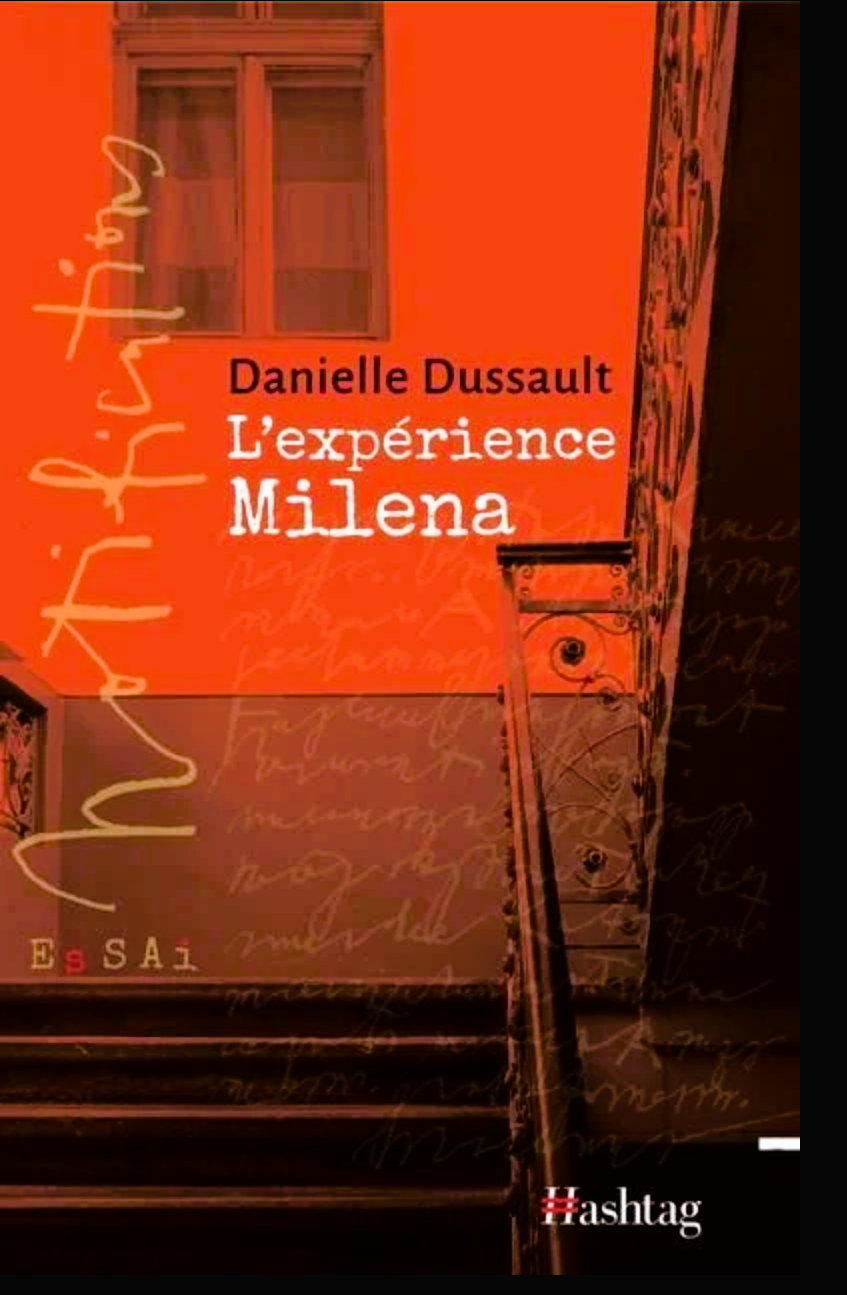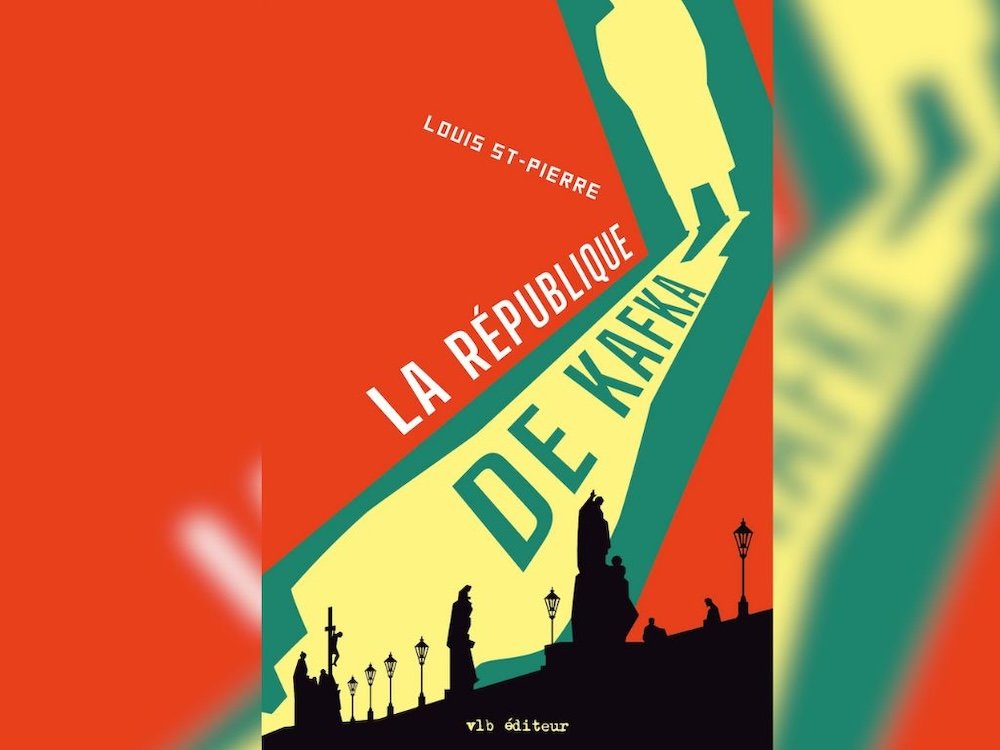À
l’aune de la modernité, les failles que présentent plusieurs us et coutumes de l’aire géographique du septentrion camerounais et ses corollaires tapis dans le reste de l’Afrique, du monde, sont indubitablement légion. Entre la non-scolarisation de la jeune fille, le mariage précoce et forcé, l’oppression masculine, en passant par la mutilation génitale, tout se mêle et s’entremêle dans 8clos de Djhamidi Bond. Après son premier roman qui l’a révélé au grand public : Amour et préjugés qu’elle publie chez L’Harmattan en 2014, Djhamidi Bond revient, on ne peut plus virulente avec un deuxième roman, 8clos, paru aux éditions Ifrikiya en 2016.
En effet, le livre s’ouvre sur les symptômes d’une mystérieuse grossesse de la narratrice. Un véritable mystère. Car, cette jeune fille qui n’a que quatorze ans, ne sort jamais de la grande et belle maison où elle vit avec ses parents jusqu’ici aimables et des employés, émasculés, dévoués à sa guise. Comment cela serait-il arrivé, d’autant plus qu’elle ne va même pas à l’école, et se contente de suivre des cours à la maison Toute naïve, la narratrice serait enceinte de « son grand frère Saïd », parfois en compagnie de son ami Moctar, qui venait expérimenter ses leçons de sciences avec elle. Face à cette situation, sa mère, Nazirah est sans voix. Elle craint le courroux de son mari; et décide d’envoyer sa fille en vacances dans le village de Zénabou, la ménagère, sous le fallacieux prétexte d’un simple voyage d’acquisition de bonnes manières pour savoir gérer un foyer. Ce qui se passe comme prévu; et la jeune fille finit par mettre au monde un enfant qu’elle ne reverra plus jamais.
Quelques mois plus tard, l’adolescente, de retour à la maison familiale, décide de se venger de son « bourreau » de frère Saïd, en lui plantant « férocement » un couteau dans son membre dur (son sexe), qui sera amputé par la suite, pour cause d’une infection. La jeune fille ne regrette pas son acte, malgré l’inimitié désormais régnante entre sa mère et elle, qui la poussera dans les bras d’un homme, Karim, un choix de ses parents, qu’elle est obligée d’accepter pour enfin vivre sa liberté, le dernier avatar qui manquerait à son bonheur. Une peine perdue parce que, son mariage est un véritable « enfer ». Non seulement Karim n’est pas l’homme qu’elle pensait pouvoir dompter, mais aussi, elle ne peut plus faire d’enfants à cause de son accouchement secret qui se serait mal passé; et pourtant on la croyait encore vierge avant son mariage. Un pot aux roses qui est découvert par le docteur Umar, son « beau-père » qu’elle adule presque. Un secret pouvant en cacher d’autres, tout s’écoule comme un château de cartes autour de l’héroïne qui est obligée de constater que sa famille couvait plein de secrets et de mensonges depuis des lustres : Umar est son père géniteur et par conséquent, Saïd n’est pas son frère, Karim non plus.
Un constat
Ce roman se dresse comme un miroir que Djhamidi Bond traîne le long des sociétés d’obédience musulmane, pour nous présenter l’image et la place de la jeune fille. Déjà, nous pouvons la percevoir à travers le titre « 8clos », entendu non seulement comme un « huis-clos », qui pré-visage et prédéfinit une vie dans un enclos, dans un lieu fermé; mais aussi comme l’expression de cette vie traduisant la nature des relations qu’entretiennent « 8 » personnages (la narratrice, Ally, Nazirah, Saïd, Zenabou, le cuisinier, le gardien et le chauffeur) vivants dans une maison close. De fond en comble, il s’avère que, dans plusieurs familles musulmanes traditionnelles, la jeune fille est frappée par une vacuité caractérisée de maints privilèges (la scolarisation, la liberté entre autres) qui pourtant sont la chasse gardée de « l’oppresseur », le sexe opposé. De manière ponctuelle et assidue, des actes de violence palpables de tout bord (psychologiques, morales, physiques) qui lui sont copieusement servis au quotidien, contribuent à consolider et à raviver la flamme de la « stéréotypation idéelle » qui s’accoude sur la conception surannée de l’existence d’un être au sexe faible (la femme), dont la toile de réussite est tissée par l’homme. Autrement dit, il s’agit là de la configuration d’une « phallocratisation béante » où l’avenir-devenir de la femme devrait être drainé par l’homme, à qui tous les droits et pouvoirs sont légués de facto. C’est ainsi qu’elle reste reléguée au second plan et joue toujours les seconds rôles même lorsqu’il est question des décisions cruciales et intrinsèques à son existence. Et pourtant, il est clair que, les conséquences sont innombrables. La preuve, l’héroïne jouit d’une naïveté indescriptible qui la rend vulnérable à toute intempérie masculine jusqu’au point où elle tombe enceinte sans s’en rendre compte, ce qui aurait été différent si elle était scolarisée. Tout cela démontrant que la solution pour la garder vierge et forger son éducation matrimoniale, n’est pas de la laisser enfermée. Ce d’autant plus que, ce qu’on redoute tant peut toujours arriver de la manière la plus insoupçonnable, car, « l’homme est condamné à être libre » (une pensée chère à Jean Paul Sartre) et il peut l’être même dans les geôles.
Un moyen
L’écriture se voulant une arme contre la marginalité, l’auteure s’en sert à bon escient, comme un speaker, pour faire entendre sa voix. La voix des minorités. La voix des opprimées. La voix des femmes qui, parfois, se cachent pour pleurer. La voix de celles qui pleurent en silence. La voix de toutes celles qui, apeurées, n’ont pas le courage d’avouer tous les viols dont elles sont victimes. La voix de toutes celles dont les cœurs sont inondés de larmes invisibles à cause des meurtrissures de la stigmatisation.
En effet, l’un des plus grands mérites de ce fait littéraire, c’est son intimisme. L’auteure, en toute minutie, parvient à nous tremper dans le vaste océan, au combien dédaléen, de l’intimité féminine à travers notamment l’enfantement avec toute sa souffrance et ses manifestations, la vie dans un mariage polygamique où le Walaande, l’art de partager un mari (premier roman de Djaïli Amadou Amal) est loin d’être une prairie fleurie. Et ce, dans la mesure où il égrène un long chapelet de frustration, de traumatisme et même de banalisation du corps féminin qui, faudrait-il le rappeler, est certes différent du corps masculin dans sa constitution, mais a les mêmes réclamations sensationnelles et pulsionnelles.
Par ailleurs, la narration de ce roman est portée par « un nom personnel » (Benveniste) : « je », dénudé et dépouillé de toute référence dénominative. C’est-à-dire, tout le narré durant, on n’aperçoit nulle part le nom de celle qui raconte l’histoire; tout ce qu’on sait c’est qu’il s’agit d’une adolescente de quatorze-quinze ans. Ce « je-narratrice », est en réalité une non-personne, non pas dans le sens benvenistien (absence de subjectivité), ce qui serait d’ailleurs contradictoire, mais plutôt dans une mesure où il ne renverrait pas à une personne imputable à un espace précis. Loin d’être un simple fait de hasard, ce procédé stylistique et esthétique se pose plus comme une intention plausible de la romancière camerounaise, d’universaliser son acte d’écriture, en le débarrassant des carcans frontaliers et spatiotemporels.
Le portrait que l’auteure fait des personnages masculins de l’œuvre (Ally, Umar, Karim) nous laisse entrevoir la figure du personnage Djibril, le mari de Mina, dans Sous la cendre le feu d’Evelyne Mpoudi Ngollé. Tout comme Djibril, ils sont des « sous la cendre le feu », c’est-à-dire qu’ils présentent une image aimable et adorable qui se trouve véritablement aux antipodes de ce qu’ils sont au fond. Tout simplement une caractérisation de l’hypocrisie.
Une solution
Ce fait littéraire est loin d’être un caillou jeté dans la mer, au contraire. Elle vient s’ajouter à la longue liste des écrits littéraires qui gravitent autour de la revendication d’une meilleure condition féminine. Djhamidi Bond emboîte le pas à plusieurs autres Écrivaines africaines taxées de féministes (Mariama Bâ, Calixthe Beyala et autres) dont l’intérêt majeur est de redorer l’image de la femme. Au milieu de la beauté scripturale indéniable de ce livre, on a pu déceler entre les lignes, une once de vengeance contre le phallus. Il semblerait, selon l’auteure, que le sexe masculin est une arme d’assujettissement et d’aliénation qu’il faudrait éliminer pour un monde meilleur et équitable pour tous. À cet effet, l’émasculation serait donc la solution idoine pour mettre fin à cette domination masculine qu’elle décrie. C’est ce qui justifie les nombreux cas d’émasculation visibles dans le texte (Saïd, Ally, les employés), à travers lesquels nous parvenons à la conclusion selon laquelle, subtilement, l’auteure milite pour un féminisme d’émasculation.
En conclusion, 8clos est par conséquent un roman cathartique marqué par une thématique à travers laquelle chaque âme en détresse se représente et se reconnaît. C’est une glace, qui reflète l’image des uns et des autres, devant laquelle chacun se reconnaîtra et décidera, pourquoi pas, de porter sa pierre à l’édifice de construction d’un monde où le son du glas de la vassalisation de la femme retentira de fort belle manière.
Boris Noah