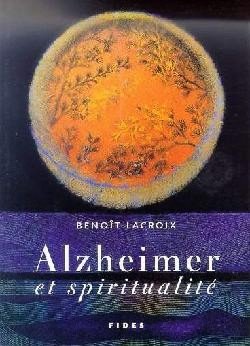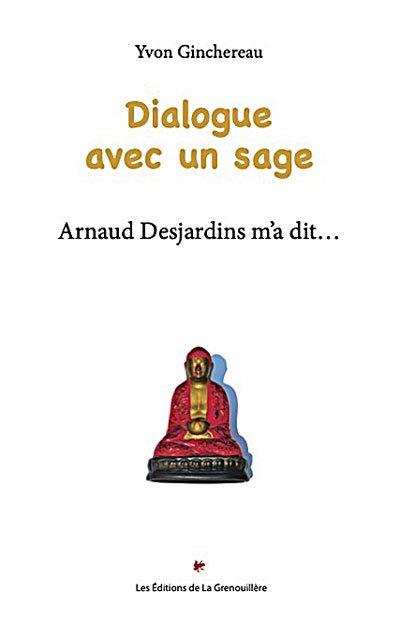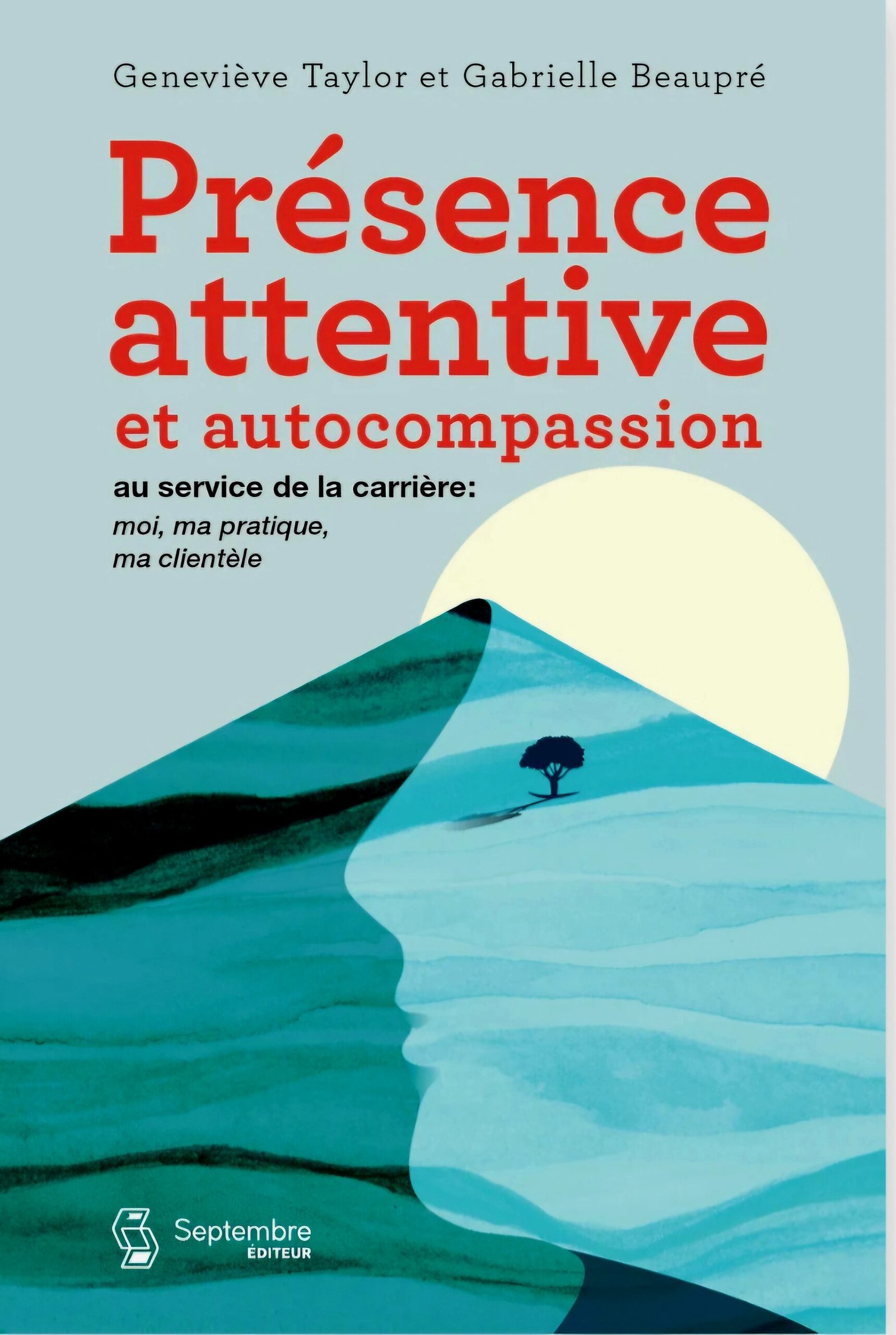À partir de deux témoignages touchants, ceux de Denise Lallich et d’Édith Fournier, Benoit Lacroix fait découvrir l’univers quotidien de ces personnes qui réclament la tendresse. Lallich, à travers ses expériences, montre comment les années de douleur et d’angoisse peuvent mener à un abandon-confiance en Dieu, trouvant la paix intérieure et, par extension, aidant le malade à mieux vivre sa condition. Fournier, de son côté, partage des moments de vie qui illustrent la nécessité d’une approche fondée sur l’amour et le respect.
Les personnes atteintes d’Alzheimer… les aimer jusque « dans leurs silences, leurs oublis, leurs culpabilités latentes, leurs doutes, leurs insécurités »[1] !
Veilleurs de nuit : une question de dignité
La thèse principale, défendue par Benoît Lacroix, est que la vie doit être conçue de manière à considérer toutes les personnes, indépendamment de leur état de santé, avec une dignité inébranlable. Il défend l’idée selon laquelle la dignité humaine n’est pas une abstraction, mais se fonde sur un ensemble d’aptitudes et de dispositions permettant de reconnaître certaines valeurs et d’aller à la rencontre de l’autre. Sont évoqués entre autres, les sentiments, les sensibilités, les perceptions, la conscience ou l’absence de conscience, l’expression, la contemplation, etc. Ces aptitudes ou dispositions impliquent un respect de l’autre, voire une sollicitude soutenue. Plus précisément, Lacroix propose : « Les êtres aux prises avec l’Alzheimer, quelle que soit la gravité de leur handicap, restent des êtres humains. Il nous appartient de respecter le mystère de leur étrange existence »[2]. Le respect de la dignité, précise-t-il, est une, sinon la prérogative de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Ce principe, selon lui, devrait être la base de notre relation avec les personnes atteintes d’Alzheimer, notamment lorsque nous les accompagnons. Cet accompagnement s’inscrit donc dans un ethos de solidarité, se manifestant par la patience, le respect et l’attention.
Lacroix soutient que la dignité humaine n’est pas simplement un concept philosophique ou juridique, mais une réalité vécue qui se manifeste à travers les interactions quotidiennes. La reconnaissance de la dignité inhérente de chaque individu, indépendamment de leur capacité cognitive ou physique, exige de nous une attitude de respect et de sollicitude constante. Ce respect, en particulier envers les personnes vulnérables, telles que celles atteintes d’Alzheimer, est non seulement un impératif moral, mais aussi un fondement de la vie en société. C’est par cette approche que nous affirmons notre humanité commune et construisons des relations basées sur l’empathie et la compréhension mutuelle.
Quoi qu’il en soit, la seule présence d’une personne marquée par l’Alzheimer dans un milieu de vie n’est-elle pas déjà un provocant appel à la solidarité, à l’amour qui invite l’héroïne des perpétuels recommencements. La fragilité de cet être nous oblige à nous interroger sur nos propres raisons d’être et de vivre. Peut-être serons-nous chacun, chacune invité. e à considérer la vie autrement, sinon ailleurs, ou même forcé de le faire[3].
Cette thèse de Benoît Lacroix s’appuie sur la capacité à développer une attention particulière, car la dépendance dans laquelle tombent parfois les personnes atteintes d’Alzheimer demande un dépassement de soi et une générosité toujours persévérante de la part de celui qui accompagne ou aide. Selon Lacroix, « leurs silences, leurs oublis, leurs culpabilités latentes, leurs doutes, leurs insécurités ne sont pas sans nous obliger à faire diverses mises au point. Surtout si leur présence est quotidienne et continue »[4]. Pour autant, la forme de spiritualité la plus conforme à cette dignité n’est pas figée ; « une spiritualité adaptée est possible et, en même temps qu’elle s’impose, elle doit respecter absolument nos divers cheminements intérieurs »[5].
Lacroix souligne que l’accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer exige une vigilance et une présence attentive, qui transcendent les simples soins physiques pour englober une dimension spirituelle et émotionnelle. Cette vigilance implique une reconnaissance profonde des silences et des oublis des malades, des sentiments de culpabilité latente, des doutes et des insécurités, qui nécessitent une adaptation constante et une réévaluation de notre propre attitude.
Cette approche requiert une forme de générosité qui va au-delà des gestes quotidiens, nécessitant une disponibilité de cœur et d’esprit. La spiritualité, dans ce contexte, ne doit pas être rigide, mais plutôt flexible, s’adaptant aux besoins uniques de chaque individu tout en respectant leurs divers parcours intérieurs. Cela signifie que, tout en accompagnant les personnes dans leur maladie, nous devons également respecter et honorer la diversité de leurs expériences spirituelles et émotionnelles.
En somme, Lacroix met en lumière une vision de la dignité humaine qui est profondément ancrée dans l’attention et le respect mutuel, affirmant que même dans la dépendance et la vulnérabilité, chaque individu mérite une considération pleine et entière. Ce respect de la dignité humaine est non seulement un impératif moral, mais aussi un appel à la solidarité et à la compassion, reflétant une humanité partagée et une spiritualité vivante et adaptable.
Le cœur de la spiritualité ou la mission domestique
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »[6]
Toute l’originalité de l’approche de Benoît Lacroix réside dans sa volonté de concilier la dimension missionnaire et domestique en se fondant sur la Loi fondamentale : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même »[7]. Lacroix suggère de manière convaincante que, quels que soient nos chemins et nos plans de vie, rien ne remplace l’amour pour donner de la valeur à une vie, à une action, à une personne, même touchée par l’Alzheimer. Cet amour est nécessaire, même pour les familles.
Une conception d’inspiration évangélique de l’amour apporte un fondement normatif explicite à la question de la dignité humaine, justifiant ainsi la nécessité de prendre soin des personnes atteintes d’Alzheimer. Lacroix s’appuie également sur le modèle de Baluchon Alzheimer[8], où les intervenants sont invités « à prendre une attitude d’écoute inconditionnelle, à poser des regards d’amitié silencieuse »[9]. Il perçoit le travail de l’accompagnateur comme celui de quelqu’un qui aime avant tout, considérant que chaque personne mérite respect et considération. Il affirme : « Aimons-les “enfants” qu’ils sont redevenus à la manière d’une mère attentive ou d’un père protecteur. Nous ne sommes pas en face d’un être atteint d’Alzheimer pour juger ou diagnostiquer, nous sommes là pour l’aimer »[10] ! Ainsi, il n’est pas question ici d’une évaluation médicale basée sur une grille prédéfinie.
Lacroix apporte à la pratique de l’accompagnement spirituel une dimension humaine, sociale et chrétienne, en s’inspirant du passage évangélique du jugement dernier, qui implique soins, attention, solidarité, dignité, prise de conscience, hospitalité et justice sociale. Il nous invite à une approche holistique et profondément empathique, où l’amour et la dignité sont au cœur de chaque interaction avec les personnes atteintes d’Alzheimer. Cette perspective transforme la manière dont nous percevons et pratiquons l’accompagnement, en soulignant l’importance d’une spiritualité vivante et adaptable, enracinée dans l’amour et le respect mutuel.
Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Comme on peut le constater, en citant ce texte du jugement dernier, Benoît Lacroix défend le droit à l’amour, à la solidarité et à l’attention pour tous, notamment pour les personnes atteintes d’Alzheimer. Il affirme d’ailleurs que « la spiritualité est à la portée de qui veut se rendre utile […] »[11]. Il offre une vision beaucoup plus ouverte, diverse, équitable et inclusive des conditions d’une vie digne pour toutes et tous. Par conséquent, pour jouir pleinement de leur dignité, les personnes doivent aussi considérer la dignité des autres.
Partant de ses observations et s’appuyant sur le témoignage d’Édith Fournier, Lacroix développe les cinq préceptes de Baluchon Alzheimer : l’invitation, le don, le respect, la discrétion et le sourire. Ces préceptes forment la base d’une approche qui valorise chaque individu et prône une interaction humaine fondée sur l’empathie et la bienveillance.
- L’invitation : Il s’agit d’accueillir l’autre avec ouverture et générosité, créant un espace où chacun se sent le bienvenu. (Lc 14,13)
- Le don : Cela inclut le temps, l’attention et l’affection offerts sans attente de retour, illustrant la pureté d’un geste altruiste. (Mt 5, 42)
- Le respect : Reconnaître la valeur intrinsèque de chaque personne, indépendamment de son état de santé, est essentiel pour préserver la dignité humaine. Tenir parfois compte de l’individualisation dans l’accompagnement (ou les soins).
- La discrétion : Maintenir une attitude de retenue et de respect pour l’intimité de l’autre, évitant toute forme de jugement ou d’intrusion. (Mt 6, 1 et suivant).
- Le sourire : Un geste simple, mais puissant, qui traduit la bienveillance et l’acceptation, contribuant à créer un environnement de réconfort et de joie. Sourire, parfois malgré l’indifférence de la personne atteinte.
Ces principes, selon Lacroix, sont essentiels pour garantir que chaque individu, y compris les personnes atteintes d’Alzheimer, puisse vivre dans la dignité. Ils incarnent une éthique de l’attention et de la solidarité, et illustrent comment une spiritualité incarnée peut se manifester dans des actions concrètes et quotidiennes. De cette façon, en intégrant ces préceptes dans l’accompagnement des personnes vulnérables, il propose une vision humaniste et inclusive de la dignité humaine. Il souligne que l’amour, le respect et la compassion ne sont pas seulement des idéaux à atteindre, mais des pratiques quotidiennes qui renforcent notre humanité commune et notre capacité à vivre ensemble de manière harmonieuse et juste.
Cette approche, profondément enracinée dans une éthique de l’attention, exige que chaque personne soit traitée avec une considération et une sollicitude constante. De ce fait, Lacroix insiste sur le fait que la spiritualité ne doit pas être une quête abstraite, mais une réalité vivante qui se traduit par des actes d’amour et de respect quotidiens. Chaque interaction avec les personnes atteintes d’Alzheimer peut être vue non pas comme une simple obligation, mais comme une opportunité de manifester notre humanité et de construire des liens authentiques. Adopter cette perspective peut transformer la manière dont nous percevons et traitons les plus vulnérables, en affirmant leur valeur intrinsèque et en contribuant à une société plus solidaire et compatissante.
Accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer : Pistes à partir du témoignage de Denise Lallich[12]
Aux yeux de Denise Lallich,
Accompagner, ce n’est pas guider ni précéder, c’est marcher à côté de l’autre, régler son pas sur le sien et se tenir prêt à l’aider, à le soutenir, autant qu’il est possible, dans la réalisation de son désir. On emploie couramment ce mot d’accompagnement en le délestant d’une partie de son sens. Accompagner, c’est apprendre l’humilité, c’est comprendre que notre savoir peut être inutile et peut parfois même être un écran entre l’autre et nous. Accompagner, c’est renoncer à avoir toujours raison. Et c’est difficile, car nous sommes dans une situation où nous prenons les décisions pour l’autre : jusqu’à la décision de le garder à la maison ou de le « placer », horrible mot, jusqu’à la décision de le laisser partir quand il ne peut plus rien avaler et qu’il est visiblement sur le seuil de la mort, ou de le maintenir en vie coûte que coûte[13].
Pour Mme Lallich, être proche-accompagnateur signifie souvent être l’une des rares personnes à accompagner une personne atteinte d’Alzheimer, en raison du lien ou de l’alliance du passé commun, de l’intuition et de l’amour qui se maintiennent. Cependant, cette alliance ne justifie pas que l’on coupe le malade des autres personnes, car cela peut entraîner une forme de prison relationnelle, pouvant créer une dépendance malsaine à long terme. Forte de son expérience, elle invite les proches de personnes atteintes d’Alzheimer à éviter de dépouiller ces dernières de leur autonomie, en respectant leur espace de liberté, afin de permettre leur expression, même avec des moyens désormais limités. Même en perte d’autonomie, faire du principe liberté le leitmotiv de l’accompagnement.
La confiance en la vie, dans ce cas, peut être un véritable soutien, car elle permet de comprendre que la vie nous dépasse, « qu’elle a existé avant nous, qu’elle continuera après nous, et que l’amour que l’on donne et celui que l’on reçoit forment des cercles autour de nous »[14] et peuvent nous permettre de survivre.
Lallich appelle à une attitude d’ouverture et de confiance en la vie, comprenant que la vie et l’amour transcendent nos existences individuelles. Ce principe, appliqué à l’accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer, encourage une approche équilibrée et respectueuse, où l’autonomie et la dignité de la personne sont préservées malgré les défis posés par la maladie.
L’abandon-confiance[15]
Mme Lallich explique comment les années de douleur et d’angoisse lui ont permis de découvrir l’abandon-confiance en Dieu, grâce à sa foi ; s’abandonner à suivre un chemin qu’elle n’a pas choisi et trouver la paix qui se répercute sur le malade dont elle a la charge. Comme elle le reconnaît, au départ, la maladie de son conjoint lui donne l’impression d’avoir occulté ses projets extérieurs, mais avec le temps, elle se rend compte que cette période lui a permis de s’engager dans une aventure intérieure. « La souffrance n’apporte rien en elle-même […]. Mais elle est l’occasion de réfléchir sur soi-même et sur la vie. Si nous ne sombrons pas dans la victimisation, alors la souffrance est une porte ouverte sur une nouvelle compréhension de la vie. […]. J’ai découvert qu’une souffrance personnelle, une grande douleur, au lieu de nous refermer sur nous-mêmes, peut nous rendre sensible au malheur des autres »[16].
Elle décrit ainsi un processus de transformation personnelle, où la douleur devient une source de croissance intérieure et de compréhension accrue. Cette épreuve, bien que difficile, lui a offert l’opportunité de se rapprocher de Dieu et de développer une empathie plus profonde envers les autres. Sa foi lui a permis de trouver une forme de sérénité, en acceptant de suivre un chemin imposé par les circonstances et en découvrant la paix intérieure qui en résulte. D’ailleurs, elle insiste sur le fait que la souffrance, plutôt que de nous enfermer dans la victimisation, peut nous ouvrir à une nouvelle perspective sur la vie. Cette perspective nous rend plus attentifs aux souffrances des autres et nous encourage à développer une attitude de compassion et de solidarité. En embrassant cette nouvelle compréhension, elle a pu non seulement trouver un sens personnel à sa propre douleur, mais aussi offrir un accompagnement plus authentique et empathique à son conjoint malade.
Alzheimer et accompagnement spirituel
Pour accompagner spirituellement une personne atteinte d’Alzheimer, Benoît Lacroix s’intéresse à une approche centrée sur la Loi d’amour, bien que son œuvre repose principalement sur des témoignages plutôt que sur des méthodologies structurées. Les outils à prendre en compte dans cet accompagnement sont l’attention, la solidarité, la valorisation par le regard ou le sourire, le geste affectueux, la confiance et la bienveillance. Lacroix a le mérite d’avoir soulevé une question essentielle et actuelle, mais on pourrait souhaiter un développement plus approfondi de la relation entre Alzheimer et spiritualité. Ses réflexions offrent une base précieuse, mais il serait bénéfique d’intégrer des approches plus systématiques et des pratiques concrètes pour enrichir l’accompagnement spirituel des personnes atteintes d’Alzheimer.
[1] Benoit Lacroix, Alzheimer et spiritualité, Montréal, Fides, p. 9.
[2] Ibidem, p. 14.
[3] Ibid., p. 25.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Matthieu 22, 36.
[7] Ibid. 22, 37-40
[8] [8] https://www.baluchonrepit.com/
[9] Benoît Lacroix, Op. cit., p » 28.
[10] Ibid., p.28-29.
[11] Benoît Lacroix, Op. cit., p. 30
[12] Denise Lallich (1924-2020) est une résistante française. Son mari meurt le 28 octobre 1991 après avoir été atteint durant 15 années de la maladie d’Alzheimer. Denise Domenach-Lallich participe à la fondation de l’association Rhône-Alzheimer dont elle est vice-présidente pendant dix ans. Elle publie des articles relatifs au grand âge.
[13] Benoît Lacroix, Op. cit., p. 30 p. 47.
[14] Ibid., p. 51.
[15] La question de l’abandon est développée par Dina Bélanger, mystique québécoise, comme possibilité de bonheur sur terre. Dina Bélanger insiste sur l’importance de l’abandon total pour trouver le bonheur : « L’abandon, c’est le bonheur parfait sur la terre » (Autobiographie, p. 204-205). Elle affirme que son bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures mais en Dieu seul. Cet abandon à une force supérieure et l’acceptation des épreuves comme partie intégrante de sa foi apportent une paix intérieure et une joie constante. Pour les patients d’Alzheimer et pour leurs proches, accepter la maladie et trouver des moyens de vivre pleinement chaque jour peut également conduire à un état de contentement. Les aidants peuvent encourager cette acceptation et aider les patients à trouver des moments de paix et de bonheur dans leur quotidien.
[16] Benoît Lacroix, Op. cit., p. 30
Pénélope Mavoungou