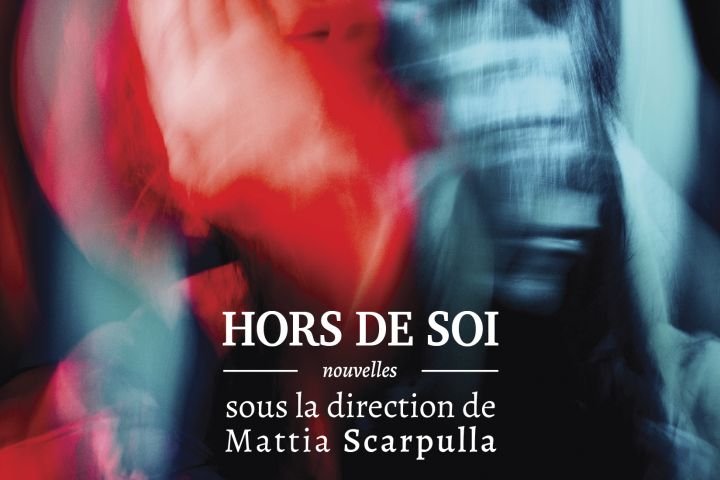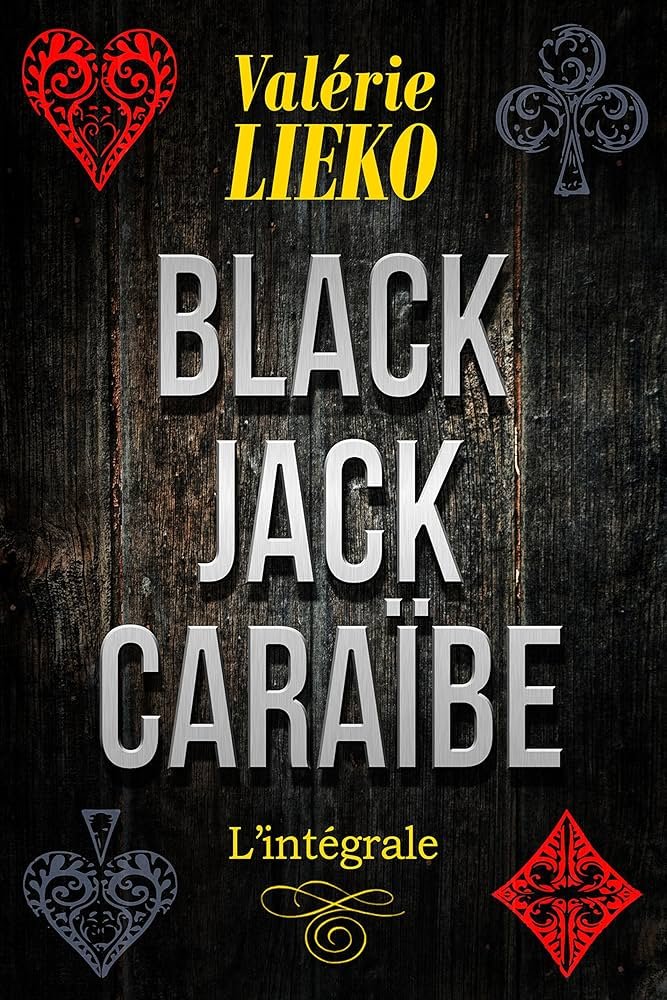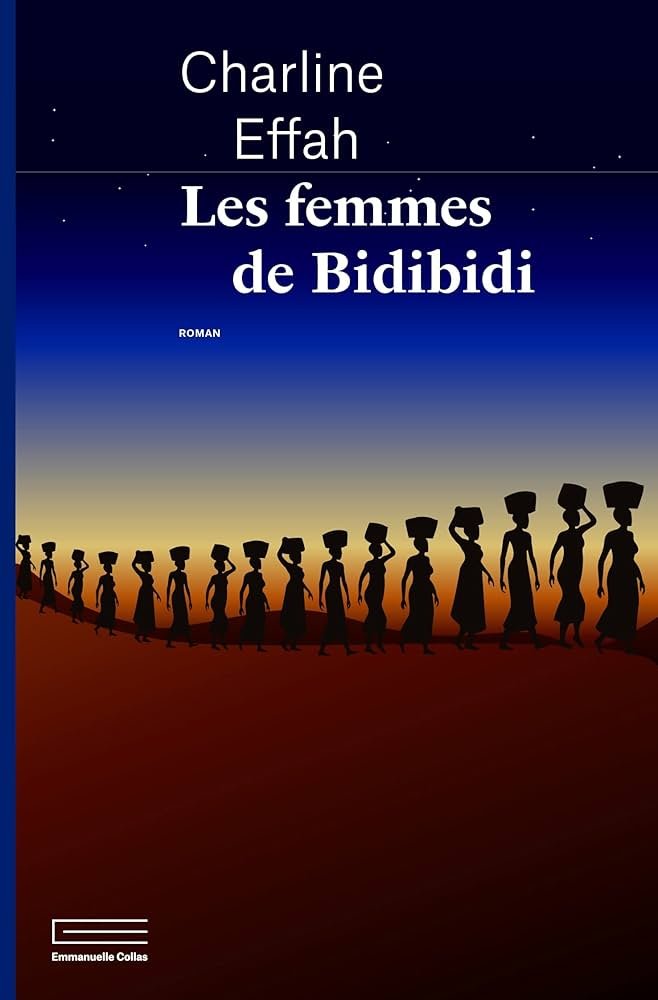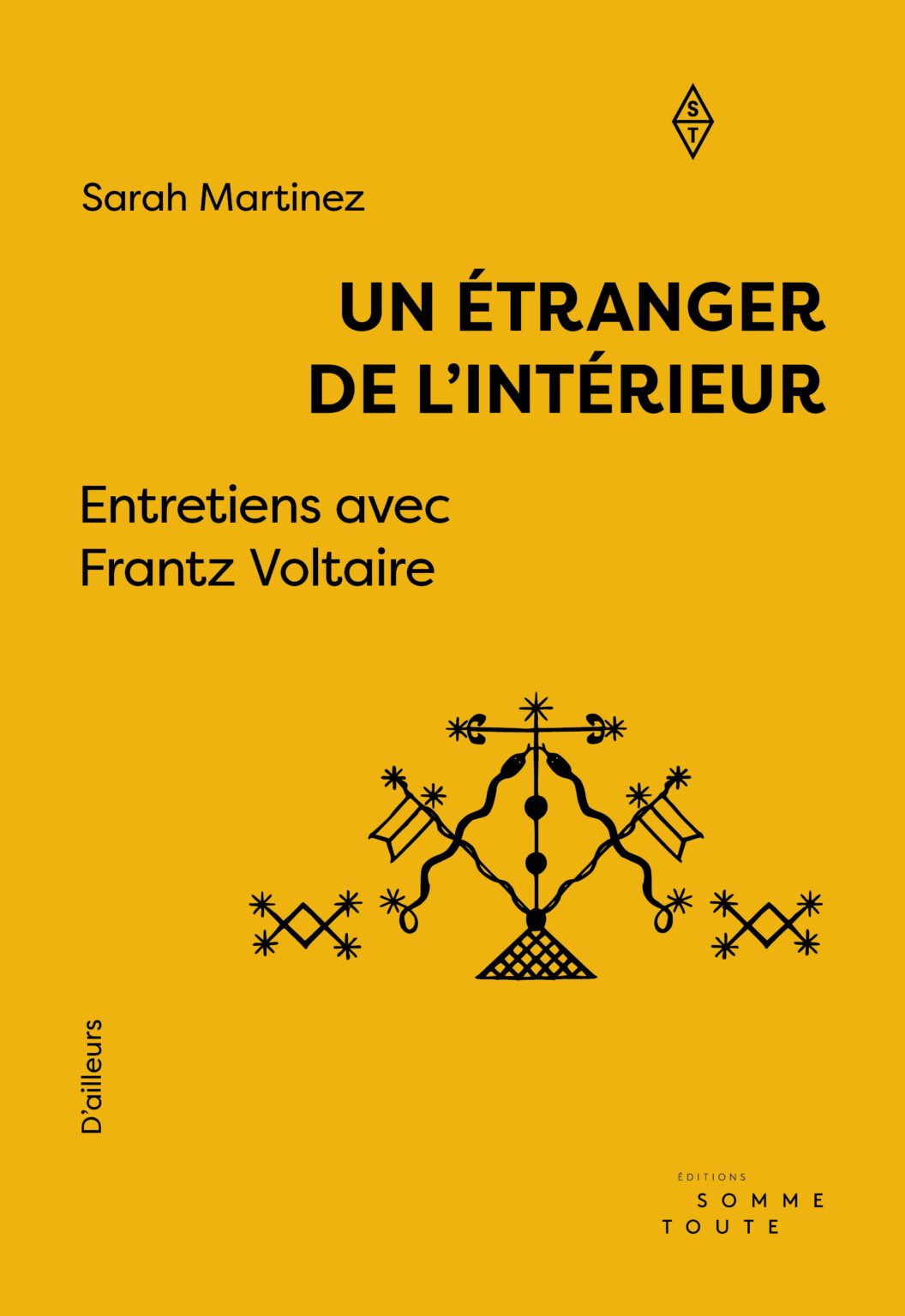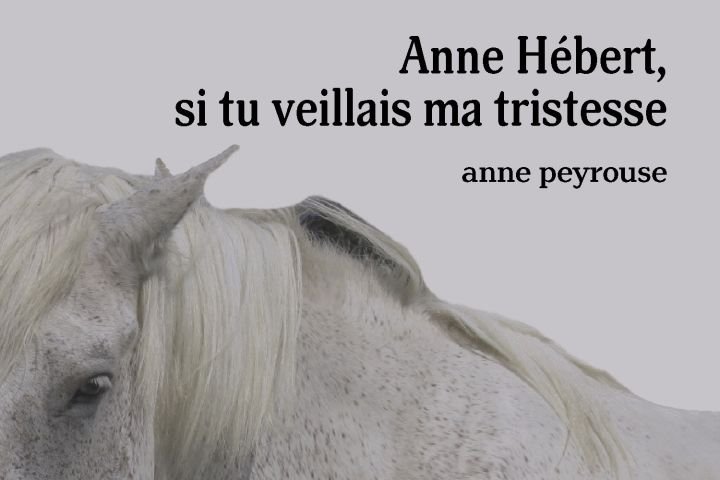Ce recueil, à l’instar de plusieurs autres reçus entre 2023 et 2024, m’a invitée à une halte singulière. En le parcourant, je me suis arrêtée sur le texte de Sara, dont les mots résonnent avec une quête qui m’habite depuis quelque temps : celle de l’itinérance des femmes. Sa voix me touche doublement, à la fois comme intervenante sociale, attentive aux fragilités rencontrées, et comme chercheure, lectrice et philosophe en quête de sens.
À Saint-Roch, il nous arrive de croiser ces présences qui dérangent, qui surprennent, qui bouleversent, sans toujours parvenir à comprendre la traversée qu’elles portent en elles. Trop souvent, nous les enfermons dans des catégories étroites, réduisant la souffrance psychique à une appartenance quasi fatale, comme si certaines vies étaient vouées à la marge. Le texte de Sara, au contraire, m’a saisi à la gorge tout en me tendant la main, comme une invitation à voir autrement.
Et la Basse-Ville de Québec, avec ses remparts qui veillent et son fleuve qui s’écoule, apparaît alors non seulement comme un lieu historique, mais aussi comme une métaphore : espace de vie et de passage, lieu de purification toujours recommencée.
Focus sur Basse-Ville de Sara Lazzaroni
Dans Basse-Ville, Sara Lazzaroni dépeint la trajectoire d’une femme sans-abri qui arpente la basse ville de Québec, quartier symbolique dans l’imaginaire urbain, souvent associé à la marginalité et l’exclusion sociale. Cette femme, dès l’âge de six ans, apprend la débrouillardise ; à quinze ans, elle vit déjà dans la rue. Séparée de sa mère, laissée à elle-même, elle apprend à survivre dans un monde hostile.
L’abandon systémique : du trauma individuel à la critique sociale
La protagoniste est séparée de sa mère dès l’enfance :
« On les a séparées et l’enfant n’a plus jamais revu sa mère. Ballottée de famille d’accueil à une autre, de l’hôpital psychiatrique à la maison correctionnelle, elle a fini par perdre la notion du temps. »
Cette citation expose le parcours chaotique des enfants en situation de vulnérabilité, souvent pris dans des institutions censées les protéger mais qui les fragmentent davantage. Ici, Durkheim est éclairant : l’absence de lien social stable produit ce qu’il appelle l’anomie, une perte de repères qui mène à l’isolement, voire à la destruction psychique.
L’autrice condense le drame en une image brutale, quasi mythologique :
« Dieu l’a simplement échappée, et en tombant, elle s’est fracturé la tête. »
Cette phrase bouleversante évoque une chute existentielle, une absence de destinée. Loin du récit de la naissance heureuse, cette femme est une oubliée de la providence, une figure sacrificielle que la société a laissée tomber sans rattrapage.
Une relation paradoxale avec la rue : refuge et trahison
« Depuis l’âge de 15 ans, il n’y a que la rue sur qui elle peut compter. C’est la seule qui ne se soit jamais dégonflée, la seule qui ait toujours été là. Lorsqu’elle n’avait plus rien, la rue l’attendait, les bras ouverts. »
La rue devient ici une entité presque personnifiée. Elle est l’unique fidélité, un contre-espace selon Foucault, ni tout à fait lieu, ni hors-lieu, un territoire d’exclusion mais aussi de construction d’un autre mode d’être. Cette ambivalence correspond à ce que Goffman analyserait comme une stigmatisation inversée : la marginalité devient identité, la rue un substitut de lien.
L’interculturalité et la justice sociale
Si la Basse-Ville évoque d’emblée l’itinérance, d’autres récits du recueil ouvrent des passages vers l’ailleurs, là où les frontières se brouillent et les cultures se heurtent. Une doctorante venue d’Afrique se transforme en chauffeuse de taxi à Montréal, puis en tueuse en série, comme si son identité éclatée cherchait désespérément une issue. Ailleurs, une Française, enfermée en Arabie Saoudite, se heurte à une culture qui l’étouffe et lui confisque la parole.
Ces histoires, dans leur étrangeté même, révèlent un monde qui se mondialise à grands fracas : les identités s’y croisent, se frôlent, s’affrontent, se dérobent parfois à elles-mêmes. Elles nous laissent entrevoir la fragilité de nos appartenances et la violence sourde des déplacements.
La diversité des personnages et de leurs origines culturelles met en lumière les rapports de pouvoir, les mécanismes d’inclusion et d’exclusion. Le recueil devient alors un espace où la justice sociale est interrogée, souvent par le biais d’une violence systémique invisible : patriarcat, racisme, capitalisme, colonialisme latent.
L’identité et le déracinement
Lazzaroni déploie une identité en éclats : privée d’ancrage familial, social ou affectif, la protagoniste se retrouve littéralement hors d’elle-même, en manque de reconnaissance. Son quartier, la Basse-Ville, se fait alors reflet de cette dérive : un espace en marge, relégué, méprisé, oublié.
À travers elle, le récit fait vibrer une question sourde, presque vertigineuse :
Qui sommes-nous, lorsque le regard de l’autre se détourne ?
Que reste-t-il de nous, sans le fil ténu du lien ?
L’intersection des oppressions
Lazzaroni n’écrit pas un manifeste féministe au sens strict. Pourtant, dans l’ombre de son récit, la condition de la femme itinérante s’impose comme un carrefour de fragilités : femme, pauvre, abandonnée, sans abri. Elle porte en elle une triple blessure, infligée par le système, par la famille, par la société.
Et si ses mots semblent absents, son silence devient cri. Car ce mutisme, imposé ou choisi, raconte mieux que tout la manière dont l’errance des femmes demeure occultée, effacée, invisibilisée.
Questionnement existentiel
Qu’est-ce qu’être chez soi ?
Un toit ? Un regard ? Une mémoire ?
Où finit l’identité ?
Peut-être là où commence l’autre.
Comment se relever quand tout s’effondre ?
Dans les débris, parfois, une étincelle demeure.
Dans Basse-Ville, l’itinérante marche nue d’existence.
Déchue de droits. Dépouillée de nom.
Réduite à survivre.
Et pourtant…
Dans ce presque-rien, une dignité résiste.
Silencieuse. Indestructible.ité de résistance qui pose la question centrale de l’humanité : qu’est-ce qui fait qu’on reste debout ?
Un texte qui me rappelle John Rawls et Amartya Sen
Sur le plan philosophique, cette nouvelle se lit comme une interpellation éthique sur la justice. John Rawls, dans sa Théorie de la justice, rappelle que la justice consiste à rendre moins insupportables les inégalités que le hasard distribue. Ici, le hasard de la naissance scelle déjà un destin : une vie marquée par la pauvreté, mais surtout par l’exclusion du système même censé protéger.
Amartya Sen, lui, parlerait d’un déficit de capabilités : la femme de Basse-Ville n’a pas seulement peu de moyens, elle est privée de la possibilité même d’agir, de choisir, de se construire. Son existence devient ainsi le miroir cru des inégalités structurelles : économiques, certes, mais aussi relationnelles, institutionnelles, affectives.
Le recueil : style et narration
Le style des nouvelles varie selon les auteur·e·s, mais toutes partagent une écriture tendue, précise, souvent traversée de fulgurances poétiques. Dans Basse-Ville, le réalisme cru des situations s’allie à une écriture empathique, qui ne condamne pas mais guide doucement le regard du lecteur vers la marge.
Malgré la rudesse du propos, la plume de Lazzaroni demeure fine, sobre, parfois ironique. Elle refuse l’écueil de la sensiblerie : l’émotion naît de la justesse du regard, de la densité des images, du silence laissé entre les mots. Ce réalisme habité d’un lyrisme discret ouvre une distance réflexive, invitant à l’introspection.
La femme de Basse-Ville n’est pas seulement une figure d’errance ; elle devient archétype : celle qu’on ne voit pas, qu’on juge trop vite, mais qui, dans son effacement même, porte un monde entier sur ses épaules.
La postface de Mattia Scarpulla
La postface de Mattia Scarpulla se présente comme un hommage lyrique aux auteur·e·s, exaltant l’engagement littéraire du collectif. Son ton, presque élégiaque, célèbre la puissance transformatrice de l’écriture : donner voix aux sans-voix, révéler la beauté au cœur de la douleur, tisser des liens entre les êtres par un effort de compréhension mutuelle.
Pour Scarpulla, la littérature devient espace de résistance et d’utopie, un lieu où la force et la beauté des textes prennent tout leur sens. Elle est nécessaire pour nommer l’indicible, pour faire surgir ce qui, autrement, resterait invisible.
Le mot de la fin…
Hors de soi est un recueil pluriel, profond, nécessaire, qui interpelle le lecteur dans ses certitudes et ses zones d’ombre. En éclairant les trajectoires de femmes et d’hommes déplacés, géographiquement, symboliquement, psychologiquement, il se fait miroir brisé : chaque éclat révèle une parcelle de notre monde contemporain.
Basse-Ville, en particulier, se distingue par sa justesse, sa sobriété et sa puissance sociale. Elle résonne comme un cri silencieux au cœur de la ville, une gifle douce, un cri muet, un miroir de notre responsabilité collective. La nouvelle fait entendre la voix de celles et ceux que nos systèmes oublient ou écrasent, tout en nous renvoyant à nos propres fragilités, à nos angles morts, à notre humanité.
Par la richesse stylistique et la densité symbolique de son texte, Sara Lazzaroni transforme la marginalité en poésie, l’errance en questionnement existentiel : un appel à voir, à entendre, à ne plus détourner les yeux.
Nathasha Pemba