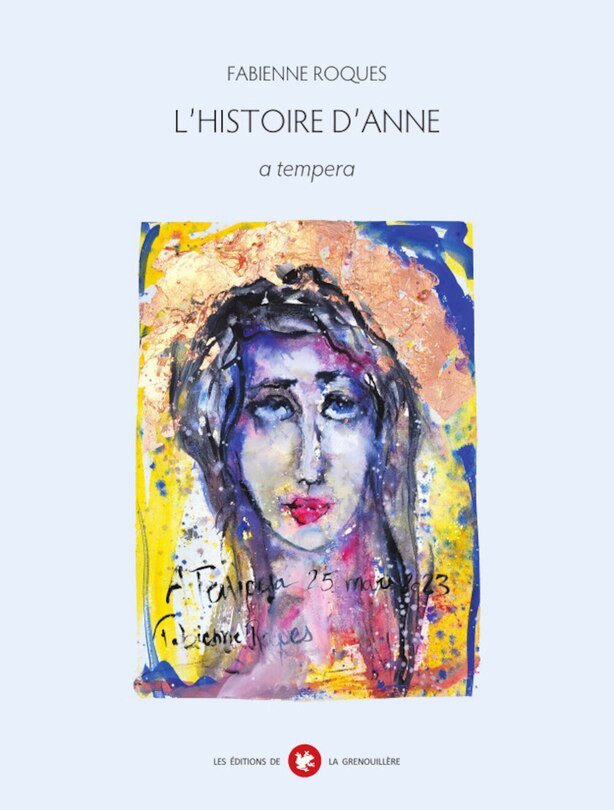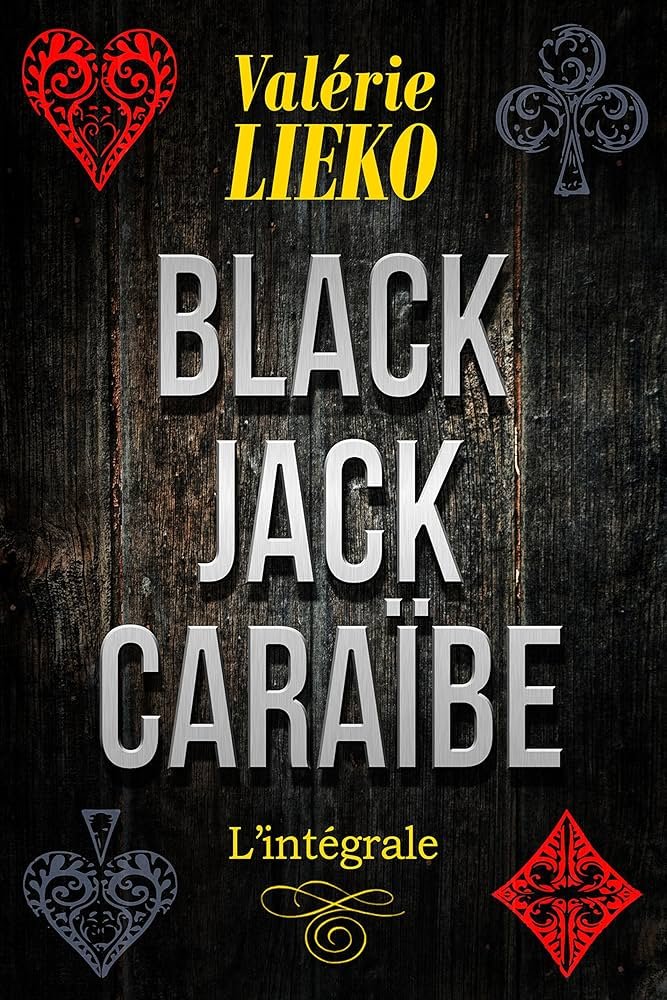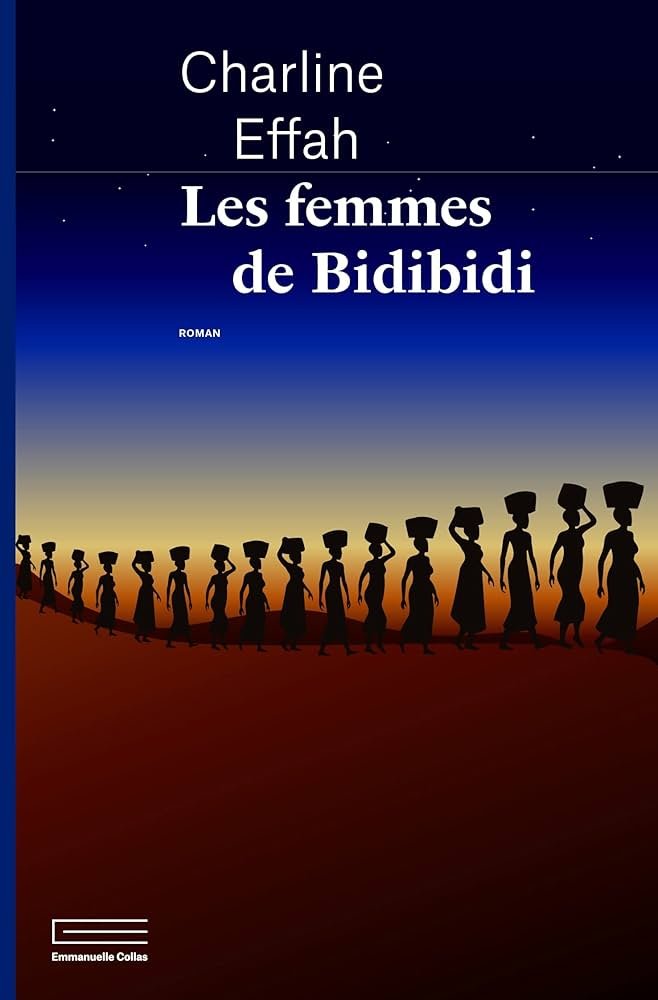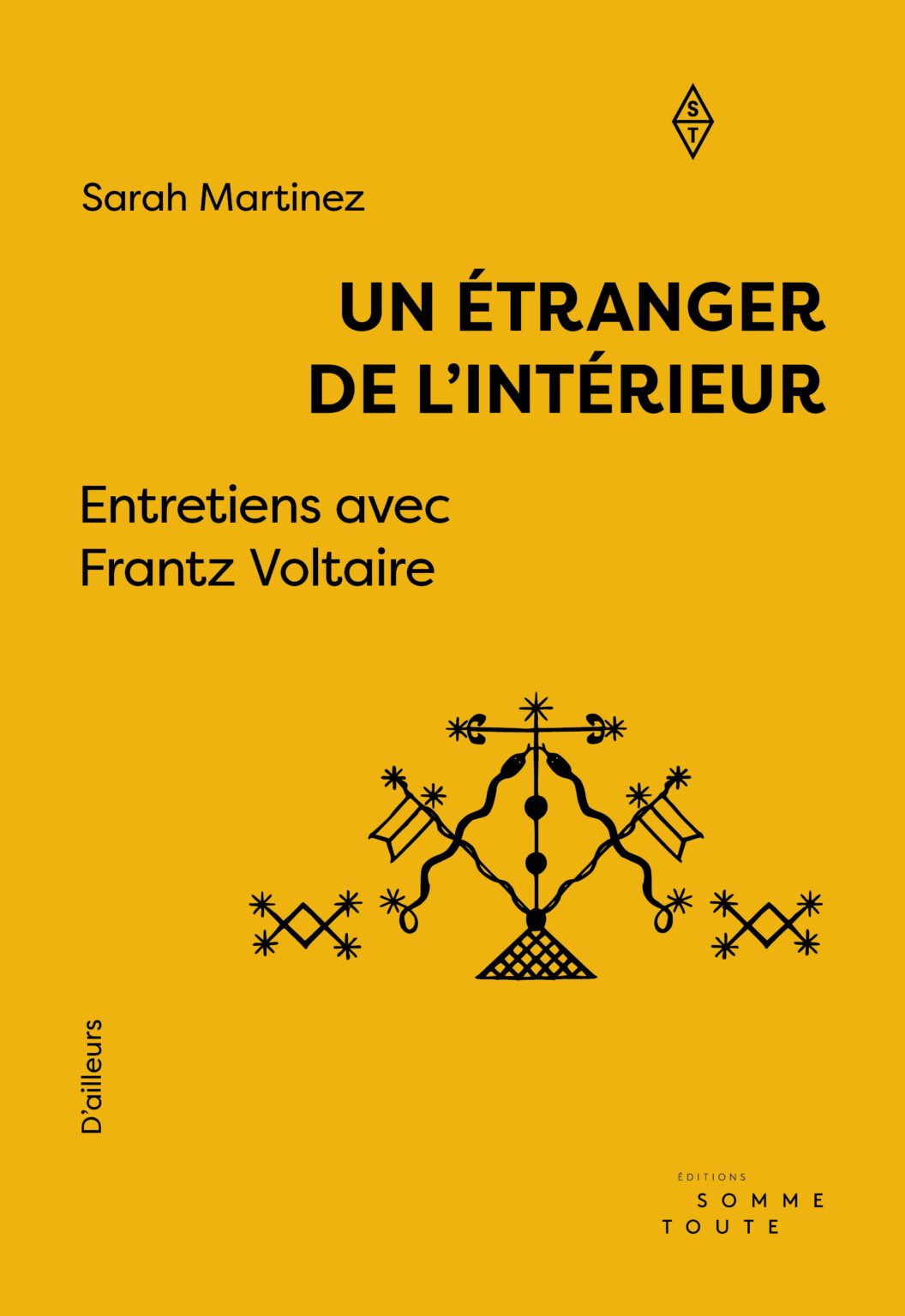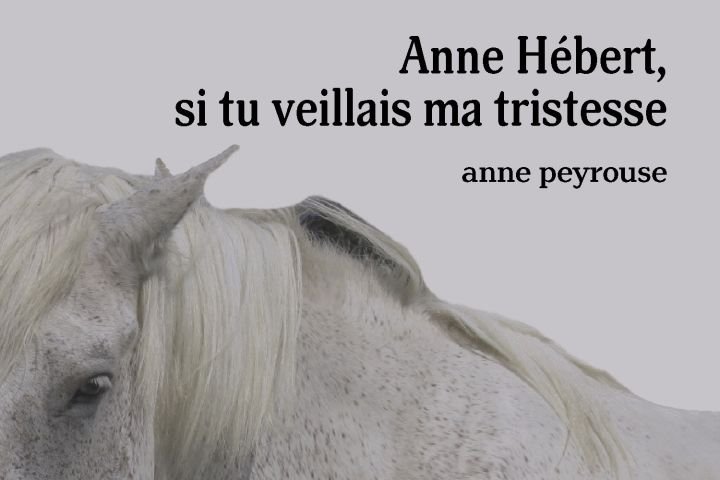Loin d’une simple fiction ou d’un témoignage, L’histoire d’Anne a tempera est une descente dans la mémoire, non pas pour reconstituer un passé linéaire, mais pour permettre aux gestes, aux sons, à la matière de parler là où les mots échouent. L’ouvrage engage une réflexion profonde sur la relation entre histoire et création, entre filiation et identité, entre mémoire et corps.
Le corps comme archive : une mémoire incarnée
Dès les premières pages, Fabienne Roques introduit sa performance en dansant, les yeux bandés, au son de John Coltrane. Ce geste inaugural est plus qu’un effet esthétique : il devient un acte de connaissance sensorielle, une manière de toucher l’invisible. Comme l’écrivait Merleau-Ponty, « le corps est notre moyen général d’avoir un monde ». Ici, c’est le corps de la créatrice qui s’aventure dans l’obscurité de la mémoire, dans un monde familial marqué par le silence, la honte, la dislocation coloniale.
Cette danse aveugle incarne la relation troublée à l’Histoire, lorsque les archives font défaut, lorsque les témoignages sont enfouis ou inavouables. Le lecteur n’est pas guidé par une chronologie claire, mais par le rythme des gestes, la sensualité de la peinture, la fragmentation poétique du texte, autant de strates d’une mémoire hétérogène qui refuse la linéarité.
L’esthétique du fragment : une épistémologie du silence
L’histoire d’Anne a tempera se lit comme une archéologie affective. Le récit ne reconstitue pas : il creuse, dérobe, insinue. La structure éclatée du livre, alternance de prose lyrique, photographies, descriptions de peinture, souvenirs flous, renvoie à ce que Paul Ricœur nommait la “mémoire empêchée”, celle que l’on n’a jamais voulu (ou pu) transmettre.
Roques ne cherche pas la cohérence du récit, mais plutôt la vérité du ressenti, la résonance émotionnelle de ce qui fut tu. Ce refus de la continuité linéaire est profondément philosophique : il s’oppose à une conception historiciste et positiviste du passé, au profit d’une approche phénoménologique, où l’histoire est ce qui est ressenti dans le corps, dans les traces, dans la texture du souvenir.
Filiation, altérité et héritage colonial : la folie comme symptôme
Au centre de l’ouvrage : Anne, femme française en Algérie coloniale, dont l’histoire sombrera dans l’oubli familial, ensevelie « sous une chape de plomb ». L’évocation de la folie d’Anne, de sa désorientation face au choc des cultures, devient une métaphore des identités coloniales disloquées.
Roques, fille de Marie, elle-même fille d’Anne, hérite d’un récit qu’elle doit inventer pour comprendre. Cette invention n’est pas mensonge, mais travail de mémoire au sens ricœurien : une manière d’assumer le passé comme une dette et non comme une donnée stable.
Là encore, le livre rejoint des perspectives comme celles de Frantz Fanon, pour qui la colonisation agit sur les subjectivités jusque dans leur chair, leur psyché, leur langage. Le silence d’Anne, et la souffrance qu’il dissimule, devient un symptôme familial et historique, un traumatisme intergénérationnel que seule l’articulation poétique et performative peut transpercer.
Créer pour dire l’indicible : peinture a tempera, geste et fiction
Le choix de la technique picturale “a tempera” (mélange de pigments et de jaune d’œuf) n’est pas anodin. C’est une peinture ancienne, lente, fragile, presque archaïque. Fabienne Roques fait de cette méthode une métaphore du soin, de la persistance et de la fragilité de la mémoire. Le fait que l’œuvre picturale se réalise sous les yeux du spectateur dans la performance rappelle que l’Histoire est toujours en train de se faire, toujours à réinterpréter.
Elle écrit un texte qui n’est pas “de mémoire” mais “de fiction”, ce qui, paradoxalement, le rend plus fidèle à la vérité émotionnelle du passé. À l’instar de ce que défendait Ricœur dans Temps et récit, la fiction donne forme à ce que l’histoire factuelle ne peut pas dire : elle répare, elle ouvre, elle interroge.
L’éthique de la création comme geste politique
L’histoire d’Anne a tempera est à la fois une œuvre d’art totale, un manifeste poétique, et un travail philosophique sur la mémoire et l’identité. Fabienne Roques démontre que l’on peut aborder le passé colonial, la filiation féminine et le silence traumatique autrement que par l’archive : par le geste artistique, par la danse, par la matière.
Ce livre-performance n’est pas seulement une œuvre à lire, mais à recevoir avec le corps, à ressentir comme un acte de réparation intime et collective. Il rappelle que l’écriture de l’Histoire commence parfois là où la parole s’épuise, dans les interstices du langage, dans la tension des muscles, dans la couleur d’un pigment ancien.
Dans une époque où les récits officiels étouffent souvent les voix minoritaires ou dissidentes, L’histoire d’Anne a tempera nous rappelle qu’il existe une autre façon de dire : créer pour faire mémoire, inventer pour être fidèle, danser pour témoigner.
Mots-clés : mémoire, colonialisme, performance, peinture, filiation, silence, art et philosophie, Merleau-Ponty, Ricœur, Fanon.