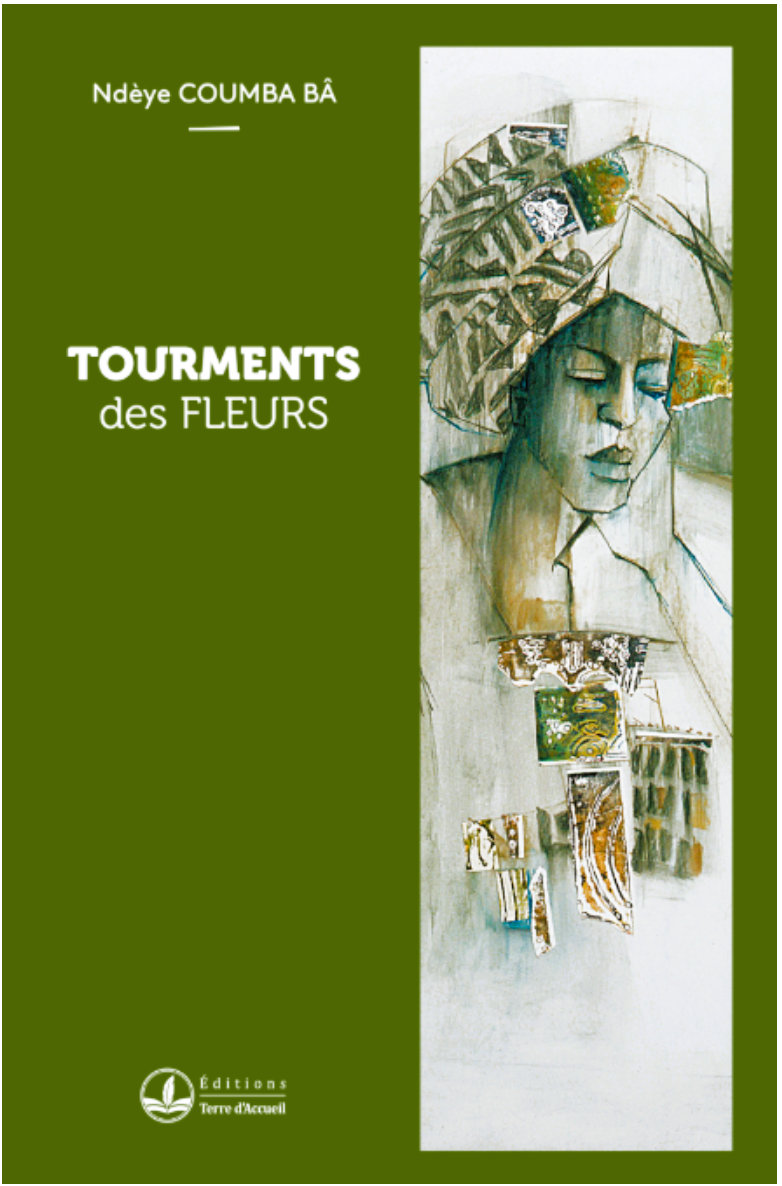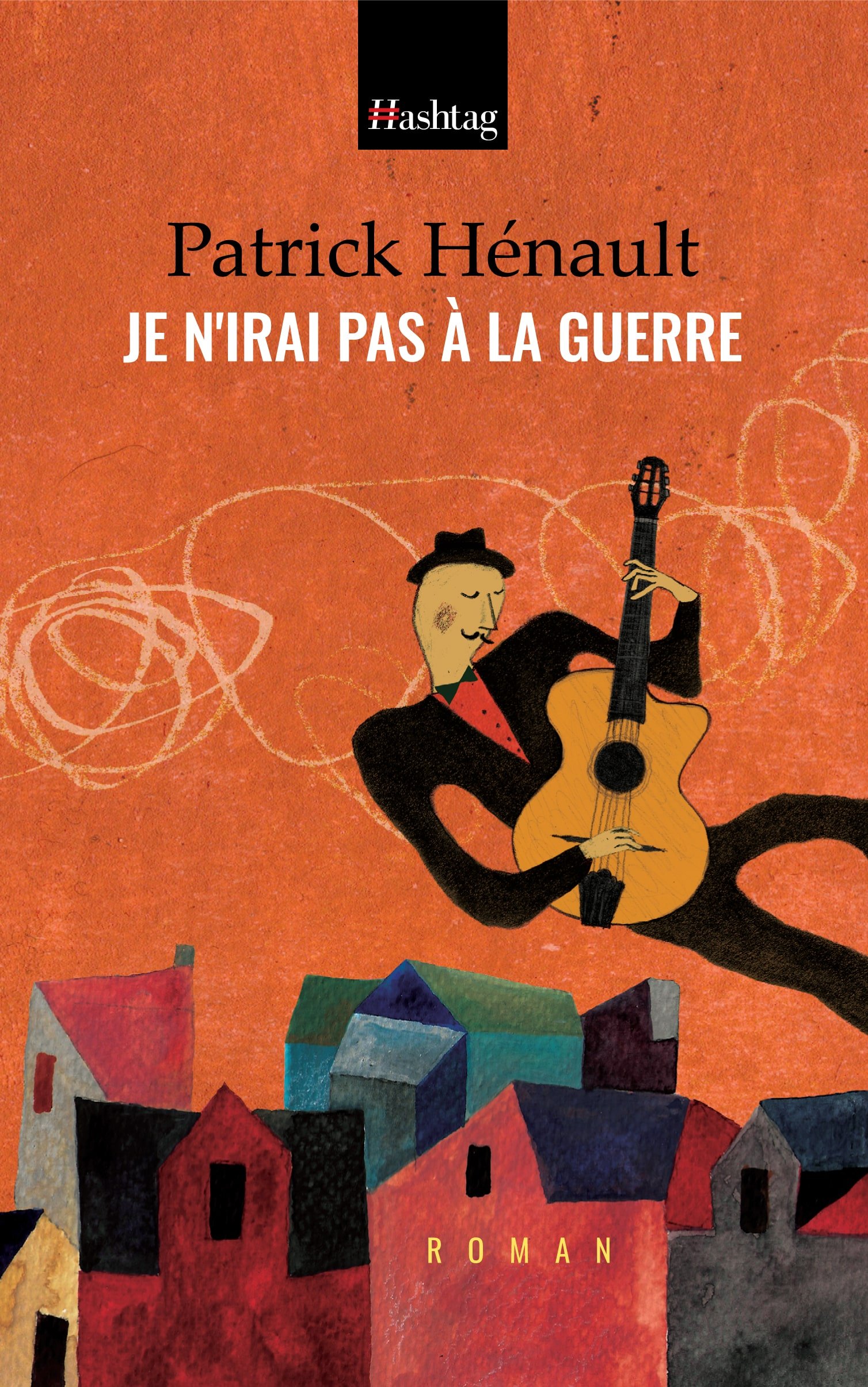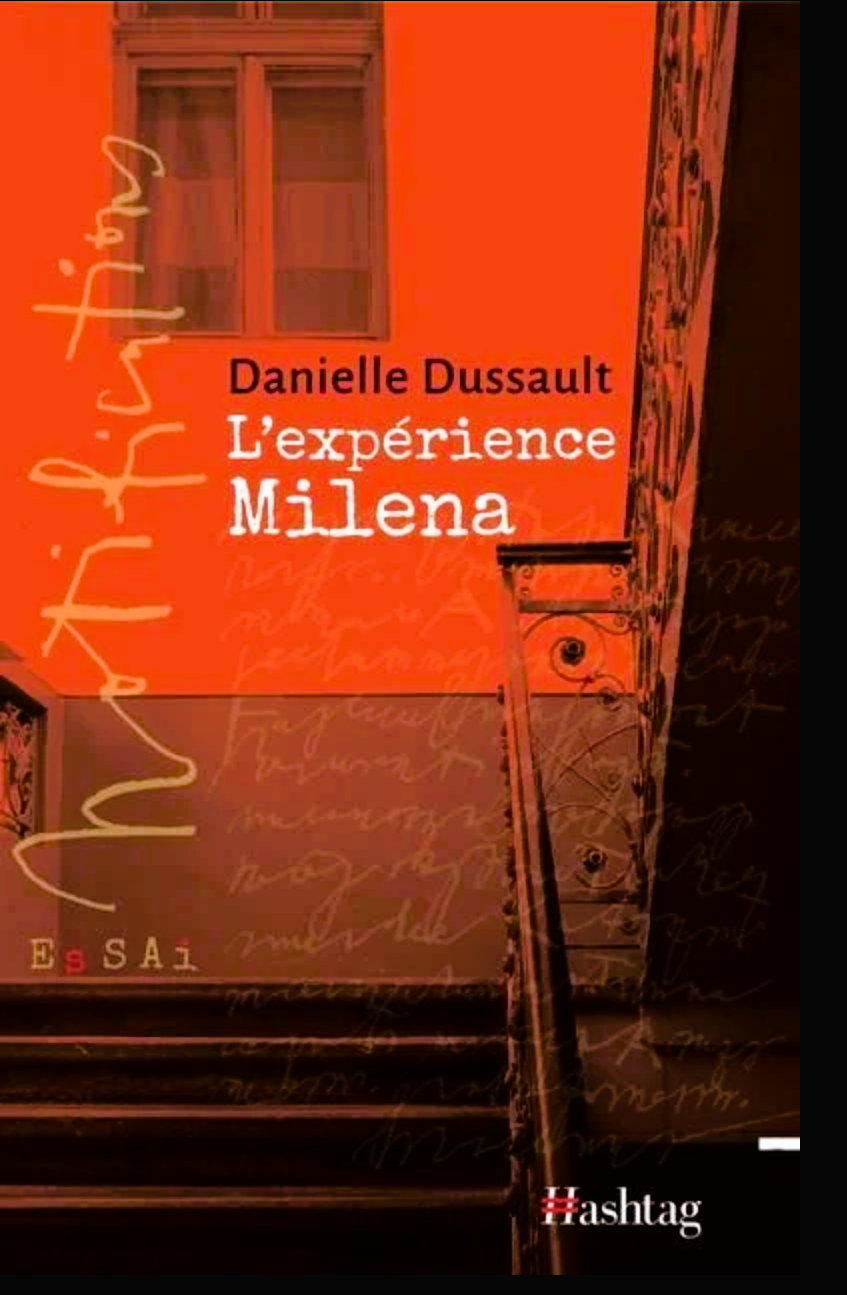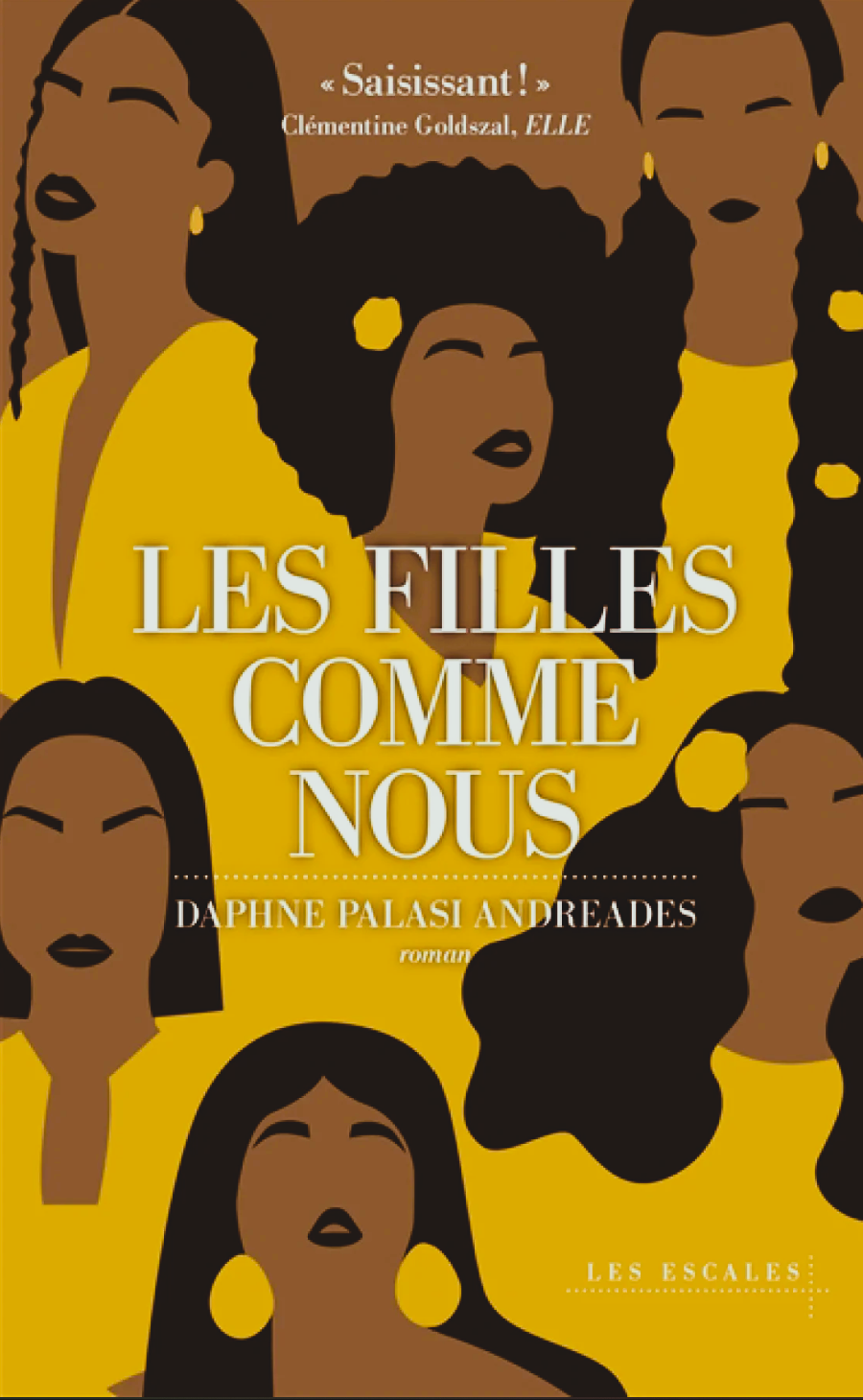Une mosaïque de corps fragmentés, un cri feutré contre les violences invisibles
Dans Elles, Pier Courville compose un recueil qui agit comme un scalpel : net, incisif, chirurgical. L’ouvrage prend la forme d’une mosaïque de récits courts, chacun centré sur une parcelle du corps féminin. Cette « architecture narrative », des textes intitulés Utérus, Seins, Touffe, Pénis, etc., traduit une volonté de fragmentation délibérée, comme si disséquer le corps permettait d’en révéler les blessures enfouies. Ces corps morcelés deviennent des territoires disputés, façonnés, blessés ou convoités par le regard masculin, les normes sociales ou les structures de pouvoir.
Derrière ces fragments, une question persiste : que signifie exister en tant que femme dans un monde structuré par la microviolence ?
L’esthétique du court : quand la brièveté devient résistance
Le style de Courville épouse parfaitement le propos. Phrases brèves, dialogues acérés, silences lourds : cette écriture sèche, parfois clinique, fait entendre l’écho de la violence nue. Ces phrases-coupures sont autant de coups portés aux lectrices et lecteurs que d’échos des coups subis par les femmes. Elles restituent la violence ordinaire : injures, remarques, regards, gestes furtifs.
L’extrait, « Le bruit sourd d’une assurance qui s’effrite… », incarne cette esthétique. Il évoque une érosion intérieure silencieuse, insidieuse, systémique. Comme une maison qui se fissure, les filles de Courville se disloquent lentement. La violence n’éclate pas : elle ronge.
Lecture féministe : le corps comme champ de bataille
Courville dresse un constat lucide, précis. Ce que les féministes nomment culture du viol, domination symbolique (Pierre Bourdieu), ou naturalisation de l’oppression (Jules Falquet), elle le met en scène à travers des dialogues familiers, réalistes, glaçants. L’homme qui reproche à une femme ses petits seins. Celui qui saisit un sein dans la rue, dans l’indifférence générale. L’appropriation du corps féminin comme norme sociale (Détrez et Simon) est ici exposée sans détour.
On pense à Simone de Beauvoir, qui écrivait dans Le Deuxième Sexe que la femme est réduite à son corps quand l’homme, lui, est un corps transcendant. Courville prolonge cette pensée dans un contexte contemporain où le corps féminin reste un lieu d’épreuve, de contrôle, de jugement. Chaque organe devient chose publique, soumis au regard, à l’évaluation, au désir ou au mépris.
On peut aussi évoquer Judith Butler, qui rappelle que le corps est lu, façonné, performé à travers des normes. Chez Courville, ces normes oppressent, tiraillent : les jeunes filles doivent être désirables sans être désirées, libres sans être libres, visibles mais pas trop. Ce tiraillement génère un silence épais, qui devient chez Courville un langage à part entière.
La violence psychologique comme effacement
Le grand mérite de Elles est de nommer les violences qui n’ont pas de nom. Celles qu’on banalise, qu’on ne remarque plus. Courville rend visibles les petites humiliations, les remarques dévalorisantes, les regards intrusifs. Elle ne raconte pas le viol ou le féminicide : elle montre le terreau invisible qui les rend possibles. Cette société, en ne réagissant pas, devient complice.
Courville, De Beauvoir, Butler et Despentes
« On ne naît pas femme, on le devient », écrivait Simone de Beauvoir. Courville illustre cette lente assignation à travers le quotidien des filles : « Elles cherchent leurs places qui, trop souvent, leur glissent des mains. »
Ce glissement n’est pas une chute soudaine, mais un apprentissage : celui du silence, de la honte, de la conformité à une place instable, définie par d’autres.
Courville met cette assignation en scène dans la matière même du corps : à travers la peau, les regards, les silences. Là où Beauvoir analyse, Courville fait sentir.
Butler, dans Trouble dans le genre, parle de performativité du genre : le genre, c’est ce que l’on fait, ce que l’on répète. Les personnages de Elles vivent cette performance imposée : être sexy mais pas trop, disponibles mais pas provocantes, désirables sans désirer.
« Toutes les filles aux petits seins sont complexées », dit un personnage masculin. Ce n’est pas une opinion, c’est une injonction. Courville ne théorise pas Butler, mais elle la rend palpable : chaque parole devient un acte de pouvoir.
Virginie Despentes : la colère maîtrisée
Par sa frontalité, Elles rappelle King Kong Théorie de Virginie Despentes. Même rage de dire, même volonté de politiser l’intime. Mais chez Courville, la colère est moins explosive, plus contenue. Son écriture agit comme un miroir : ce que vous lisez, c’est ce que vivent tant de femmes, quotidiennement, sans qu’on le voie.
Le lien entre les deux autrices tient dans une même intuition : le corps féminin n’est jamais un territoire neutre. Toujours traversé, assigné, exposé, il devient le lieu d’une lutte silencieuse.
Une œuvre nécessaire, un miroir cru et courageux
Elles est un livre fort, littérairement maîtrisé, politiquement indispensable. Il dérange, volontairement. Pier Courville donne corps à une pluralité de voix fragmentées, mais qui, ensemble, composent un cri collectif. Un cri étouffé, mais tenace.
Il dit la fatigue d’exister dans une peau qu’on n’a pas choisie. Il appelle à une écoute éthique, à une prise de conscience. Et peut-être, à un changement.
Courville s’inscrit dans une tradition féministe, de Beauvoir à Butler, en passant par Despentes. Mais elle impose aussi une voix propre, singulière, littéraire et engagée. Elles n’est ni essai, ni manifeste. C’est une œuvre littéraire, mais résolument politique, inconfortable, et essentielle.
Nathasha Pemba