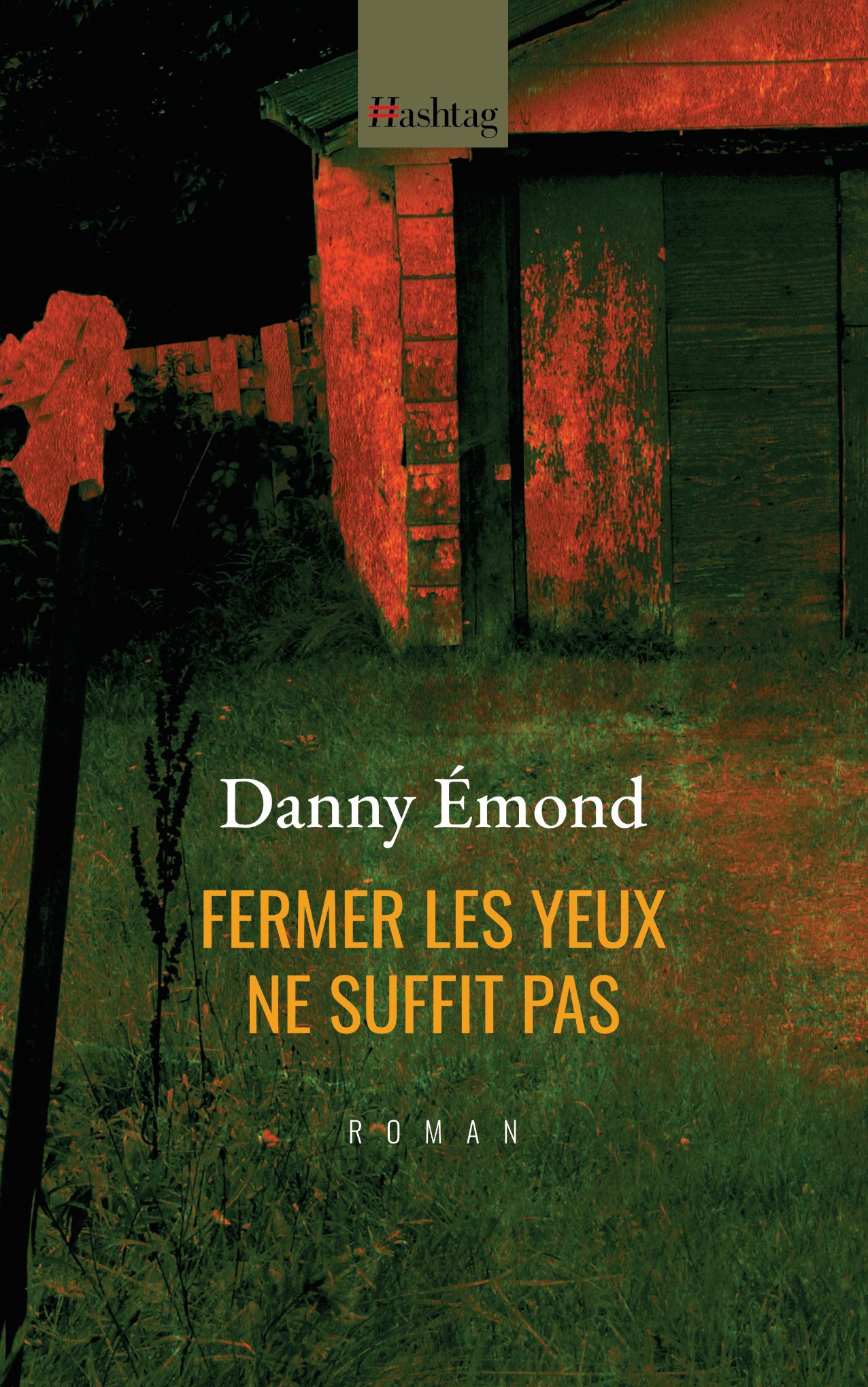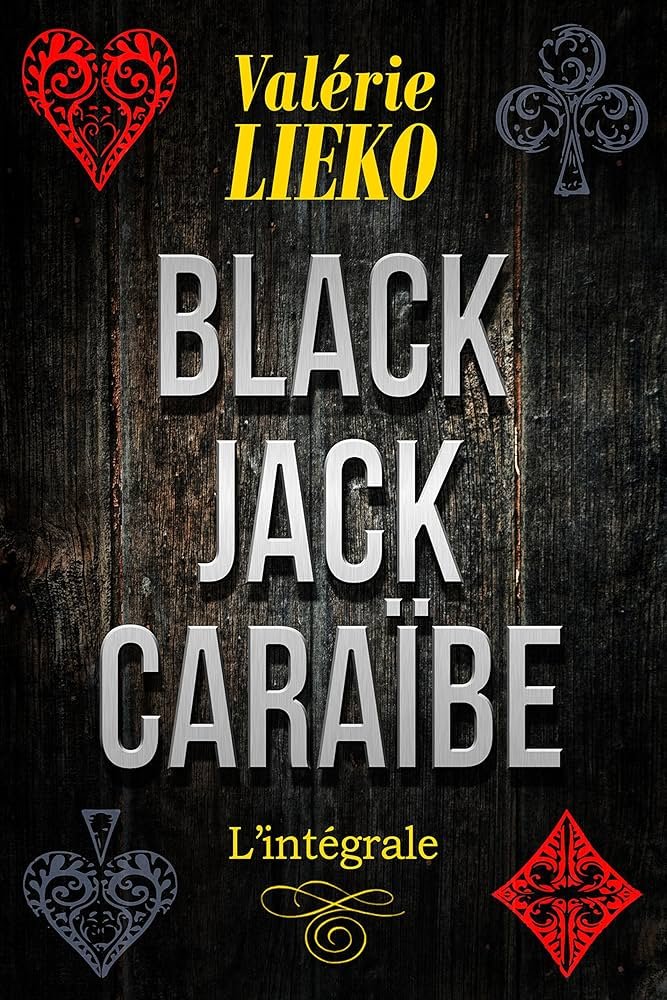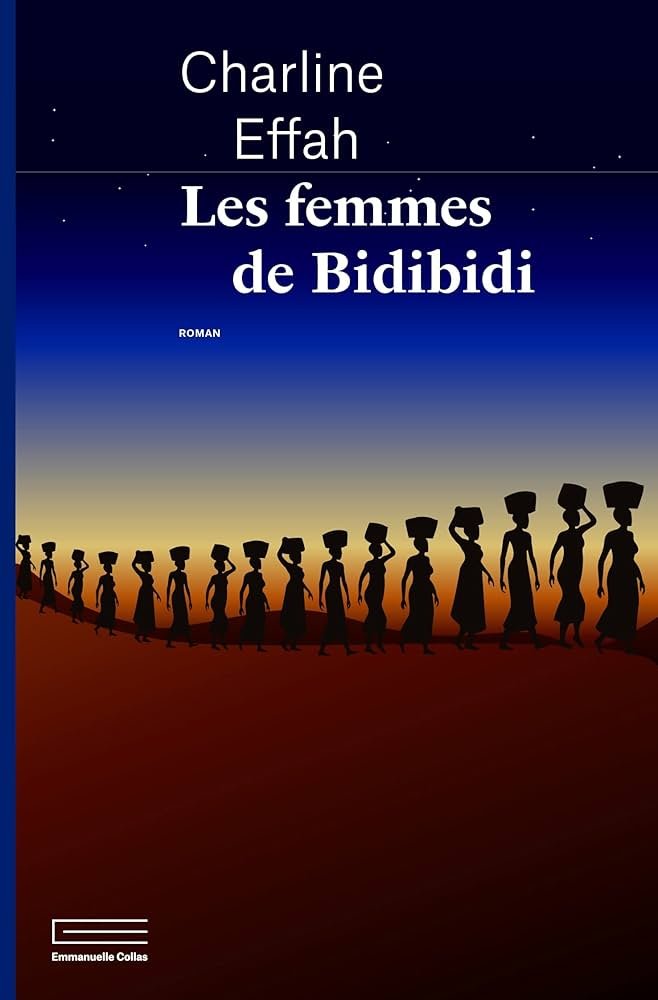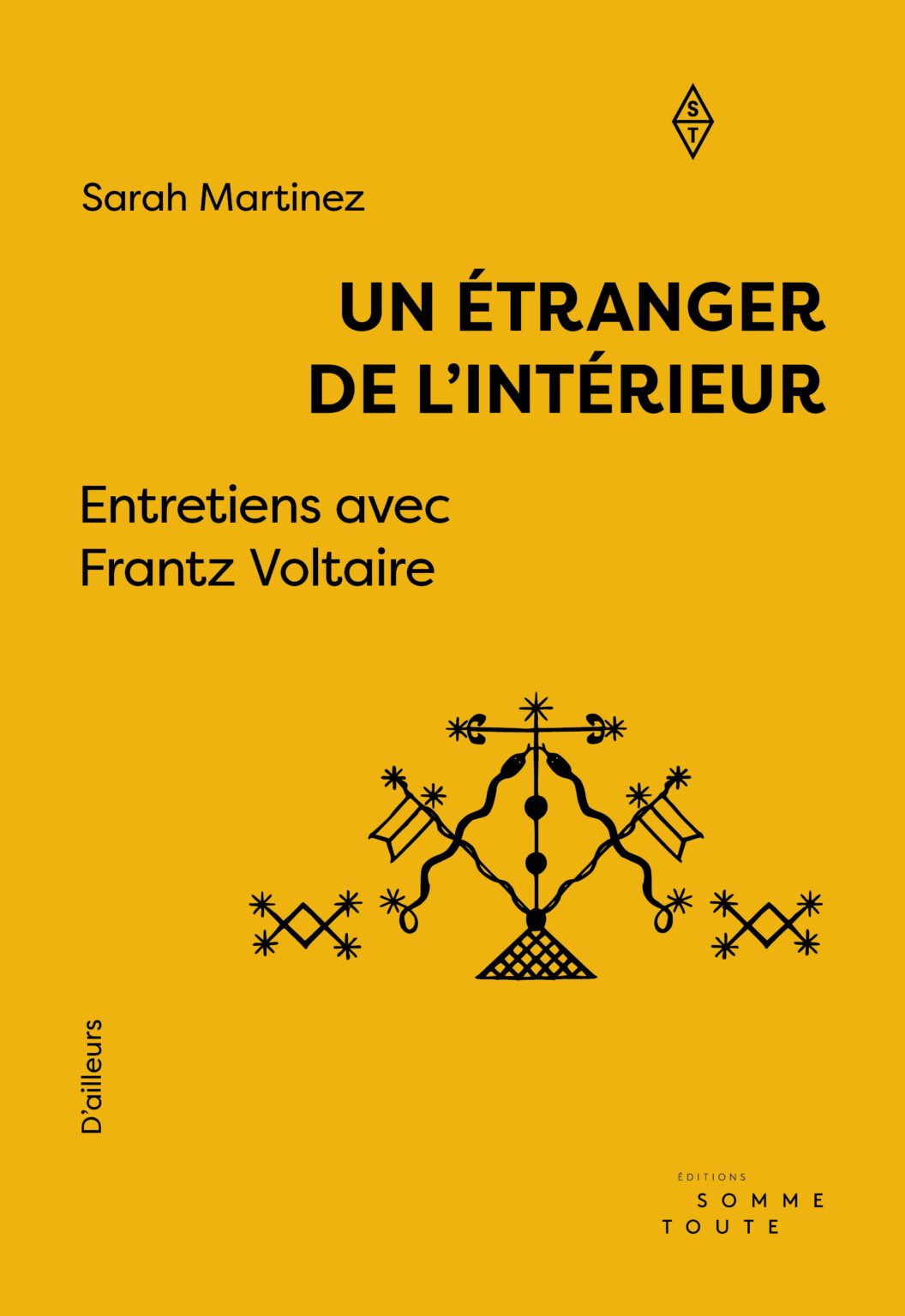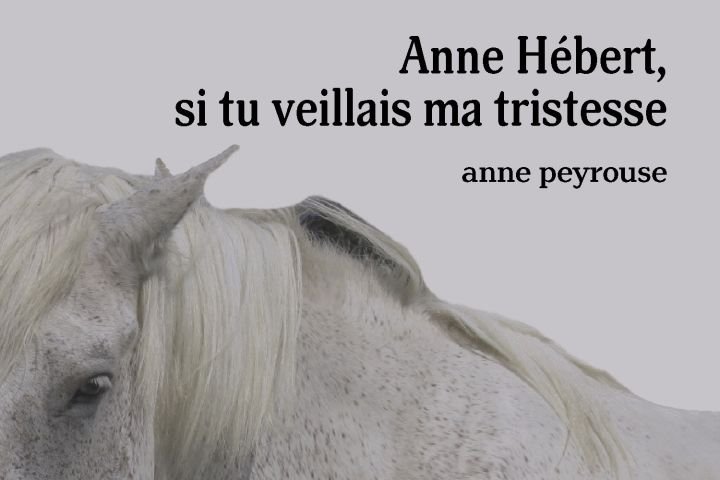Dans Fermer les yeux ne suffit pas, Danny Émond plonge le lecteur dans un récit intime et bouleversant, où le narrateur, confronté au suicide de son père, se voit contraint de revenir sur une relation marquée par la violence, le silence et le refoulement. Ce roman, à la fois huis clos psychologique et parcours de mémoire, interroge les liens familiaux, l’héritage émotionnel et la capacité à faire face au passé. À travers une écriture dépouillée et une narration fragmentaire, Émond met en scène un fils qui, à défaut de pouvoir pardonner, tente de comprendre. Dans quelle mesure Fermer les yeux ne suffit pas peut-il être lu comme un récit de confrontation avec le passé, où le processus de remémoration devient un acte nécessaire de survie psychique ?
Le roman développe une triple dynamique : d’abord celle d’un héritage douloureux, ensuite celle d’un refoulement qui se fissure, enfin celle d’une quête de réappropriation de soi par la mémoire. L’auteur évoque sa mère à quelques endroits, mais c’est davantage son lien inexistant avec ce père qui semble le mouvoir.
Un héritage familial marqué par la violence et l’échec de la filiation
Dès l’ouverture du roman, avec la phrase « DANS CE GARAGE, mon père, Paulo, a été trouvé pendu », je me suis sentie placé face à une situation de rupture brutale : la mort du père, non seulement physique mais aussi symbolique. Ce suicide agit comme une détonation qui force le narrateur à se confronter à une histoire familiale qu’il avait tenté d’enfouir.
Au fil s de la lecture, il est facile de remarquer que la figure du père, Paulo, incarne une filiation toxique et ambivalente. C’est un homme instable, solitaire, aux prises avec des troubles psychiques, dont la violence et les silences ont profondément marqué son fils : « Plus jamais je n’entendrai sa voix tranchante qui m’a si souvent terrifié… »
Pour la narrateur, toute tentative de lien paternel semble avoir échoué. L’univers dans lequel il grandit est chaotique, ponctué de déménagements, d’éclats de voix et d’un sentiment d’insécurité. Le lieu du drame, le garage, condense à lui seul ce passé douloureux : espace de travail du père, rempli d’objets hétéroclites, il est aussi le théâtre de son dernier acte. Il devient ainsi le symbole de l’héritage matériel et psychologique laissé au fils, un héritage que ce dernier souhaite rejeter en bloc : « je brûlerais tout le garage et cette maison pourrie avec les fantômes dedans. »
Le garage, lieu de mort, est aussi un espace mental saturé de souvenirs, ce qui rend le rejet impossible : il faudra au contraire l’affronter.
Le refoulement comme mécanisme de survie… et d’aliénation
Le titre même du roman, Fermer les yeux ne suffit pas, suggère l’impossibilité de fuir indéfiniment. Le narrateur l’a pourtant tenté, toute sa vie : « Fuir, c’est ce que je sais faire de mieux. Penser à autre chose, regarder ailleurs. »
Cette fuite est un mécanisme de défense psychique, mis en place pour survivre à la violence quotidienne. Fermer les yeux, c’est espérer que la douleur s’éteindra, que les larmes ne couleront pas. Le narrateur a appris à « tout retourner à l’intérieur », à se blinder émotionnellement, dans une posture de stoïcisme hérité du père :
« Pour être un fils digne de lui, j’ai évité de m’apitoyer. »
Mais ce refoulement n’est pas tenable. La mort du père agit comme un événement catalyseur : en vidant la maison, en touchant les objets, en respirant les odeurs du passé, le narrateur revit malgré lui les scènes enfouies, les terreurs d’enfance, les rares moments de tendresse. Chaque objet du garage devient support de mémoire involontaire, tel le célèbre épisode de la madeleine chez Proust. Ici, ce sont une moto, un couteau, une télévision, un aquarium, qui fonctionnent comme des métonymies du passé, déclenchant un travail de remémoration.
Ainsi, Fermer les yeux ne suffit pas montre que le déni du passé ne protège pas, mais alourdit, et que seul un retour vers la douleur permet de briser le cycle du silence.
Une reconstruction fragile à travers le récit de soi
Confronté à l’absence définitive de son père, le narrateur entreprend une fouille mémorielle, à la fois matérielle (vider la maison) et psychique (revivre les souvenirs). Ce processus narratif constitue une tentative de reconstruction identitaire. Le père n’a pas su transmettre, le fils n’a pas su parler : le roman devient le lieu d’une parole libérée, même tardive, même douloureuse.
L’écriture elle-même reflète cette quête : elle est sobre, fragmentée, tendue, marquée par des ellipses, des phrases courtes, des majuscules en ouverture qui brisent la fluidité. Ce style minimaliste et nerveux est en adéquation avec le traumatisme refoulé, avec l’émotion contenue qui affleure à chaque ligne. Le langage devient le moyen de reprendre la maîtrise du récit familial, de se réapproprier une histoire subie.
La récurrence de termes liés au regard, fermer les yeux, regarder ailleurs, percevoir l’écho, témoigne du combat entre l’oubli et la lucidité. Ce n’est qu’en ouvrant enfin les yeux sur ce passé, aussi douloureux soit-il, que le narrateur parvient à une forme de réconciliation intérieure, même imparfaite.
IN FINE…
À travers Fermer les yeux ne suffit pas, Danny Émond livre un roman intimiste et bouleversant, où le silence familial, la violence paternelle et le poids du non-dit sont explorés avec justesse et pudeur. En confrontant son narrateur à un passé qu’il aurait préféré oublier, l’auteur montre que le travail de mémoire est une nécessité existentielle. Refouler ne suffit pas ; il faut fouiller, comprendre, et parfois même écrire, pour enfin rompre avec la répétition traumatique. Ce roman s’inscrit ainsi dans la lignée des récits contemporains de la mémoire blessée, où l’intime devient un champ de bataille entre le souvenir et l’oubli, entre la douleur et la reconstruction.
Nathasha Pemba