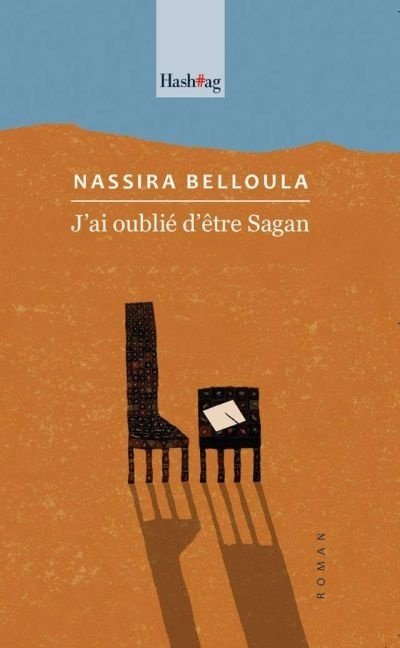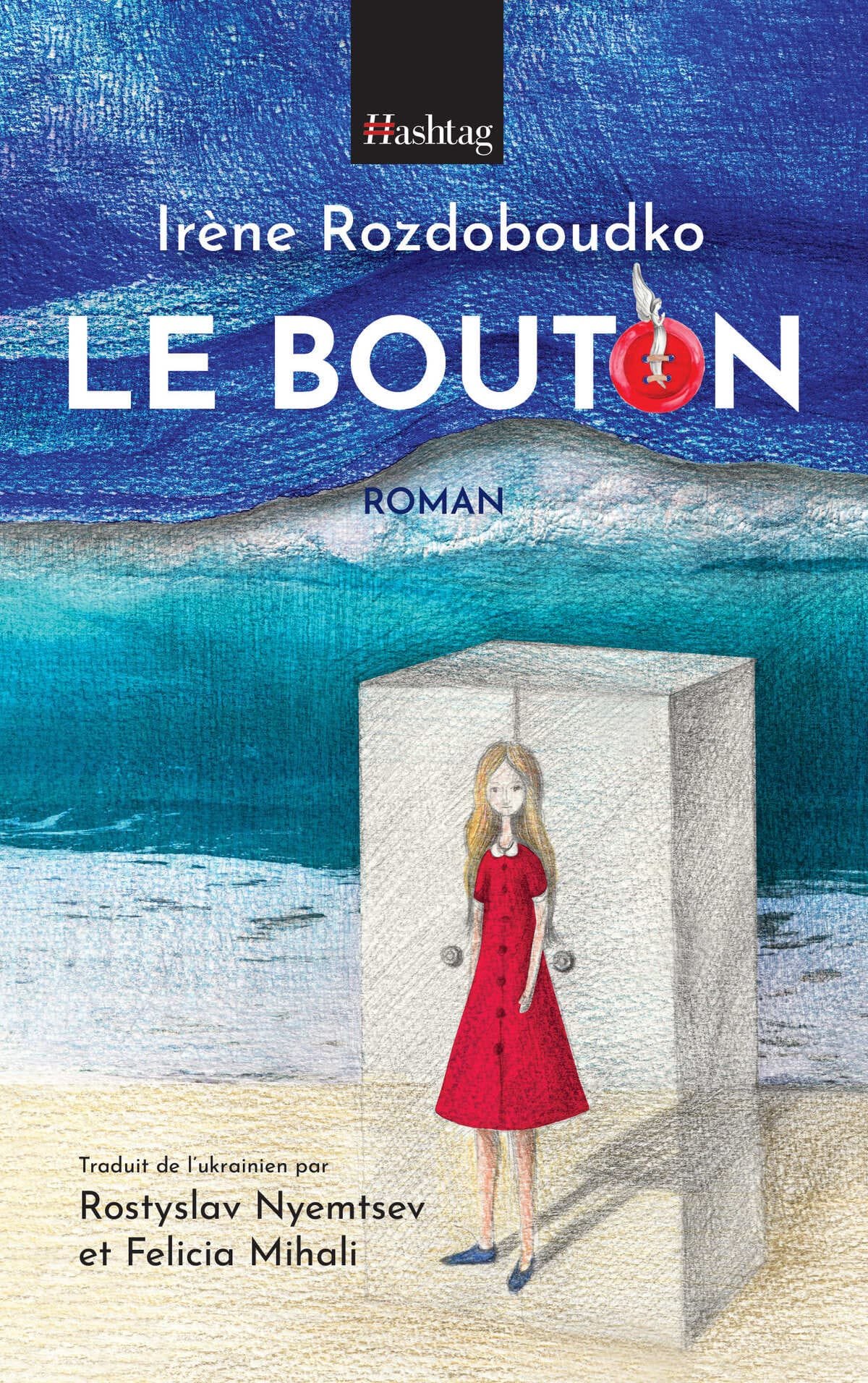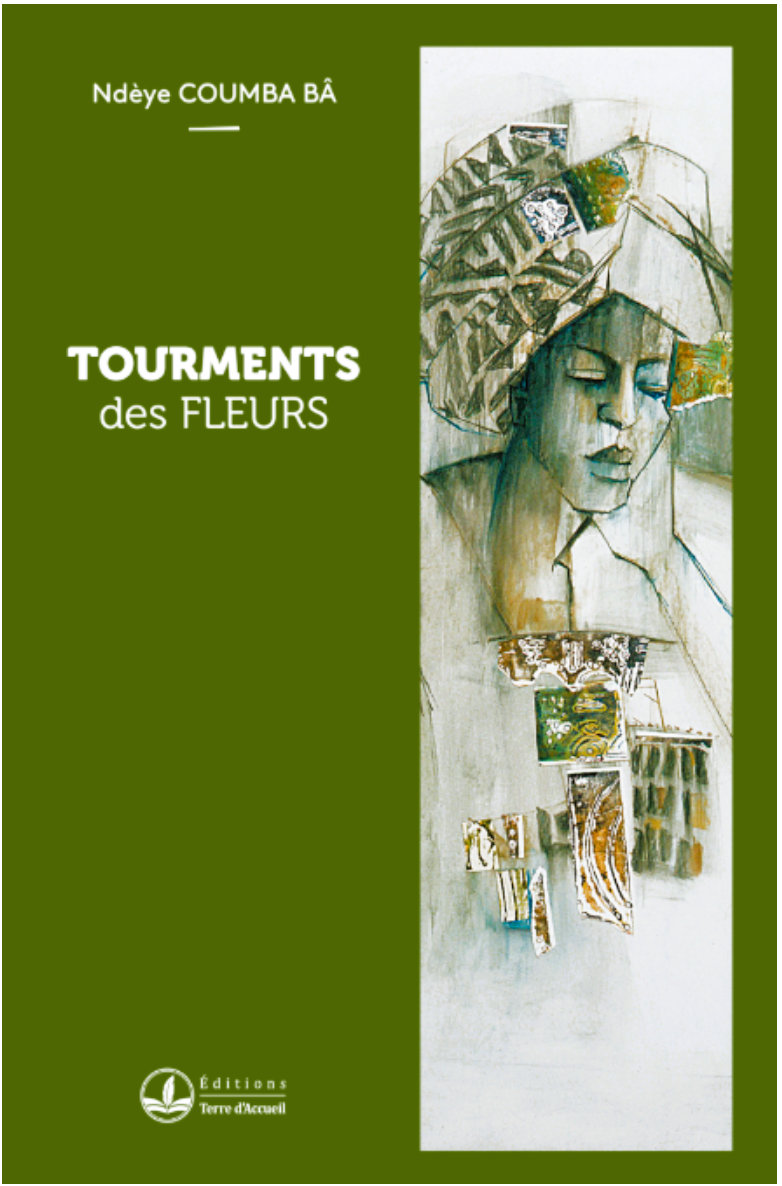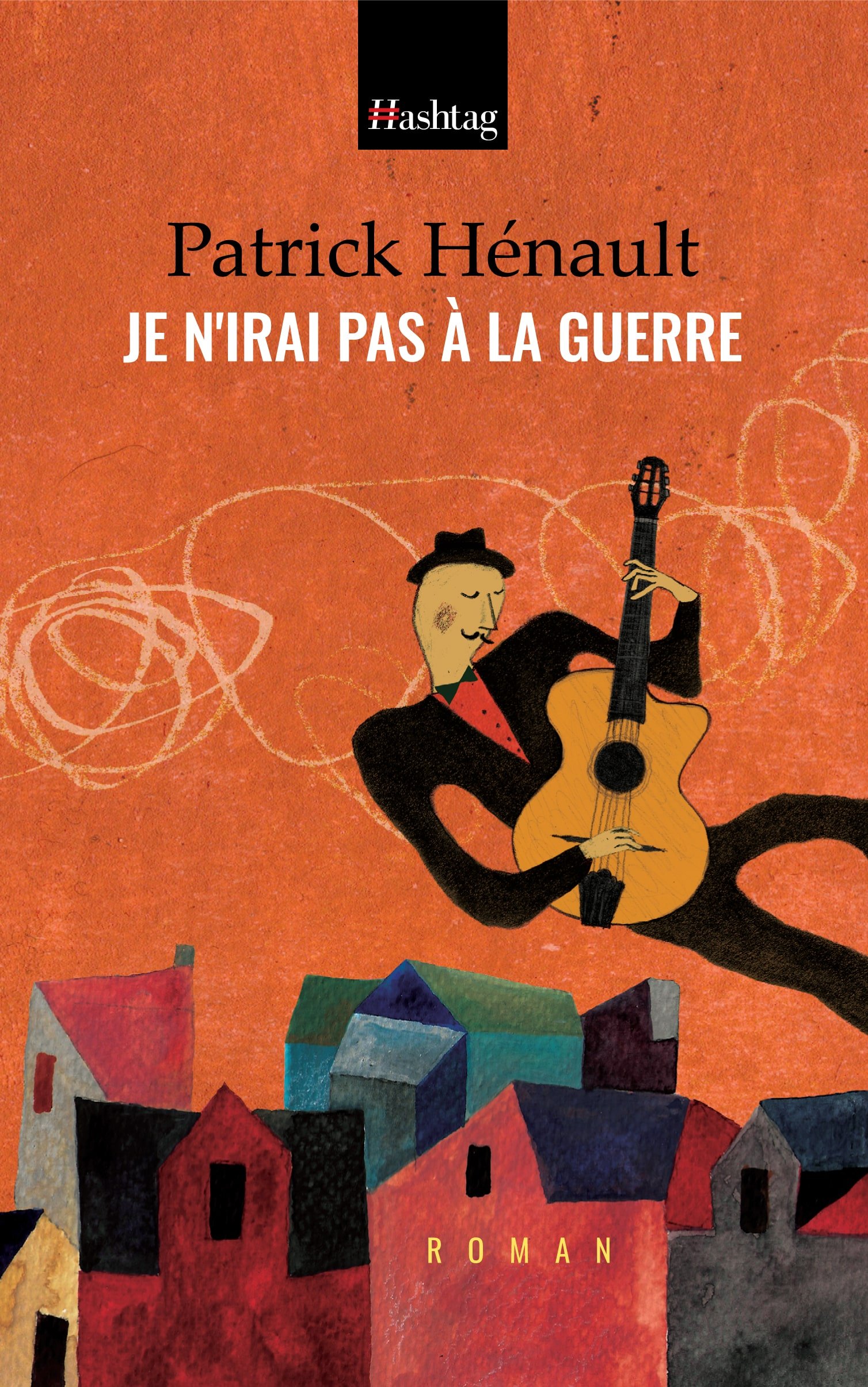Analyse littéraire
Nos rédacteurs chevronnés décortiquent, décomposent, passent les ouvrages littéraires francophones au peigne fin pour observer le sens, la structure et la portée d’une parution récente ou vous font redécouvrir un grand classique.
Honneur à Nassira Belloula, J’ai oublié d’être Sagan, Montréal, Éditions Hashtag, 2019.
J’
ai oublié d’être Sagan est un roman résolument féministe fondé sur l’idée du féminin et sur la réalité féminine des personnages centraux. L’Algérie constitue le cadre du roman, mais non sa substance, car le véritable propos du roman transcende l’espace et le temps. Nassira Belloula n’écrit pas exclusivement pour la femme algérienne : elle écrit pour la femme.
Le titre du roman peut être trompeur, son objet n’étant pas exclusivement Sagan. L’auteure introduit Sagan pour reconstituer l’histoire d’Angélique Malek. L’intérêt bien au-delà du titre doit être vu du côté de la langue, du style et de la thématique. Celle qui constitue la femme-souvenir est donc là pour rappeler un engagement, mais aussi des acquis à sauvegarder.
D’emblée, l’intrigue se noue, d’une révolte intérieure menée par Angélique Malek, la narratrice, mais qui la broie et la mène à nouer une relation personnelle avec les mots, mais aussi avec le professeur qui incarne, pour elle, l’amour-viril par excellence. Les obligations de la conscience féminine, bien qu’enfouie en elle, la conduisent à un tiraillement de sa conscience algérienne : obéir à la tradition revient à renoncer à ce qu’elle porte de plus cher : l’amour et l’identité féminine. Paradoxe pour cette femme qui, depuis avoir lu Sagan et rencontré le professeur dont elle est tombée amoureuse, lutte intérieurement pour l’amour et la condition féminine. Elle accepte l’instrumentalisation de sa liberté jusqu’à la soumission presque absolue.
Soumission absolue
Tel est le destin choisi par la mère d’Angélique et par d’autres femmes du milieu qui, au fond, sont devenues les bourreaux d’autres femmes. Un peu comme Cécile dans J’ai oublié d’être Sagan qui, jalouse de son père, jette ce dernier dans les bras de son ex au point de précipiter son épouse (qui n’est pas sa mère) dans les enfers de la mort. Dans la plupart des cas, dans la maltraitance de la femme, il y a souvent/aussi une femme à la base. La mère d’Angélique, en plus de détester sa fille, maltraite ses belles-filles. La seule femme qui n’est pas sous son influence, c’est la nouvelle femme de son époux, sa rivale.
Soumission presque absolue
Tel est aussi le destin choisi par Angélique pour pouvoir plaire à l’homme dont elle tombe amoureuse : « Cette vénération que tu as en l’évoquant me pousse à vouloir être elle (…) j’adoptais son style, ses fameuses espadrilles, ses chemises aux manches retroussées, ses marinières aux couleurs pastel et ses foulards noués autour du cou. Je me réjouissais de capter ton attention. », écrit-elle. C’est souvent le destin de la femme, ne pas être elle et être toujours quelqu’un d’autre pour plaire ou pour attirer certaines faveurs de la gent masculine. être ce que la société lui impose d’être.
Soumission absolue
Le viol de l’innocence.
Angélique Malek est violée par son oncle qui voyait dans cet acte quelque chose de normal. Au début, elle-même avait considéré l’attention de son oncle comme un acte protecteur. Plus tard, elle a fini par comprendre que la soumission qui lui était exigée en toute circonstance était un moyen de la préparer au silence, à accepter ce qu’une femme doit accepter : le viol de sa conscience.
Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai compris le sens des sourds remous qui le traversaient. (…). Une nuit, paralysée par la peur, je m’étais abandonnée aux mains moites qui me touchaient, aux ongles crochus qui raclaient les murs, à l’horrible chose entre leurs cuisses.
Cet épisode de la vie de la narratrice marque la coupure du lien affectif avec la mère, car en se confiant à sa mère de ce qu’elle voyait ou vivait, sa mère, avec une froideur extrême, la traita de folle : « Ce jour-là, j’ai perdu ma mère ; il ne me resta d’elle que l’adversité de son regard. Plus rien ne me sera épargné ».
J’ai oublié d’être Sagan met en exergue le conflit inéluctable de la femme avec la femme.
Dans l’amour pour son professeur qui laisse Angélique enceinte, sa mère doit à tout prix jouer son rôle : sauver l’honneur de la famille. L’enfant lui est arraché à la naissance. Cet épisode demeure, dans l’histoire, la caractéristique de toutes les sociétés, car je garde dans mon souvenir l’épisode de la série MadMen où Peggy Olson, une femme émancipée, est obligée d’abandonner son bébé à la naissance, parce qu’un enfant qui naît hors mariage est un bâtard et la mère est une inconsciente, une marginale qui ne mérite aucun égard. Peggy et Angélique ont cela de commun : leurs enfants seront placés et elles ne les verront jamais. Ce film se déroule dans les années 60 et l’épisode précisément en 1967. Si les lieux diffèrent, la complexité des relations familiales est un lieu commun. Les possibilités d’émancipation, cependant, ne sont pas les mêmes.
Seule face à son destin, mais désarmée, Angélique se sent isolée dans la mesure où elle sait qu’aucune femme, à commencer par sa mère, ne pourra suivre la révolte de son cœur.
Dans les remontrances de ma mère, l’agressivité et la violence se sont implantées en moi. Un soir, poussée par l’envie subite d’être laide, j’ai coupé mes tresses.
Belloula définit ses personnages féminins comme des personnes lucides certes, mais des personnages en colère qui s’unissent à la loi patriarcale pour soumettre d’autres femmes. Cette soumission-domination devient ainsi le lieu de leur grandeur, le lieu de leur pouvoir, le lieu de leur existence. Mais la question qu’on peut se poser est celle de savoir si ces « femmes soumises toutes-puissantes ne sont-elles pas également plongées en permanence dans une colère sans précédent, dans le désordre de la condition féminine. Angélique tente de se suicider, mais la mort ne veut pas d’elle. Tout le tragique de la condition féminine se dévoile ainsi à elle : « J’avais senti son regard peser de tout son poids sur moi. Les autres femmes ont vite compris que je serais son souffre-douleur et se sont étendues en se jetant dans des discussions bruyantes ». C’est le début du conflit avec sa mère qu’elle tentera d’ignorer par tous les moyens et tous les silences qu’elle s’efforcera à observer. Angélique finit par réaliser que sa mère est une femme en colère. Lorsque celle-ci s’est mariée, elle avait treize ans : « Elle ne savait pas lire. Elle était soumise, fataliste, superstitieuse, religieuse, de cette sorte de religion corrompue par les traditions et l’ignorance ». Elle a eu des garçons avant qu’Angélique, son malheur, « n’atterrisse entre ses cuisses comme par erreur ». C’est dans cette indifférence maternelle que prit racine le « déficit affectif d’Angélique », car elle ne réussit jamais à conquérir le regard de sa mère.
Montaigne a écrit que pour bien vivre, il faut apprendre à mourir. Tel sera désormais l’itinéraire d’Angélique Malek pour affronter le tragique de la condition féminine. Elle comprend que si en tant que femme, elle ne peut changer le passé, elle peut, en revanche, explorer des possibilités qui s’offrent à elle, comme ce mariage forcé. Elle repousse par sa pensée l’obscure tradition en s’appuyant sur l’amour, la littérature, etc.
Bonjour Tristesse de Sagan revisité
Durant les vacances de printemps, tu me fais parvenir Bonjour Tristesse. J’ai tout de suite cherché les mots qui m’étaient destinés entre les pages du roman. Mon image surplombait celui de Sagan. J’avais refusé de croire à un banal cadeau, mais maigre consolation, il y avait ton odeur sur la couverture. (…). Avec ce roman, c’était comme si tu avais creusé une faille en moi pour y déverser ton aura et celle de Sagan. J’ai passé plus de vingt ans avec vos vocables, dans l’incapacité de m’en défaire, ce qui a provoqué en moi des ressentiments, non pas à cause de Cécile, mais de ce lien indissociable entre toi et Sagan
J’ai oublié d’être Sagan n’est pas une réécriture du livre de Sagan. Il est un roman sur la condition féminine qui tout en tenant compte des intuitions de Sagan dans Bonjour Tristesse redonne à la femme des moyens pour être, pour s’assumer et non point pour se mettre dans la peau d’une autre. Angélique Malek n’est pas Sagan et elle ne le sera jamais, mais elle partage avec elle la lutte pour le bien-être de la femme. Au-delà de Sagan, l’histoire culturelle et traditionnelle d’une société, sa manière de traiter ses femmes est convoquée dans ses silences parfois complices et destructeurs. Un silence qui se personnifie dans une forme de patriarcat suicidaire et de représentation féminine complexée qui masquent un cri, celle de la narratrice qui représente toutes les femmes.
J’ai oublié d’être Sagan c’est aussi l’histoire d’une condition : la condition humaine comme Bonjour Tristesse. Deux ouvrages, deux types de frustrations entre malentendus, soumissions, incompréhension, chutes et désirs de liberté.
J’ai oublié d’être Sagan pour être moi”, pourrait-on dire.
J’ai oublié d’être Sagan c’est aussi l’histoire d’une condition : la condition humaine comme Bonjour Trist
La particularité de ce roman réside en ce qu’il fait cohabiter la conscience des méfaits de la tradition avec le désir de liberté et d’émancipation. En ce sens, le livre de Nassira Belloula est novateur parce qu’il ne décrit pas seulement le vécu, mais aussi le pensé et le re-pensé à travers la réflexion profonde de la narratrice. Une certaine rupture est inhérente à la composition du roman entre les chapitres. Si Bonjour Tristesse ou encore Une si longue lettre de Mariama Bâ, sont des romans précurseurs sur la condition féminine, j’ai oublié d’être Sagan est un roman qui souligne l’urgence de continuer à écrire sur la condition de la femme qui a besoin d’être révélée constamment au monde. En ce sens, il est un roman d’initiation certes, mais aussi de continuité parce qu’il est en étroite consonance avec son temps voire son espace : écrire la femme pour survivre en tant que femme.
Dire que j’ai adoré ce roman serait excessif, mais ne trouvant pas de mot qui corresponde à ce que j’ai ressenti en le lisant, j’emprunte donc le verbe adorer. J’ai adoré ce roman, car il se situe dans la lignée des grands romans sur la condition féminine que j’ai lus à ce jour.