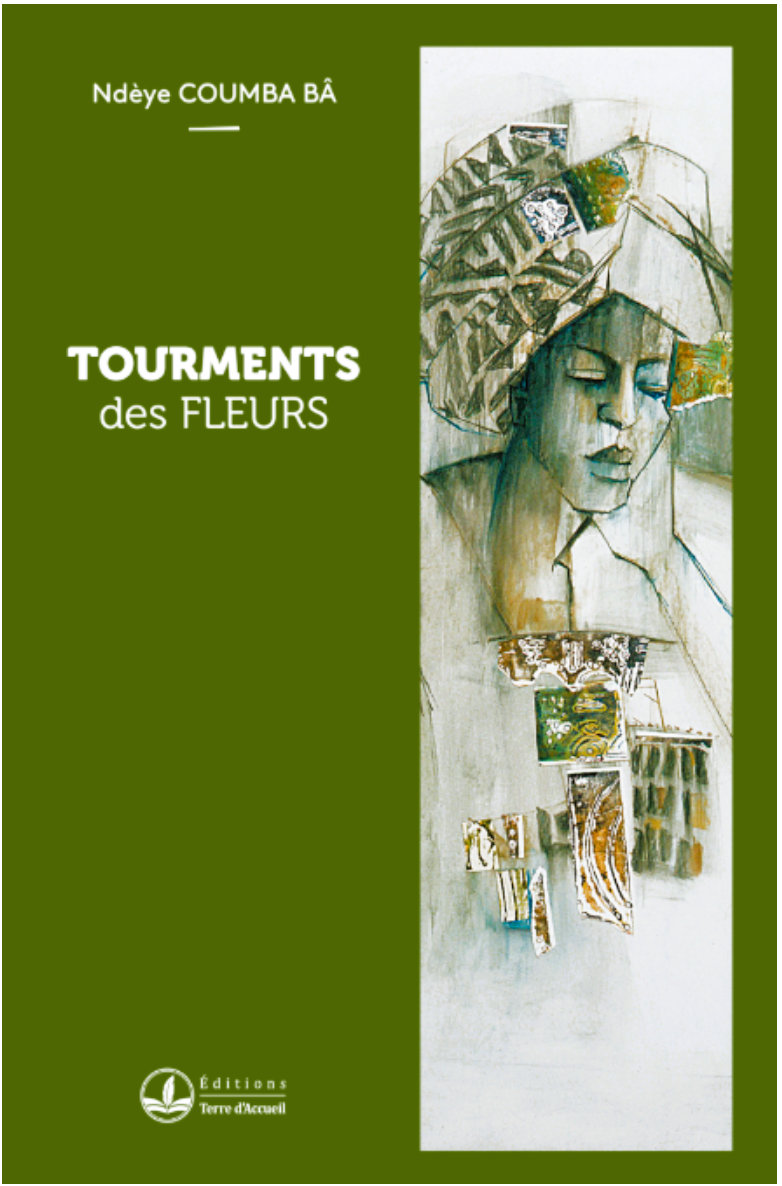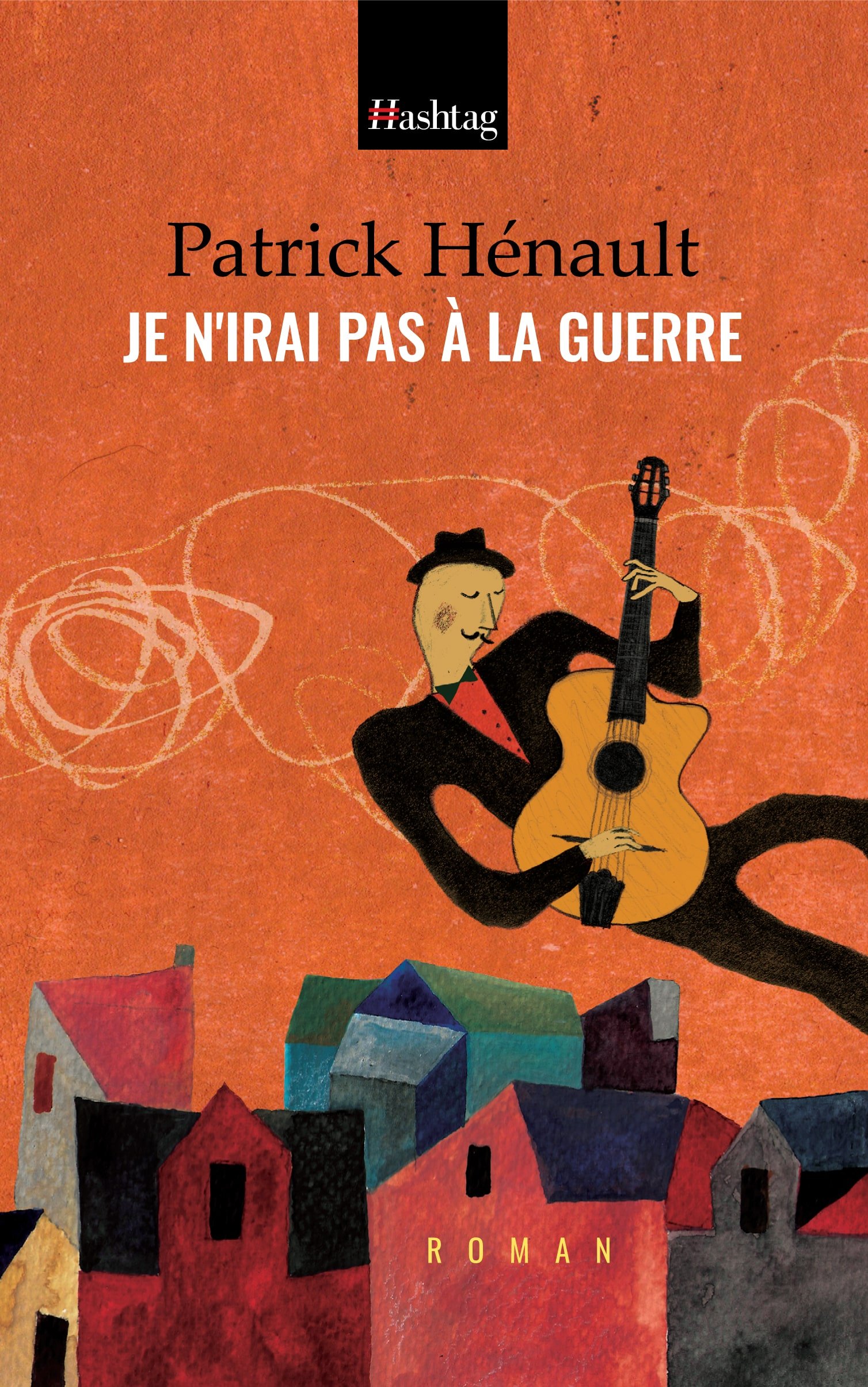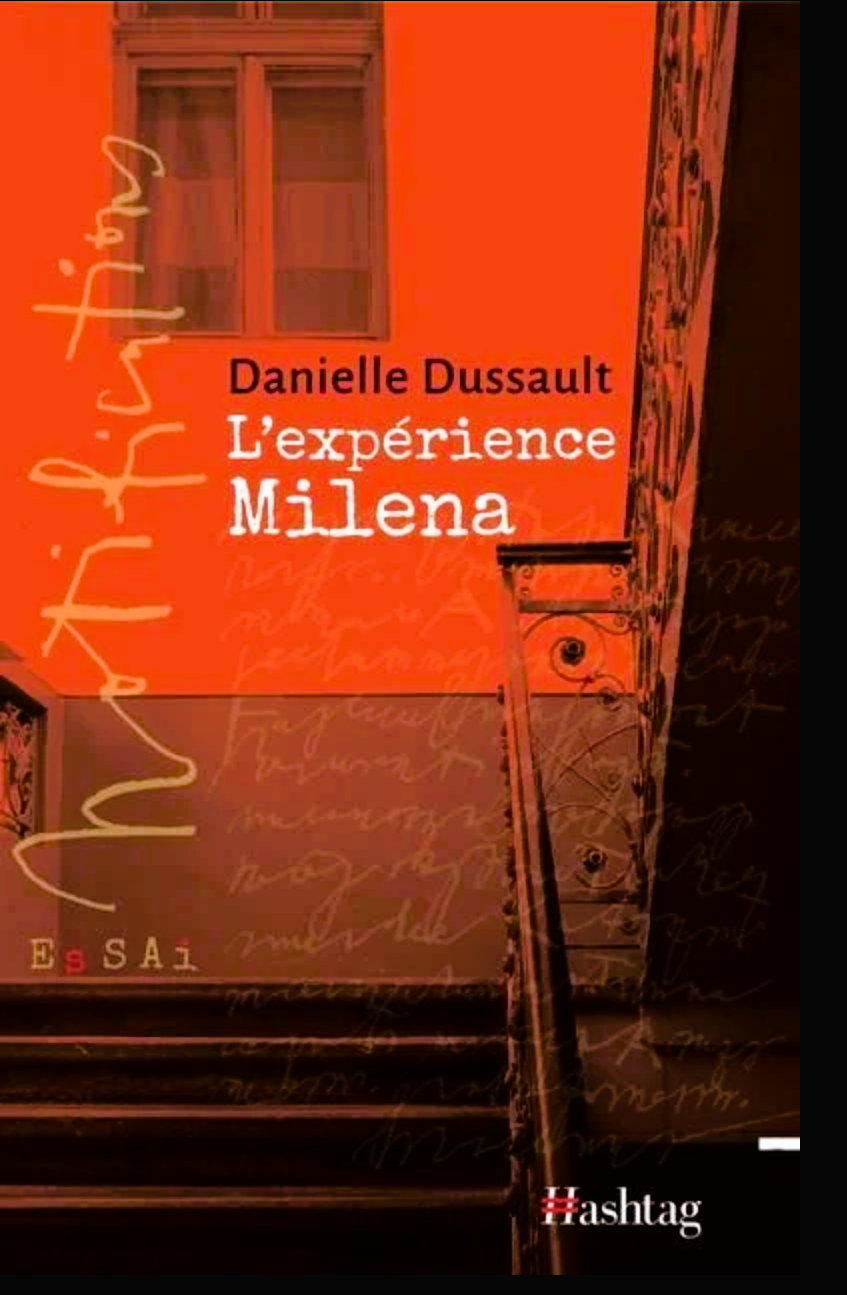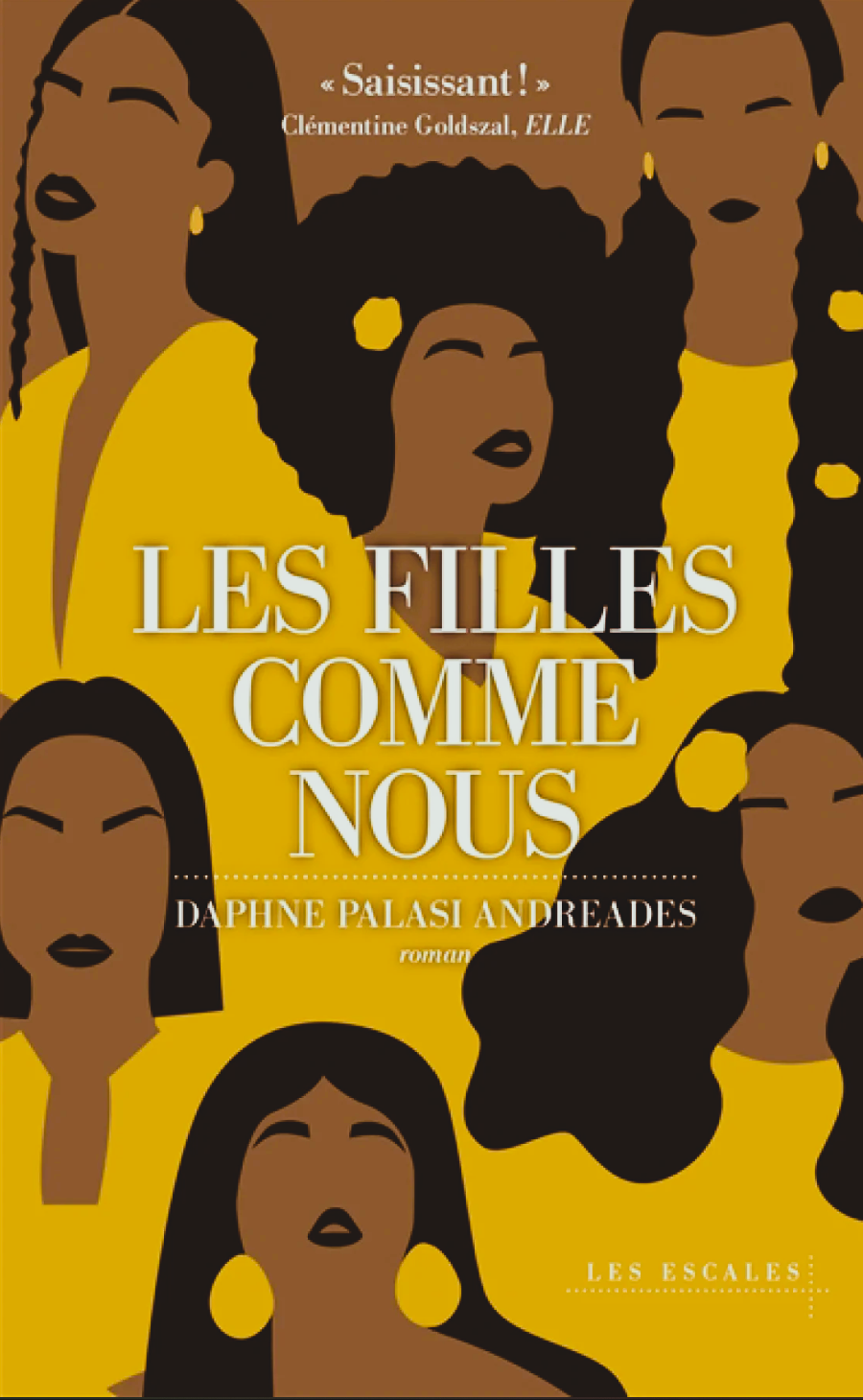Née dans une communauté autochtone
Joséphine Bacon, née en 1947, est originaire de Pessamit, un territoire situé sur la Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent au Québec. Elle appartient à la communauté innue, laquelle est constituée des autochtones appelés « Montagnais » (peuples des montagnes), nom qui leur avait été donné par les premiers explorateurs français en Amérique. Ce n’est qu’à partir de 1990 qu’ils adoptent officiellement le nom « innu » qui signifie « être humain » ou tout simplement « humain » dans leur langue maternelle, l’innu-aimun.
Ce peuple de la forêt, qui vivait essentiellement de la chasse, de la pêche et des plantes sauvages, était connu pour son nomadisme et son attachement à la tradition. Joséphine Bacon fait ainsi partie des milliers d’enfants autochtones envoyés de force dans les pensionnats religieux pour y être « civilisés », disait-on, avec en prime de nombreux abus et maltraitances qu’ils subissaient. Aujourd’hui de plus en plus minoritaires, les Innus ont subi les affres de la modernité au fil du temps. Malgré cela, ils sont d’une certaine manière restés accrochés à leur civilisation qu’ils gardent en éveil avec l’usage de leur langue maternelle.
Loin du pensionnat
Joséphine Bacon sera envoyée au pensionnat à l’âge de 5 ans et y restera jusqu’à ses 19 ans. Nonobstant le fait qu’elle y apprend à lire et à écrire, elle garde un pied dans sa culture d’origine. C’est ainsi qu’elle trouve un moyen pour continuer à parler sa langue maternelle qu’elle aime tant, avec d’autres pensionnaires dont elle est proche. Lorsqu’elle quitte le pensionnat — qui lui a permis de connaître différents Innus de plusieurs communautés, elle s’installe au Québec avec quelques-uns de ses amis pour se former en secrétariat.
Avec ses amis, elle ne parle que l’innu-aimun, bien que maitrisant le français et d’une certaine mesure l’anglais. Ottawa est sa prochaine destination où, pour une période de six mois, elle participera à une formation proposée par le Bureau des affaires autochtones. Cette formation lui permettrait, pense-t-elle, d’être plus apte en secrétariat et par conséquent de vite trouver du travail. Mais par la force des choses, Bacon ne travaillera jamais comme secrétaire.
À la recherche du travail
Joséphine Bacon s’installe à Montréal en 1968 pour chercher un emploi, mais cela s’avère difficile. Elle est obligée de faire de petits boulots pour survivre et rencontre des anthropologues qui travaillent sur les Innus du Labrador et du Québec. Il s’agit de Rémi Savard, Sylvie Vincent et José Mailhot. Elle deviendra leur traductrice-interprète. Une belle aventure grâce à laquelle elle apprend davantage sa langue maternelle ainsi que les mythes et contes de la communauté autochtone. Elle réapprend sa langue maternelle, qu’elle étudie dès lors dans un contexte académique sous l’impulsion des linguistes dont elle s’attache les services. Cela lui permet d’être une traductrice avérée et de commencer à enseigner l’innu-aimun.
Joséphine Bacon commence aussi à s’intéresser au cinéma. Après sa formation à l’Office national du film du Canada, elle devient documentariste. Le premier film qu’elle réalise porte un intérêt sur l’histoire des Innus. Elle réalise par la suite : Ameshkuatan — les sorties du castor en 1978 et Tshishe Mishtikuashisht — le petit grand européen, Johan Beetz en 1997. Elle participe à la série télévisée Mupu (2002) ; à la série Carcajou Mikun, Finding our talk ; et Innu-Assi.
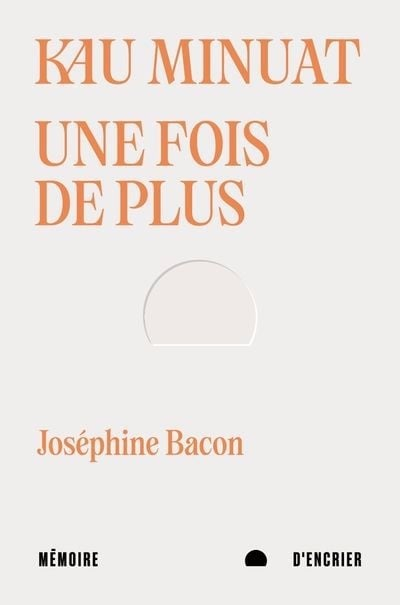
Le hasard fait bien les choses
Joséphine Bacon arrive à l’écriture par hasard. Alors qu’elle est déjà traductrice, auteure de plusieurs films documentaires et enseignante, elle fait des rencontres déterminantes qui la pousseront à l’écriture, la poésie notamment. C’est ainsi qu’elle se fait découvrir en 2008, à travers la parution du recueil collectif, Aimititau ! Parlons-nous ! (Mémoire d’encrier). Et principalement avec son premier livre intitulé Bâtons à message/Tshissinuatshitakana (Mémoire d’encrier, 2009).
Ce recueil de poèmes naît presque de manière banale lors d’un diner avec les poètes Laure Morali et Rita Mestokosho. Joséphine Bacon, sous forme de distraction, écrit les vers suivants : « Je me suis faite belle / pour qu’on remarque / la moelle de mes os, / survivante d’un récit / qu’on ne raconte pas. » Ces vers lui vaudront des encouragements de Laure Morali qui, après que Bacon a décidé d’en faire un recueil de ses différents poèmes, affirmera que si les premiers vers de l’auteure étaient un fait de hasard, il est clair que le hasard fait bien les choses. Ce premier recueil sera bien reçu, il remportera le Prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal en 2010.
Deux langues, deux cultures
Les livres de Joséphine Bacon célèbrent bien évidemment sa terre natale et la culture autochtone d’une part, et sa terre d’adoption d’autre part. Ses poèmes sont par moment des marques de reconnaissance, des hommages aux aînés qui lui ont donné énormément en lui transmettant des valeurs traditionnelles dont elle est fière aujourd’hui. Elle travaille également à transmettre et à laisser un riche héritage aux jeunes générations afin qu’elles puissent continuer le travail des aînés, celui de perpétuer la culture des Premières Nations.
Les textes de Joséphine Bacon sont généralement bilingues. Ils sont pensés dans sa langue maternelle et retranscrits en français. Ses titres apparaissent en français, suivis d’une traduction en langue innue et il en est de même avec ses différents poèmes. Au-delà de son premier recueil déjà cité, on peut le voir avec son second recueil, Un thé dans la toundra — Nipishapui nete mushuat (Mémoire d’encrier, 2013), finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général en 2014. Son troisième livre également, Uiesh — Quelque part (Mémoire d’encrier, 2018), Prix des libraires 2019, catégorie poésie, un autoportrait qui rend hommage à Montréal parce que cette ville a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui, affirme-t-elle. C’est le cas également avec son quatrième recueil, Kau minuat — Une fois de plus (Mémoire d’encrier, 2023).
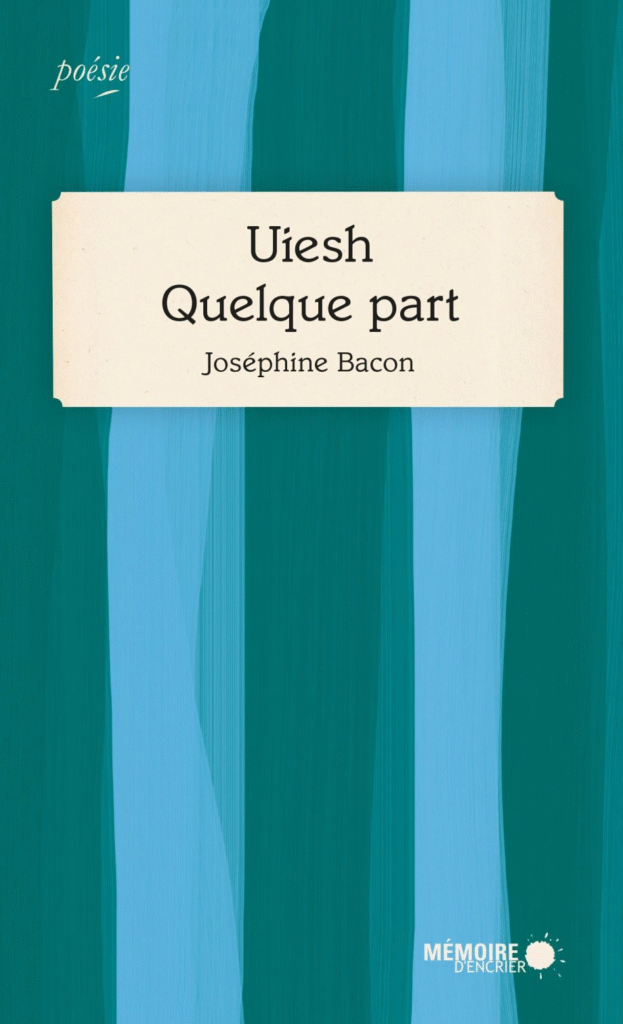
Conclusion
En fin de compte, Joséphine Bacon a longuement contribué à faire connaître la culture innue, elle enseigne la langue innu-aimun depuis des décennies, sans compter les ateliers d’écriture et les conférences qu’elle offre de manière infatigable au Canada. Pour ses importants travaux portant à valoriser la civilisation autochtone depuis 1970, Bacon a obtenu un doctorat honorifique en anthropologie à l’Université Laval en 2016, ainsi qu’à l’Université du Québec à Montréal en 2021.
BORIS NOAH