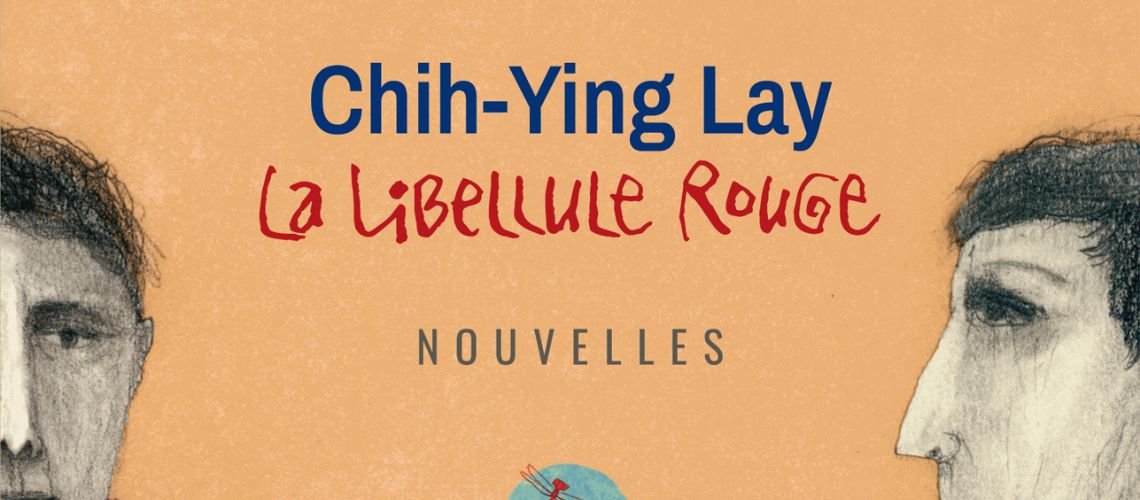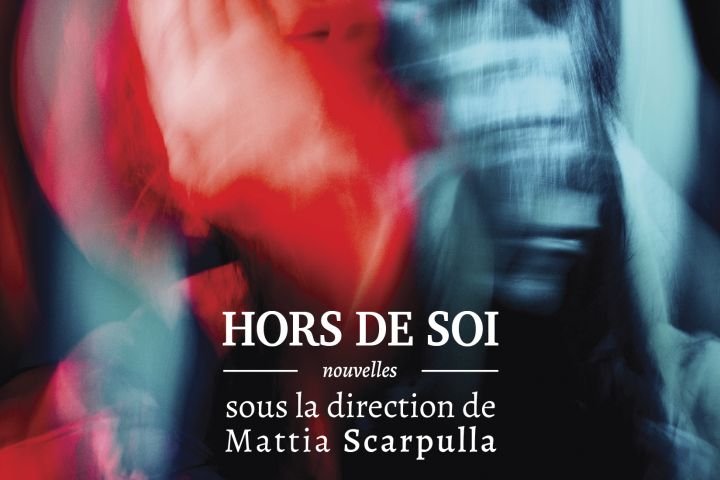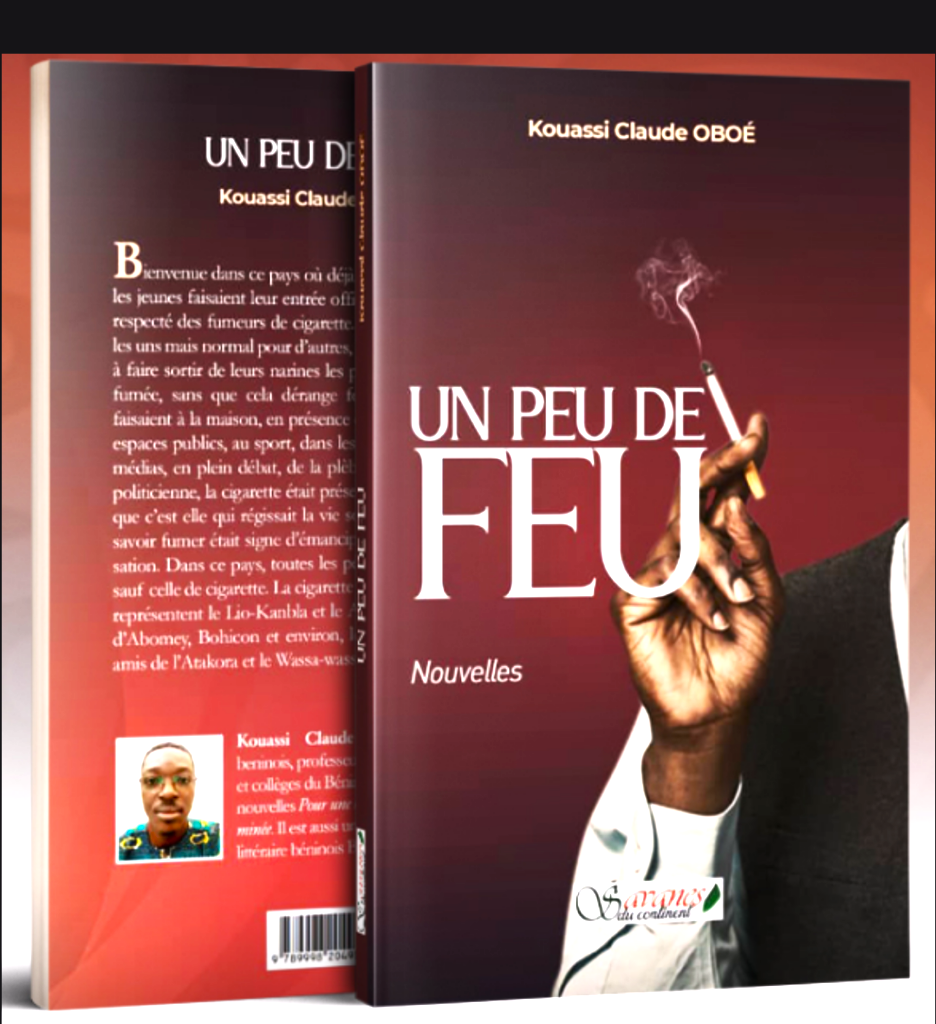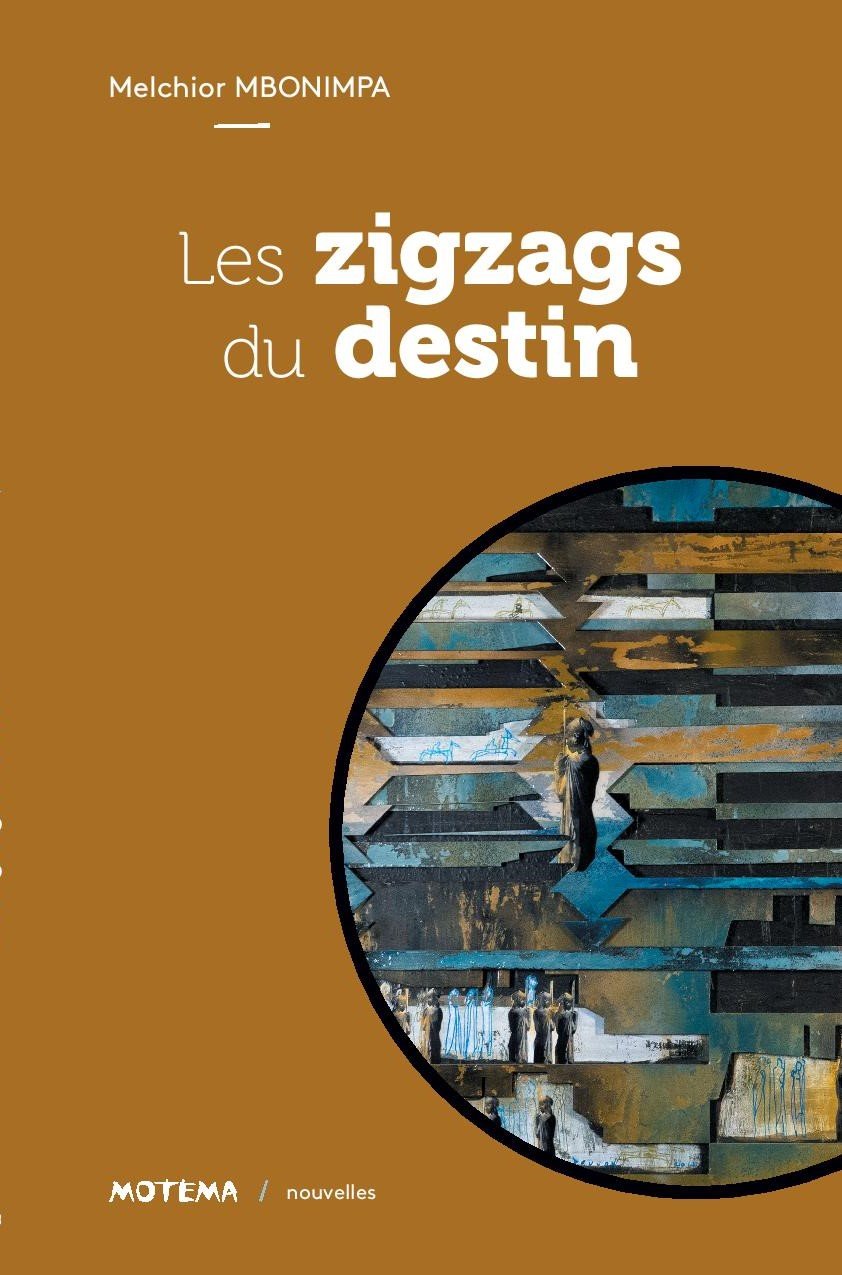Depuis plus d’une décennie, Chih-Ying Lay œuvre en bordure de pays littéraire. À petit bruit, avec fidélité et persévérance. Comme auteur de quelques ouvrages primés, il explore l’existence en général, d’où qu’elle émerge. Les dix nouvelles de son recueil de nouvelles, La libellule rouge, en sont la preuve. Si ses œuvres sont des œuvres de fiction, il demeure que sa posture de scientifique et ses origines y sont très présentes. Peut-être moins des nouvelles sur une vie de scientifique que des réalités sur la condition humaine. Ces nouvelles qui laissent les émotions en alerte; des histoires humaines tout simplement. Recueil au demeurant parfaitement ordonné, sa ligne directrice autour des thématiques suivantes: les migrations, en tant qu’elles peuvent puissamment influer sur nos existences.
Dans la nouvelle Le mal du pays, par exemple, le narrateur évoque avec nostalgie des souvenirs pour se donner un passé avec une famille aux yeux de ses camarades. On note aussi la présence des souvenirs en lien avec une histoire, un contexte ou une situation. L’expérience du mal du pays (expression courante) de l’évocation des origines et du besoin de se créer des souvenirs dans une terre d’immigration sont des thèmes profonds et riches en nuances. Le poids de la mémoire collective en est une illustration. Dans la nouvelle, le narrateur qui sait pourtant qui il est, semble avoir besoin du crédit des autres pour exister. Alors, il crée son monde et porte ainsi le fardeau des histoires et des traditions transmises par ses ancêtres. Il ressent fort attachement à ses origines familiales et a besoin de l’exprimer. Malheureusement, confronté à une identité hybride, entre ses origines et sa situation actuelle, il (narrateur) se retrouve souvent en quête de son propre sens de l’identité. Il pourrait se sentir déchiré entre deux mondes, cherchant à trouver un équilibre entre ses racines et son environnement actuel. On peut noter ici certains rituels personnels, la nostalgie et le besoin immanent de souvenirs tangibles pouvant l’aider à combler un vide qu’il est peut-être le seul à ressentir. Vide, voire manque, distance émotionnelle. Plusieurs réflexions surgissent à la lecture de cette nouvelle, mais ce qui semble être présent c’est cette continuité (non pas réconciliation) avec le passé, continuité qui pourrait s’affirmer avec le désir de réfléchir sur son héritage culturel et son identité.
La relation entre un petit-fils et sa grand-mère peut être incroyablement spéciale et unique. Dans la nouvelle Épitaphe pour un vers, la relation entre le narrateur et sa grand-mère transcende les barrières générationnelles. Sa grand-mère est tout pour lui, ou simplement le seul visage féminin de son entourage. Malgré la différence d’âge, ils partagent une connexion profonde basée sur l’amour, le respect et la compréhension mutuelle. En l’absence de la mère, la grand-mère joue un rôle important dans l’éducation et le développement de son petit-fils. Suppléant au père qui est tout le temps au travail, elle lui transmet des connaissances, des compétences pratiques et des valeurs familiales. Elle est en quelque sorte une source de sagesse et de conseils précieux le père et le fils.
… Ama était la seule mère que j’avais connue
J’ai confondu la notion de mère avec Ama jusqu’à l’école primaire. C’est vrai que je connaissais la mère de Mel, son ama, étant décédée, mais pour moi les deux termes désignaient les femmes au foyer (…). Le terme chinois mandarin pour ama était nainai. Je n’arrivais pas à comprendre ce que cela signifiait. Je supposais que nainai désignait un proche parent que je n’avais pas, alors j’ai laissé le champ vide. J’ai fini par inscrire les symboles bopomofo des syllabes du mot ama dans l’espace destiné à la “mère”
… Un soir, pendant le dîner, j’ai demandé à la dame d’en face, à qui je ne parlais que très rarement, ce qu’était une mère. En souriant, elle m’a répondu : “ Tout le monde a une mère, tu sais, même toi. Demande à ton père.”
Grandir sans une mère est une expérience déchirante pour lui, et cela se voit par ses réactions, ses réflexions et ses questionnements. Il se demande souvent pourquoi sa mère n’est pas là pour lui. Il aimerait bien que son père lui disque quelque chose, mais personne n’en parle.
Usant d’autant d’inventions que d’érudition joyeuse et d’ouverture d’esprit, Chih-Ying Lay convie son lecteur à vivre certains fragments d’existence comme l’identité, la culture, la famille. Ce faisant, d’une langue sans le moindre apprêt, souple et coulante, il nous donne à contempler quelques vignettes d’un univers précis dans laquelle tout le monde peut se retrouver. La libellule rouge est une immersion dans le monde de la vie : un parcours identitaire.
Karl Makosso