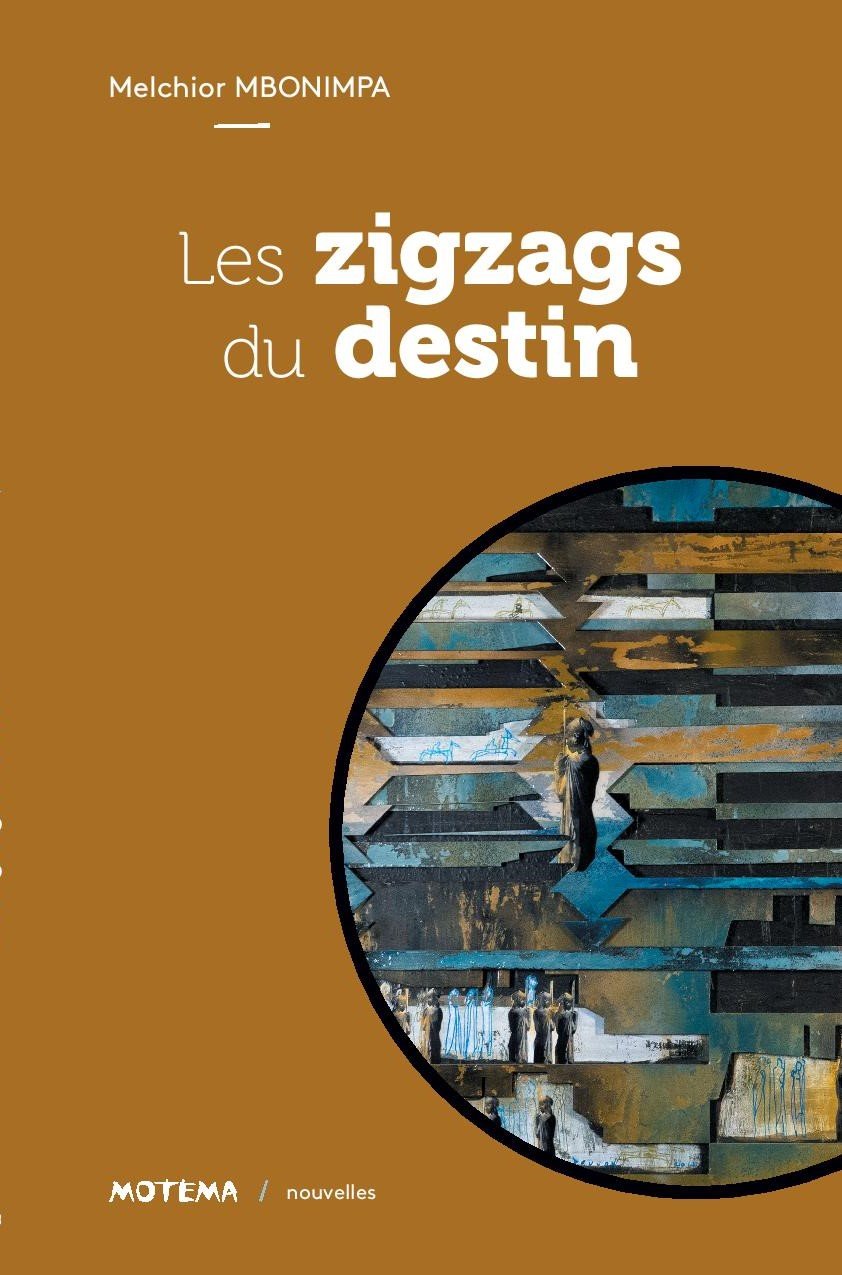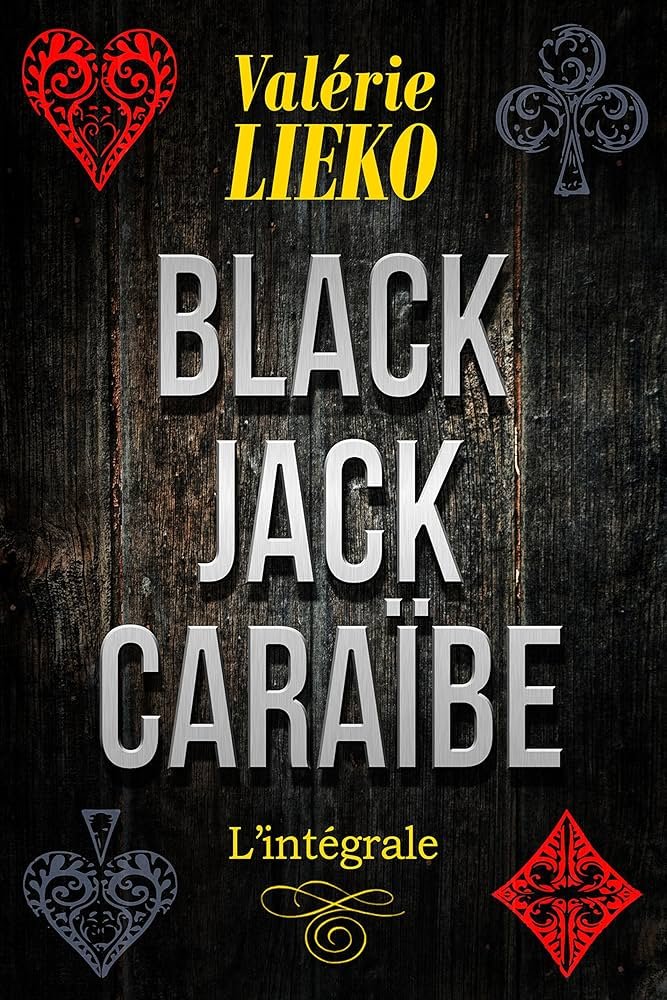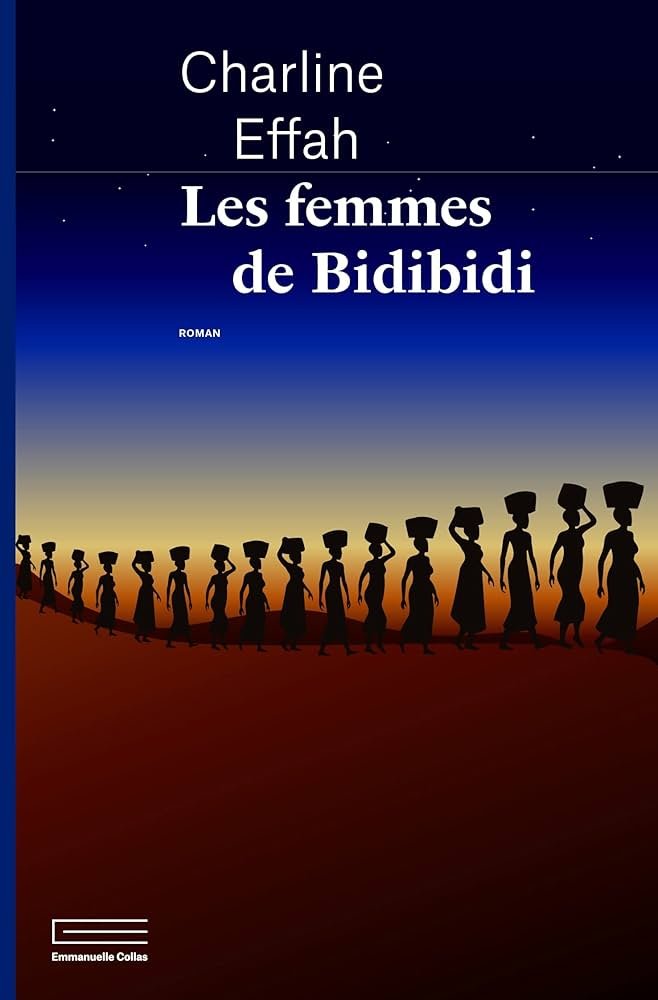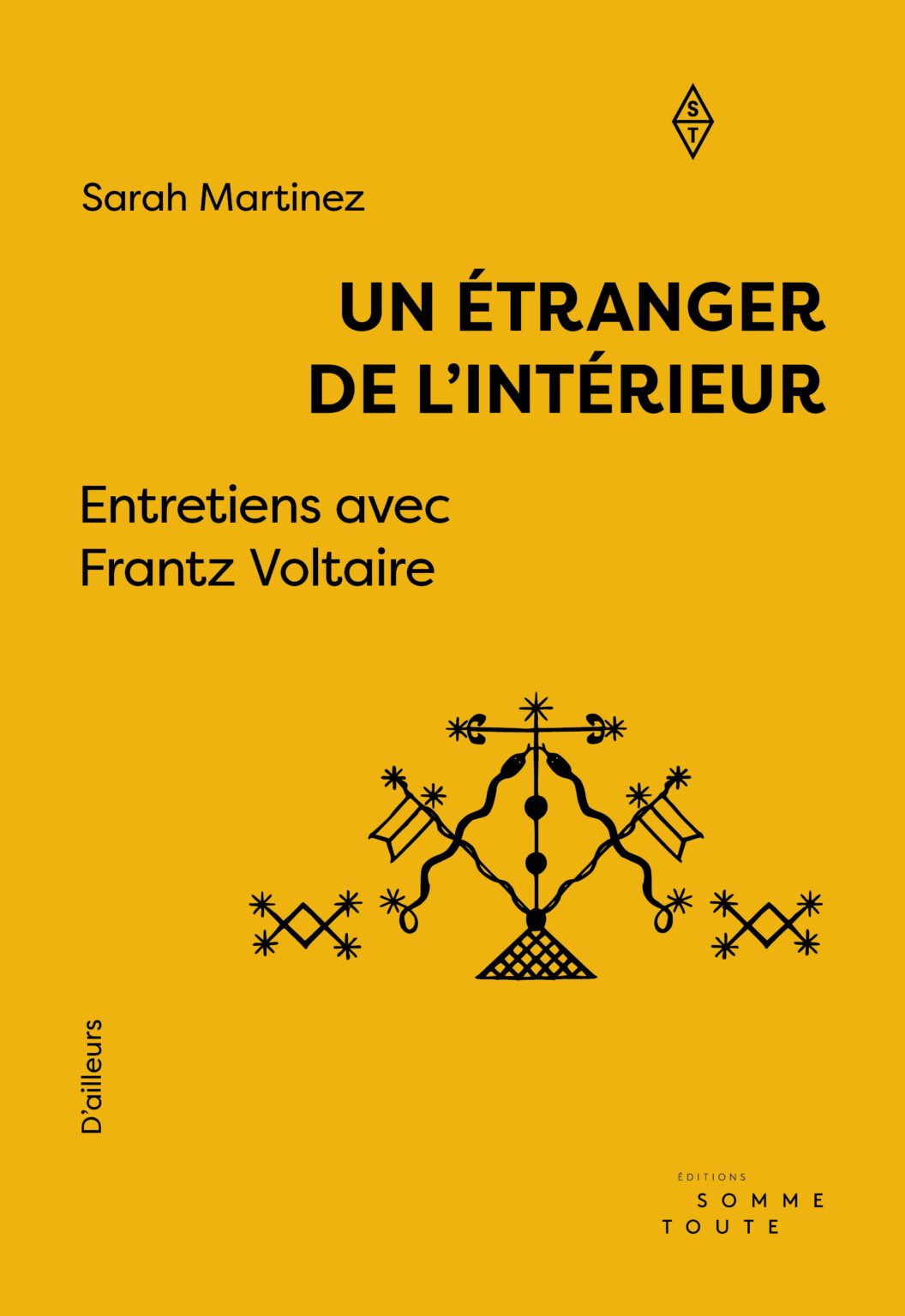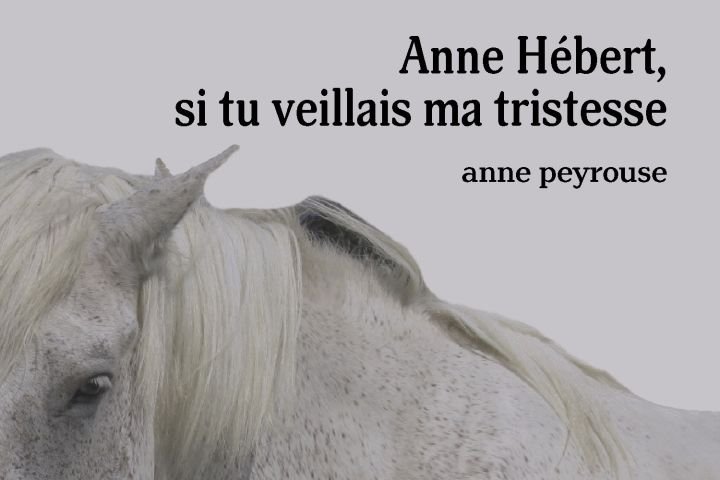Mon analyse ici s’appuie sur deux nouvelles du recueil.
La nouvelle « Le rêve en éclats » : anatomie d’une désillusion migratoire
Un immigrant africain raconte son expérience d’immigration au Canada. Malgré ses diplômes et son ambition, il doit enchaîner les petits boulots, changer d’identité et affronter l’érosion de son rêve initial.
La chute sociale d’un homme surqualifié
Dès l’ouverture de la nouvelle, l’auteur déconstruit le mythe de l’Occident comme terre de réussite immédiate. Le narrateur confie :
« Au début, pour ne pas mourir de faim, j’ai accepté des emplois dans la catégorie des travaux bas et humbles : nettoyages d’édifices divers, écoles, hôpitaux, bâtimens administratifs, tonte de gazon sur des grandes pelouses en été; déneigement en hiver… »
Cette énumération exhaustive et répétitive des tâches serviles traduit l’épuisement, mais aussi la déchéance sociale d’un homme surqualifié, forcé d’accepter des emplois « indignes » à ses yeux. Cette chute s’aggrave dans la durée :
« Une année s’est écoulée, Puis deux, puis trois. Je ne comptais plus le nombre de dossiers que j’avais envoyés. »
Le temps devient flou, l’attente s’étire, et l’espoir s’effondre dans la répétition vaine. On note ici une écriture du découragement, où l’effort n’engendre aucune reconnaissance.
Christopher Wolf : survivre ou se trahir ?
Dans un acte extrême de survie identitaire, le narrateur change de nom :
« J’ai entrepris les démarches pour changer de nom et je suis devenu Christopher Wolf. »
Ce passage marque une fracture existentielle. Le nom, porteur d’histoire, de culture et d’origine, est abandonné pour une identité « neutre », occidentale, presque animale (« Wolf »). Ce geste symbolise la violence psychologique de l’intégration forcée, mais aussi une forme de reniement tragique.
Une double critique : système d’accueil et diaspora
Le système canadien est critiqué pour son hypocrisie institutionnelle : les diplômes ne sont pas reconnus, les procédures sont longues, les opportunités rares. Mais la nouvelle vise aussi les compatriotes migrants, évoquant les « mensonges envers les compatriotes et la désillusion ». Le rêve est perpétué par ceux-là mêmes qui en souffrent, alimentant l’illusion pour préserver une image de réussite.
La nouvelle « Les funérailles coutumières » : l’exil jusque dans la mort
Un immigrant africain décède au Canada. Sa veuve exige que son corps soit rapatrié selon les coutumes. La communauté doit alors cotiser, révélant tensions, imprévus et malaises entre deux mondes.
Le corps comme enjeu symbolique
Le défunt devient un enjeu entre deux territoires : va-t-il reposer dans la terre d’accueil ou celle des ancêtres ? Le respect des rites pousse la communauté à agir :
« Tous s’étaient ralliés à l’idée d’un strict respect des coutumes du pays d’origine de Mwanza. Sa veuve devait donc obtenir ce qu’elle demandait. »
L’auteur dépeint une communauté unie par le devoir, mais aussi incapable d’anticiper la mort dans l’exil (absence d’assurance vie, pas d’économies). Cela souligne une non-intégration latente, comme si ces migrants restaient « en transit » même après des années d’exil.
Le coût du respect culturel
La solidarité devient une charge économique, révélatrice de fractures internes. Le rapatriement est coûteux et repose sur une entraide de survie, non sur un système d’assurance sociale. Ce manque de prévoyance trahit une forme de double marginalisation : l’immigré n’est ni pleinement intégré au système occidental, ni complètement libéré des exigences traditionnelles.
Rupture avec l’autorité ancestrale
Le deuxième décès, celui du fils du roi, donne une tournure plus tragique et absurde à la nouvelle : on ne parvient même pas à joindre le père du défunt. L’autorité traditionnelle (le roi) est hors de portée, illustrant une perte de lien avec la hiérarchie ancestrale. C’est l’échec final de la tentative de rattachement au pays d’origine.
Deux nouvelles, une même fracture identitaire
L’exil à deux niveaux de rupture
Dans « Le rêve en éclats », le héros change de nom pour survivre. Dans « Les funérailles coutumières », même le corps du défunt ne trouve pas de lieu d’appartenance. Dans les deux cas, le lien entre l’individu et son identité d’origine est rompu ou malmené sous la pression de la société d’accueil.
La collectivité face au destin individuel
Le destin n’est jamais individuel : il est collectivement négocié ou imposé. Le changement de nom, comme le rapatriement du corps, implique la communauté, les attentes sociales, les obligations culturelles. On retrouve le conflit entre aspirations personnelles et poids collectif.
Humour noir et sagesse amère
Malgré la gravité des sujets, Mbonimpa insère des touches d’humour discret, souvent noir, qui soulignent l’absurdité des situations. Ce rire est une forme de résistance, mais aussi un révélateur de la condition humaine confrontée à ses propres contradictions.
Une humanité écartelée mais digne
Les Zigzags du destin est un recueil lucide et poignant qui dresse un portrait sans concession de l’expérience migratoire, à la fois physique, identitaire et spirituelle. À travers les récits de désillusion, de perte, d’humiliation mais aussi de résilience, Melchior Mbonimpa interroge la place de l’individu entre deux mondes et montre que le destin ne se trace jamais en ligne droite.
Ce recueil donne voix à une humanité écartelée, mais digne, qui tente de négocier son chemin dans les fissures de l’histoire. Je vous encourage à lire les autres nouvelles.
Nathasha Pemba