« Ce pays a pour deuxième nom : Folie. »
Un couple, un terrain… et un piège invisible
Tout commence par un rêve classique, presque banal : voyager au pays, construire une maison. Ndombissi, Congolais vivant en France, revient à Brazzaville avec Élizabeth, sa compagne française, paléontologue de métier. Tous deux projettent d’acheter une parcelle au bord du fleuve, à la fois havre personnel et base de recherche pour Élizabeth, qui ambitionne de retrouver les traces du mythique Mokélé Mbembé, ce « dinosaure » légendaire tapi dans les eaux congolaises.
Mais très vite, le projet de vie glisse vers une farce tragique. Le terrain convoité se révèle au cœur d’un scandale foncier : vendu à plusieurs personnes, convoité par des réseaux plus ou moins mafieux, couvert de documents falsifiés, il devient le déclencheur d’un engrenage de mensonges, de pressions et de conflits dans lequel le couple se retrouve piégé. Ce qui aurait pu être un conte d’amour et d’exploration scientifique se mue alors en chronique de la désillusion.
Une interculturalité à l’épreuve de la réalité
Ce qui frappe d’emblée dans Parcelle à vendre, c’est la subtilité avec laquelle Arian Samba explore les dynamiques interculturelles. Le couple formé par Élizabeth et Ndombissi n’est pas idéalisé : leur lien est fort, sincère, mais mis à rude épreuve par un environnement qu’aucun des deux ne maîtrise vraiment. L’auteur interroge ici les limites de l’interculturalité, surtout lorsqu’elle quitte le confort de l’Occident pour se confronter aux rouages d’un État défaillant.
Si en France leur couple ne posait aucun problème, à Brazzaville, tout change. Élizabeth, bien que respectueuse, n’est pas neutre. Elle incarne ce regard occidental à la fois fasciné et troublé par l’Afrique. Elle observe sans juger, mais son étonnement constant dévoile un imaginaire latent : celui d’un continent à la fois rêvé et redouté, parfois caricaturé. Le roman joue de cette tension sans jamais tomber dans le manichéisme.
Son compagnon, bien qu’issu du pays, n’en est pas moins étranger. Membre de cette diaspora souvent perçue comme naïve ou présomptueuse, Ndombissi se heurte à la réalité de ce « chez lui » qu’il ne reconnaît plus. Le roman montre avec justesse comment le retour au pays peut devenir un retour à l’incompréhension, où l’on se rend compte que mémoire et appartenance ne suffisent pas à reconstruire un ancrage.
Mokélé Mbembé : monstre paléontologique ou métaphore politique ?
La quête de Mokélé Mbembé donne au récit une épaisseur symbolique particulièrement forte. Ce monstre mi-dinosaure, mi-légende fluviale, souvent présenté comme une chimère d’explorateur, est ici revisité comme une figure métaphorique du pouvoir, ou plutôt d’un passé politique enfoui mais toujours agissant.
On comprend progressivement que Mokélé Mbembé n’est pas qu’un animal préhistorique : il incarne un monstre politique, relique d’un marxisme africain, vestige d’une époque d’idéologies flamboyantes et de projets collectifs aujourd’hui trahis ou oubliés. Cette dimension, que Samba installe avec finesse, renforce la profondeur du texte : le passé ne meurt pas, il hante les eaux troubles du présent.
Une société où la terre est une guerre silencieuse
Le nerf du roman, c’est bien sûr la dénonciation du chaos foncier. À travers cette histoire de parcelle achetée et volée, Arian Samba décrit avec acuité une réalité que connaissent bien des Congolais – et bien au-delà. Dans plusieurs pays africains, l’achat d’un terrain relève de la loterie, où documents administratifs, droits coutumiers, corruption politique et intérêts privés s’affrontent.
Ce que l’auteur montre avec beaucoup d’ironie, c’est que la propriété foncière devient un théâtre où l’absurde règne en maître. L’un des moments forts du roman, résolument satirique, voit un coq « muet » se mettre à chanter soudainement :
« Un coq que l’on croyait muet se mit subitement à chanter à l’heure où les gens du quartier vaquaient à leurs occupations. »
La scène, à la fois burlesque et prophétique, reflète parfaitement l’esprit du livre : un monde où même le silence se retourne contre vous, et où les repères logiques vacillent.
Entre humour noir et lucidité politique
L’un des grands atouts du roman réside dans sa tonalité volontairement hybride. Samba ne choisit jamais entre tragédie et comédie : il conjugue les deux et fait du rire une arme de résistance. Ses dialogues, ses situations cocasses, ses personnages secondaires hauts en couleur (voisins indiscrets, policiers zélés, vendeurs de papiers douteux) construisent un univers où le rire côtoie l’effroi.
Le roman n’est jamais pesant, bien au contraire. Mais sous la légèreté, on devine une colère sourde. Une dénonciation sans haine, mais sans naïveté, de ce que devient un pays quand l’impunité devient norme.
« Oh, ne me traitez pas de fou ! Qui n’est pas fou dans ce pays ? … Ce pays a pour deuxième nom : Folie. »
Cette citation emblématique, placée au cœur du récit, résume la thèse de Samba : le Congo – et peut-être bien d’autres États postcoloniaux – vit dans une logique où la folie devient la seule manière de survivre.
Un roman qui frappe juste
Parcelle à vendre est un roman qui marque. Derrière une intrigue en apparence simple – acheter un terrain et se faire arnaquer –, Arian Samba tisse une fresque dense qui touche aux questions de l’identité, du pouvoir, de la mémoire, de la corruption, de l’idéalité et de l’échec des grands projets d’émancipation.
L’écriture, précise, fluide, sans effets de manche inutiles, laisse toute sa place à la justesse du propos et à la vivacité des dialogues. On pense à Sony Labou Tansi, à Emmanuel Dongala, parfois à Alain Mabanckou, mais Samba a déjà sa voix propre, bien ancrée.
Avec Parcelle à vendre, Arian Samba réussit un pari difficile : faire rire sans céder à la légèreté, critiquer sans sombrer dans le pamphlet, raconter une histoire locale qui dit quelque chose de l’universel. C’est un roman de notre époque, ancré dans un pays bien réel, mais traversé par des tensions qui résonnent partout : la peur de l’effondrement, le soupçon envers l’État, la défiance envers la justice, et l’angoisse de ne jamais pouvoir « revenir chez soi ».
Un livre nécessaire, salutaire et intelligent.
Natasha Pemba




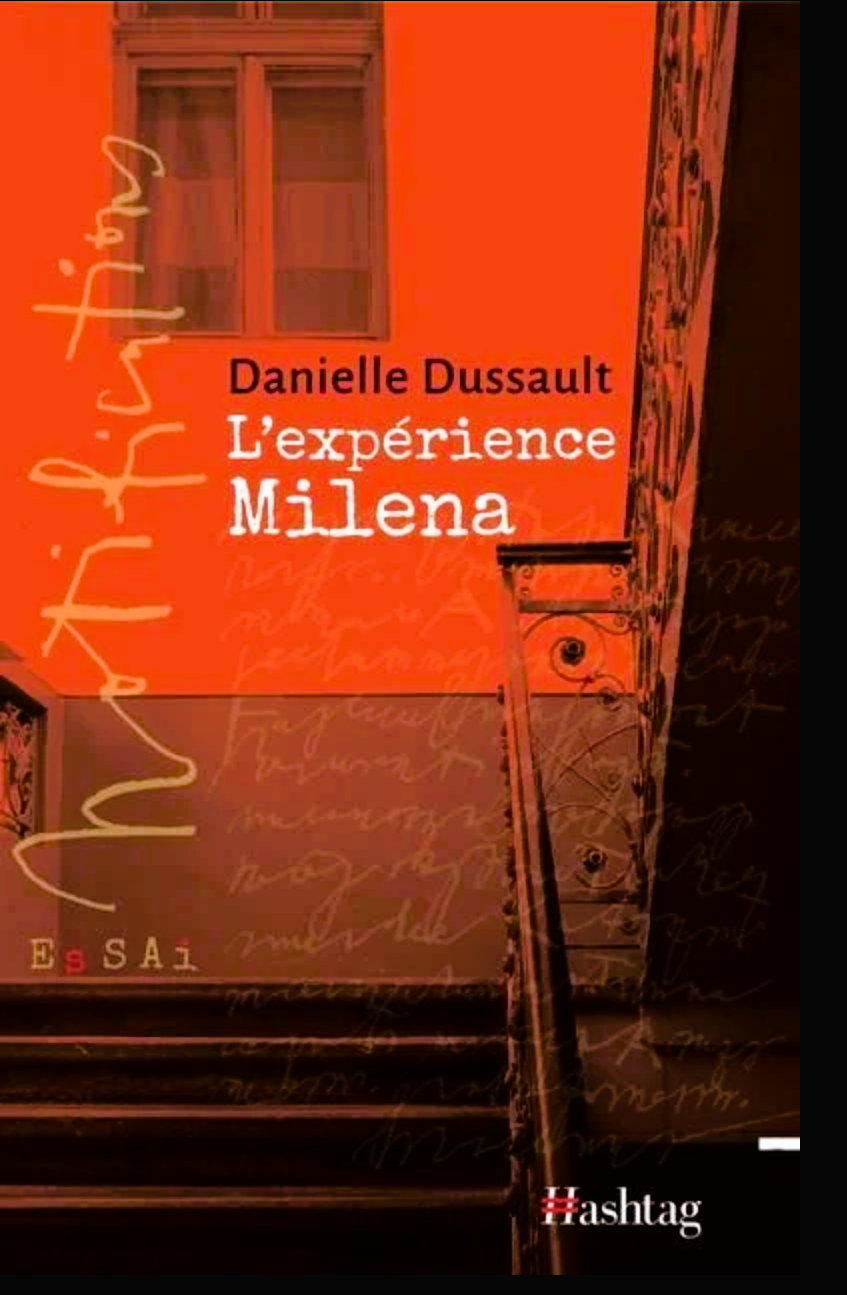



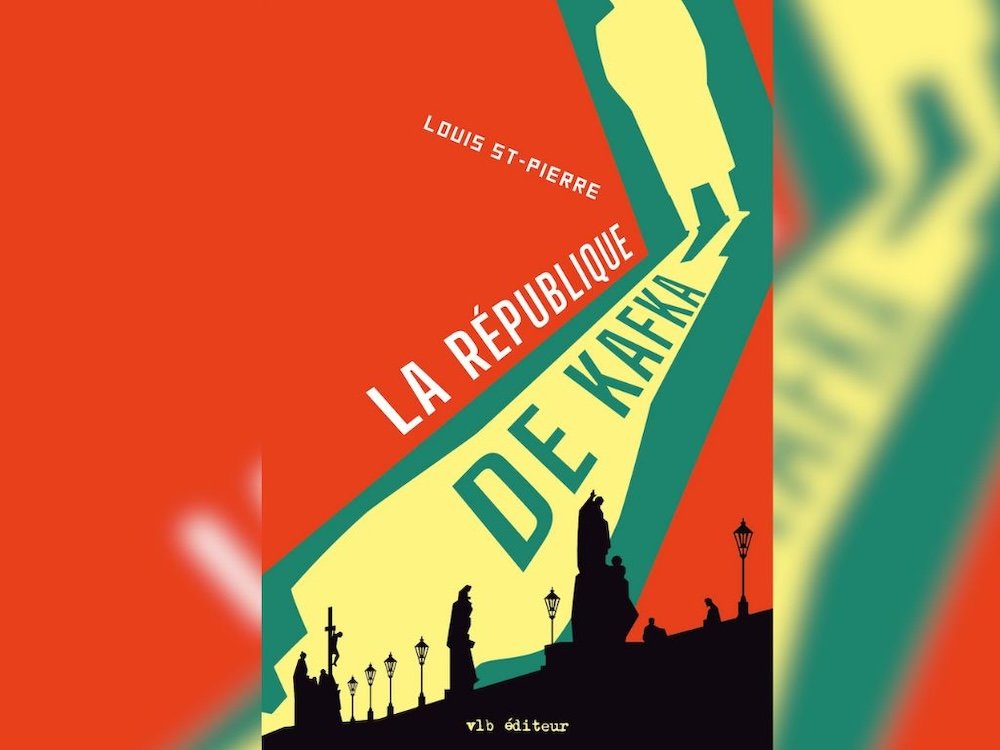

2 commentaires
Oui, très belle critique ! L’auteure me donne de nouvelles pistes de lecture. Ngoya oh !
Merci, mon ami Bedel.