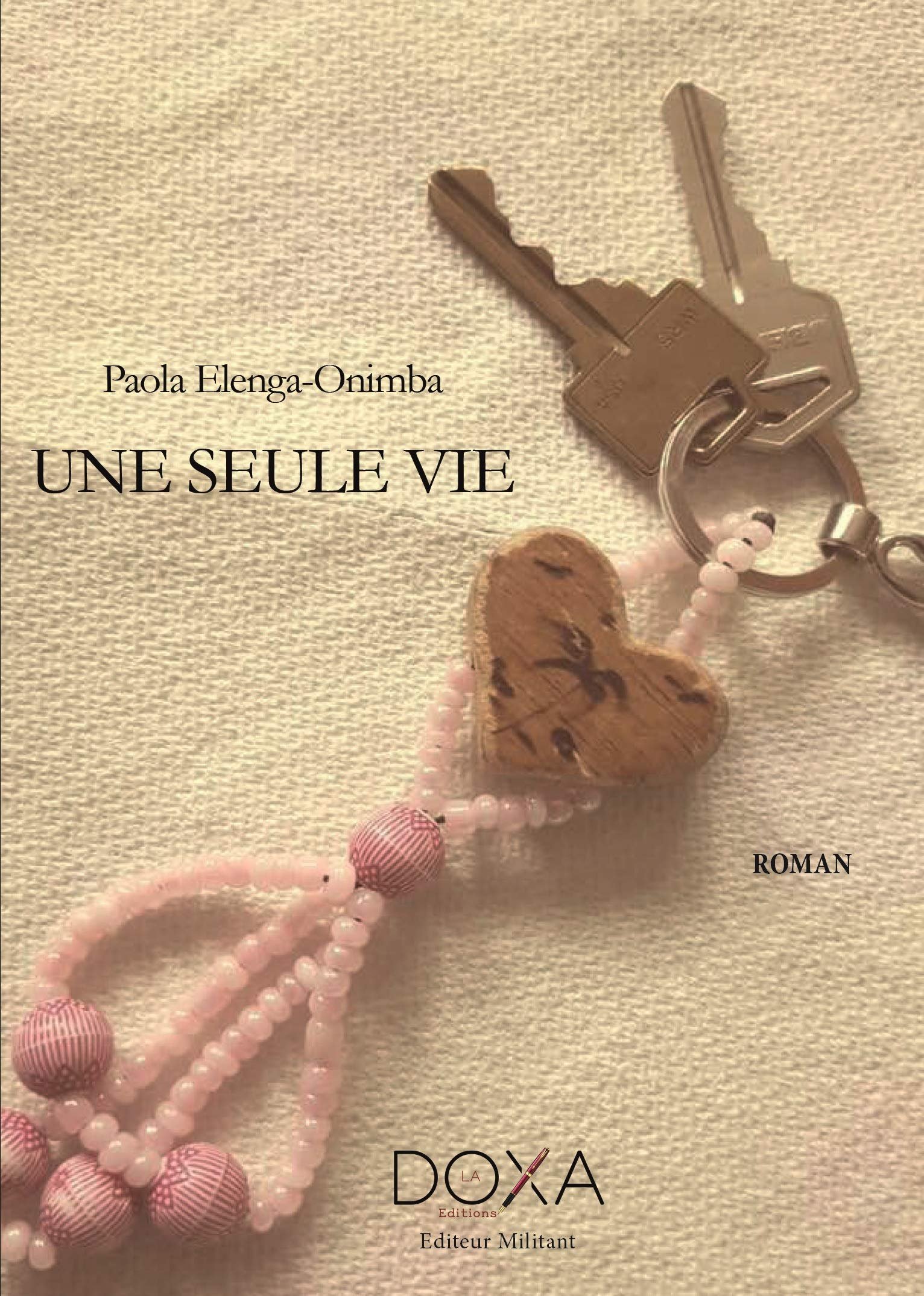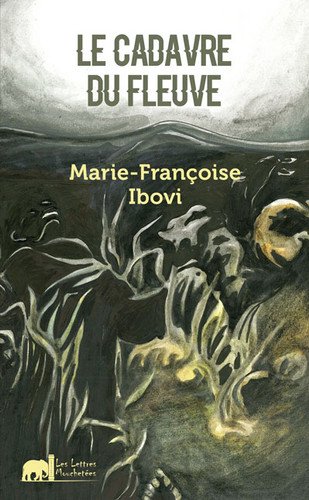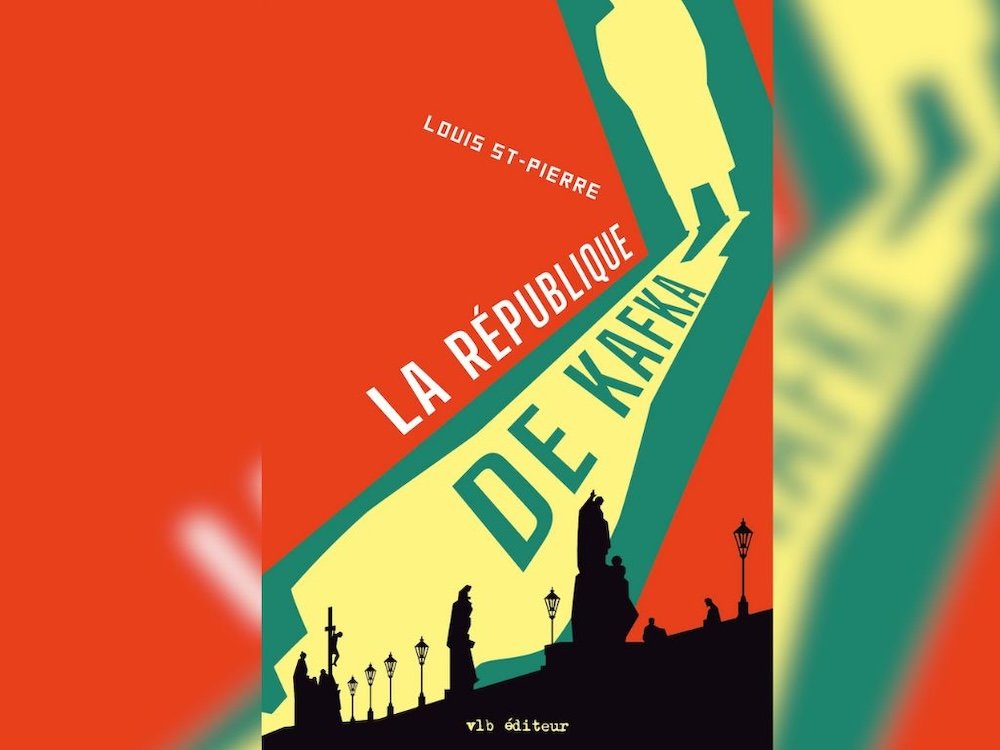Perdre sa mère, quand on est âgée de neuf ans seulement, relève presque de l’injustice, de l’intolérable. Malgré la présence de ceux qui restent, nous sommes conscients que personne ne peut remplacer une mère. Même quand ceux qui restent font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous rendre heureux ou heureuses, perdre une mère c’est perdre beaucoup de choses, c’est perdre le sourire, c’est voir certains de nos espoirs anéantis, c’est parfois voir voler en éclat une certaine harmonie intérieure, c’est être confronté à ses limites. Cela peut aussi être l’emprunt d’une voie de destruction personnelle. Telle est l’expérience de Queenie, la narratrice d’Une seule vie.
Tante Clara fait partie de ces femmes qui après ta mort ont positivement marqué ma vie. Cependant, ma mère à moi est juste irremplaçable. Déjà à cet âge-là, je savais qu’une mère était unique. Avec le temps, je peux l’affirmer sans ambages : on ne remplace pas une mère.
Une déclaration écrite seize ans après le décès de sa mère. Queenie parle de la rupture causée par la mort de sa mère, rupture qui a bouleversé le cours de sa vie, cette douloureuse absence qui l’a suivie partout. Elle redit ce qui l’a aidé à ne pas tomber dans le désespoir et de redonner à la vie sa chance. Comment vivre sans celle qui a été tout pour nous? Comment résister aux regards extérieurs qui nous prennent en pitié? Comment retrouver le chemin de l’espoir lorsque plus rien ne nous donne des raisons de tenir?
Une seule vie, un livre, comme me disait un lecteur, qui parle à tout le monde. Si le thème principal est le deuil, on y retrouve d’autres sujets comme la question de l’amour familial, de la fraternité et du besoin de croître, de la renaissance, etc. Voilà. Pour Paola Elenga-Onimba, même si la mort d’un être cher fait souffrir, il faut pouvoir avancer pour honorer le défunt ou la défunte, il faut pouvoir avancer pour exister soi-même. Ce livre ne nous rend donc pas tristes ou muets. Il nous invite à croire en la possibilité de la vie, malgré tout.
Lorsqu’elle a neuf ans, Queenie la narratrice perd sa maman. Son entourage, constitué principalement de son père et de ses tantes, décide de lui cacher cette perte. Ils obéissent certainement à la coutume qui consiste à croire qu’il y a des choses qu’on ne dit pas à un enfant. Malheureusement, ce silence et la pitié qu’elle lira dans les phrases et dans les regards de son entourage la plongeront dans une timidité sans nom.
Une seule vie est un récit autobiographique douloureux, un peu à la manière de la traversée de la mer Rouge. Un livre qui a dû s’écrire dans une fontaine de larmes tant il ne laisse pas son lecteur insensible, un livre qui a dû demander du courage pour aller à son terme. Paola Elenga-Onimba nous fait découvrir l’expérience de Queenie dont l’expérience douloureuse de la perte d’un être cher l’a conduite à cerner son milieu de vie et à se reconstruire intérieurement.
Le deuil, ou plutôt, disons, la mort est un passage obligé pour tout le monde. Néanmoins, la manière de vivre la mort est certainement ce qui diffère. En Afrique, les habitudes ont conduit les personnes à cacher la mort d’êtres chers ou bien à entourer l’annonce d’une mort de toute une pédagogie. Une pédagogie certainement sans méthode et sans humanité qui, parfois, finit par détruire des relations familiales ou à enfermer certaines personnes dans des certitudes infondées, sans enracinement dans le réel.
Paola Elenga-Onimba nous convie à une réflexion sur la vie, sur les rapports familiaux, sur l’amour, sur la mort et sur l’imprévu. Comment l’imprévu fait-il irruption dans nos vies? Comment l’accueillons-nous? La réponse ne se fait pas attendre.
Et la mort est un imprévu de la vie. Une mort n’annonce pas son arrivée. Elle surgit de manière intempestive. Elle déstabilise le quotidien des personnes. Elle ne se pose pas la question de l’âge. Non. Toi, elle t’a prise à la fleur de l’âge. Au moment où chaque personne échafaude des projets pour elle et sa progéniture. Elle est dure, mais on finit par l’accepter, la tolérer.
Le silence du père.
À la mort de la mère, le père observe un silence, un silence gêné. Personne ne sait, à vrai dire, ce qui se passe dans son esprit. On a l’impression qu’il fuit quelque chose, le regard de sa fille peut-être. Malheureusement, ce silence ouvre la voie à toutes sortes d’interprétation de la part de sa fille :
À l’âge de dix ans, tante Clara avait enfin décidé de me dire avec des mots clairs que tu étais décédée. Peut-être que tous ces adultes avaient fini par se dire que j’avais moi aussi besoin de commémorer la date de ta mort? La vraie date, j’allais dire. Ma souffrance, c’est aussi que papa ne s’y était pas collé. Une autre personne avait joué son rôle. Que craignait-Il? Je n’ai jamais eu de réponse et ça me taraude. Ce qui m’a le plus fait mal, c’est cela. Cette réalité. Ce silence qu’on m’a imposé et à l’intérieur duquel je me suis plongée depuis lors. Le silence s’était incrusté dans nos quotidiens. Ce silence n’était ni quiétude ni sérénité, ni apaisement ni harmonie, parce qu’en fait pour moi l’harmonie doit toujours venir du cœur. De fait, l’harmonie visible n’est que la conséquence de ce qui se passe à l’intérieur de nous. À partir de ce moment-là, je me suis mise à pleurer chaque jour. J’avais l’impression que mon cœur avait perdu une clé et qu’il resterait à jamais fermé. Il m’arrivait parfois de rester assise, toute la journée dans un coin de la maison, seule, les yeux fermés. Tout devenait obscur autour de moi et j’expirais à fond.
La narratrice quémande le regard du père, son attention. Ce passage où la narratrice parle de son père est comme une déclaration d’amour à l’endroit de celui-ci. On a comme l’impression qu’elle veut lui dire : « regarde-moi, je suis là. Je veux que tu t’intéresses à moi ». Elle se dépouille, s’expose et veut que son père l’aide à puiser à l’origine de ce que la famille était avant le décès de la mère. Elle espère refaire avec lui le trajet pour mieux se préparer à l’avenir sans celle qui désormais faisait le lien. Mais elle observe son géniteur et réalise que le silence qu’il affiche est peut-être le fruit d’une douleur cachée, d’une douleur mal assumée ou d’une peur indicible. Elle a l’impression que le père, lui aussi, s’accroche au silence, à une virilité de façade pour supporter l’intolérable. Il pleure la nuit et le jour, il essuie ses larmes pour rester un homme, un père aux yeux de ses enfants.
Je ne peux m’empêcher de penser que lui aussi a certainement mal vécu ton départ. Et que sa manière à lui de faire son deuil, sans se rendre compte, c’était de s’éloigner de moi. Peut-être que c’est cela finalement. Mais je comprends, c’est un papa. Et les papas ont aussi leurs limites, leurs jardins secrets. Ce sont des humains comme tout le monde. C’est le paradoxe du sexe dit fort qui refuse parfois d’admettre sa fragilité alors qu’il est humain comme tout le monde. Le sexe dit fort a peur des émotions, il a peur de se montrer manquant, il veut à tout prix montrer qu’il est viril, il se croit omnipotent, il a peur de donner un peu de lui. Et finalement, il ne donne rien.
Cette relation entre père et fille installe une colère, une prise de conscience et même une résignation que seul le temps pourra guérir.
Paola Elenga-Onimba invite son lecteur à plonger dans la profondeur de la réalité humaine. La mort fait peur aux vivants depuis longtemps. Perdre une mère et continuer à la pleurer toute la vie, espérer son retour même à l’âge de 26 ans et finalement décider de lui parler pour qu’elle nous aide à entrer dans la vraie vie. C’est le souhait de Queenie, le souhait qu’elle vivra grâce à un frère qui lui rappelle sa mère, grâce à un père toujours présent à sa manière, grâce à des frères et sœurs attentionnés et grâce à des amis, cette volonté de se dire qu’il n’y a qu’une seule vie qui mérite d’être vécue, au-delà de tout, une vie unique pour chaque personne qui dans les temps de solitudes profondes prend toujours la mesure pour rebondir. Une vie qui appelle à l’humanité.
Dans le dernier chapitre du roman, l’auteure invite ses lecteurs à croire que l’amour dans tout ce qu’il a de positif est un socle important pour la renaissance. La narratrice raconte comment l’attention de certaines personnes et l’amour d’un homme lui constitueront des ingrédients importants pour combler certains manques et pour avancer.
Nous sommes tous issus d’une espérance, d’une volonté, d’une aspiration, parce qu’un enfant est d’abord le fruit d’un amour. L’amour d’un instant, l’amour de toujours. Peu importe. Il naît dans l’espoir, c’est pourquoi la désespérance ne devrait pas être son point de mire. C’est donc pour cela que vivre est plus qu’un défi, c’est un droit, un devoir, un fait, une réalité qu’il faut affronter au jour le jour, parce qu’il n’y a qu’une seule vie.
La pertinence de ce roman réside tant dans la qualité narrative du texte que dans le sujet exploré. Le style est personnel, émotif, nostalgique, d’une teneur essentielle pour une première œuvre, mais reste encore dans le registre des journaux intimes. L’auteur évoque, malgré la rudesse du sujet, une renaissance intérieure grâce à l’amour et à la fraternité.
Nathasha Pemba