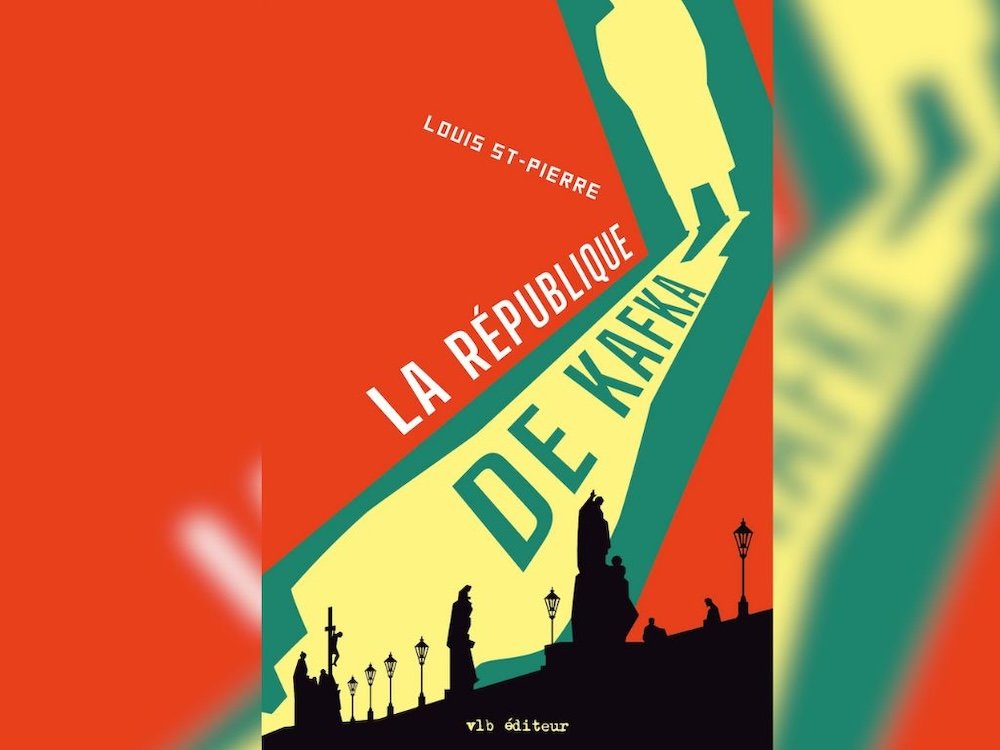Née en 1965, Adrienne Yabouza est originaire du groupe ethnique Yakoma, en République centrafricaine. Alors que sa communauté d’origine est victime de massacres en 2001, elle se réfugie avec ses enfants dans une forêt durant deux mois. Après l’accalmie, Adrienne Yabouza s’installe à Bangui, la capitale centrafricaine. Loin des grandes études, elle se forme plutôt à l’école de la vie. Devenue coiffeuse, Adrienne Yabouza fait de son lieu de travail une tribune d’expression libre où les femmes se confient au quotidien sur leurs problèmes de couple et autres frustrations sociales. Pendant ce temps, la République centrafricaine croupit sous le poids d’une précarité déconcertante et d’une instabilité politique qui perdure. Tout cela nourrit l’imagination de celle qui fait de la coiffure son gagne-pain et ne la laisse guère indifférente.
Le parcours littéraire d’Adrienne Yabouza n’est pas moins atypique. Il s’est tissé sur le fil résilient des vicissitudes qui ont marqué sa vie. Bien qu’elle porte un intérêt particulier à la lecture dès l’enfance, le déclic se fera en 2007, un peu par hasard, lorsqu’elle fera la rencontre de l’écrivain français Yves Pinguilly dans une rue de Bangui : « J’étais passé à la télé et le lendemain je suis passé à proximité du lieu de travail d’Adrienne. Et là, je croise Adrienne qui me reconnaît et me dit avoir acheté un livre de moi (Le cœur qui pique les yeux). C’était un vieux livre d’amour pour ses filles. J’ai dit, ce n’est pas possible que quelqu’un ait un livre de moi, ici à Bangui, où il n’y a même pas de vraie librairie », se souvient l’auteur français[1]. Cette rencontre sera déterminante aussi bien pour sa carrière littéraire que pour sa vie en général. Portée par l’élan d’être la voix des âmes meurtries qu’elle côtoie chaque jour et dont elle fait également partie, la coiffeuse commence à écrire à ses heures creuses. Et quelques mois après, elle co-écrit avec Yves Pinguilly, La défaite des mères, qui paraît en 2008. Ils publieront ensemble deux autres romans intitulés : Bangui Allowi (2009) et Le Bleu du ciel biani biani (2010).
Le premier de ces livres, La Défaite des mères, fait totalement basculer sa vie. Elle y critique le pouvoir politique, récuse la violence, les injustices et la corruption dont la flambée pousse la Centrafrique dans le gouffre d’une pauvreté extrême. Se sentant accusée, l’instance gouvernante de son pays décide de lui faire payer le prix de son audace. L’écrivaine est alors victime d’intimidation et de menaces de mort. Son livre est d’abord retiré du marché, des hommes armés pillent sa maison à plusieurs reprises et la menace de viol devant sa progéniture. La panique est à son comble et Adrienne Yabouza décide de s’enfuir avec ses enfants en 2013, au Congo-Brazzaville, où elle continue de recevoir des menaces de mort. Finalement, en 2014, avec l’aide de son ami Yves Pinguilly, elle parvient à se mettre à l’abri en France, où elle bénéficie d’un statut de réfugiée politique.
Le chapelet des douleurs féminines
Depuis 2008, Adrienne Yabouza a publié une dizaine de livres. Au-delà de ses trois premiers livres co-écrits avec Yves Pinguilly, elle a publié les romans Coup d’État (sous le pseudonyme d’Auguste Komelo Nikodro, 2010) ; La Maltraitance des veuves (2013) ; Co-épouse et co-veuves (2015) ; La patience du baobab (2018) ; La Pluie lave le ciel (2019). Elle est également auteure de plusieurs livres de jeunesse parmi lesquels : Comme les oiseaux (2015) ; L’histoire du chasseur (2017) ; Biaka sauvée (2018) et Un Amour de parapluie (2018) ; Une Poupée pour maman (2019).
En effet, les œuvres d’Adrienne Yabouza sont le reflet des souffrances qu’elle a personnellement endurées ou qu’elle a vues autour d’elle. Elles égrènent le chapelet des douleurs de la femme centrafricaine et abordent plus largement les difficultés d’être une femme dans un contexte africain qui brille par son phallocratisme. Veuve depuis longtemps, l’écrivaine centrafricaine expose le quotidien des femmes qui, après le décès de leurs maris, réussissent à élever seules leurs enfants, avec toutes les contraintes que cela implique. Elle dresse le tableau de la femme africaine, travailleuse, forte, résiliente et courageuse ; et explore les violences qu’elle subit en permanence. Un peu à son image, les héroïnes d’Adrienne Yabouza ont une grande force de caractère qui leur permet de se débarrasser peu à peu des entraves à leur liberté. Elles sont en quête d’une émancipation qui n’a pas de limites, en ce sens que leurs revendications, d’un intérêt général, reposent sur des problèmes liés à l’extrémisme religieux, la corruption, l’instabilité politique et le terrorisme entre autres.
J’ai longtemps été coiffeuse dans un petit salon. Je suis une veuve qui a un vécu douloureux, qui a élevé seule ses enfants, faisant le maximum pour qu’ils puissent manger et aller à l’école. Les femmes en Afrique comme ailleurs peuvent être des proies. Il leur faut beaucoup de courage pour garder leur dignité, pour continuer à vivre leur vie. Le courage, on ne naît pas avec, on l’acquiert dans l’adversité, comme mes héroïnes. Mes romans sont remplis de mille histoires que j’ai entendues dans le quartier, dans la famille et au salon de coiffure où les femmes, entre elles, se racontent, se confient et parfois disent le plus intime d’elle-même », renchérit-elle. (Amina, 2016)
L’écrivaine centrafricaine a opté pour une écriture authentique qui reflète les réalités sociales et culturelles de son pays, afin de mieux toucher ses lecteurs. C’est ainsi que sa langue d’écriture, le français, est marquée par l’influence des langues locales. Son écriture n’est qu’une transcription du langage de certaines rues africaines où naissent des sociolectes qui portent les marques des différentes identités des populations qui y vivent et sont parfois caractéristiques des difficultés qui marquent leur quotidien. Ce fait de style traduit la volonté de l’auteure d’être proche de son peuple dont elle est une porte-parole :
Moi qui ne suis pas une universitaire, moi qui ai si peu fréquenté l’école, j’ai tenté d’inventer une écriture qui ne soit pas l’écriture littéraire classique de quelques écrivains dont j’aime le talent comme Mariama Bâ, Ousmane Sembène… Si mon écriture imprègne les cinq sens du lecteur, c’est pour beaucoup parce qu’elle est marquée par les langages de la rue africaine, par les langues africaines que je parle (sari, lingala, yakoma). Si l’on oublie l’invention langagière de la rue, on risque de s’éloigner de ses personnages. Je ne veux pas “blanchir” mes héroïnes par une langue française qu’elles parleraient parfaitement ! (Amina, 2016)
De façon générale, il appert que la vie d’Adrienne Yabouza est aussi inspirante que son parcours littéraire. Elle est incontestablement ce que la littérature centrafricaine a de plus beau actuellement, non seulement en tant qu’une écrivaine qui revendique le respect de la liberté de la femme africaine, mais aussi grâce à la puissance de ses textes qui dénoncent la situation chaotique que traverse la Centrafricaine depuis des décennies. De coup d’État en coup d’État, ce pays d’Afrique centrale dont le sous-sol est pourtant très riche connait l’une des paupérisations les plus graves du continent. Et cela est par ailleurs dû à la mal-gouvernance, la corruption qui gangrène le pays, à l’expansion des sectes terroristes et aux ingérences étrangères pour le pillage du sous-sol. Adrienne Yabouza a donc eu le courage, dans cet environnement délétère, de critiquer ces incongruités, au péril de sa vie. Malgré les menaces de mort qui l’ont poussée à l’exil, elle continue d’écrire. Ce, pour le bien de la littérature centrafricaine, et avec le rêve qu’un jour elle rentrera dans son pays natal et le trouvera en pleine croissance sociale, économique et politique.
Boris Noah
[1] https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/yves-pinguilly-adrienne-yabouza-lafrique-livres-guingamp_21049662.html