Bonjour, Lise, comment allez-vous ?
Bonjour, Pénélope, c’est un plaisir de participer à votre magazine.
L’art et vous c’est incontestablement une histoire d’amour. Comment est-il venu vers vous ?
Je crois que j’ai toujours été très créative, alors, lorsqu’il a été le temps de choisir une orientation, j’ai décidé de m’inscrire aux Beaux-Arts de Montréal, au grand dam de mes parents. Puis l’École des Beaux-Arts est devenue Université du Québec à Montréal et j’ai continué cette fois en design d’environnement. C’était une époque de grand changement. Nous parlions beaucoup d’art intégré, d’art en continuité avec la nature, c’était très exaltant.
Vous évoquez dans votre livre l’expérience des femmes de Shefford. Qu’est-ce qui justifie ce choix ? À quel moment avez-vous cru nécessaire de mettre l’expérience de ces femmes en avant ?
L’appartenance à un territoire était importante pour moi, j’ai vécu presque toute ma vie dans les Hautes-Laurentides dans ma région natale. J’avais intégré la nature dans ma démarche artistique, la forêt boréale était devenue mon atelier et tout ce qui s’y trouvait était mes matériaux. Puis par un concours de circonstances, je quitte cette région et emménage en Estrie. Tout était différent pour moi, j’étais impatiente de découvrir un nouveau territoire. J’ai eu l’idée de reconstituer son histoire par le biais de vies de femmes qui l’avaient habité avant moi. Les livres d’histoire ne parlent pas des femmes. C’était un beau défi pour moi. J’ai fait beaucoup de recherches à la société d’histoire et aussi j’ai démarché dans divers organismes pour trouver des contemporaines.
Quelles ont été les réactions des femmes de Shefford à votre projet ?
Les femmes que j’ai rencontrées étaient très heureuses de collaborer. Pour certaines, elles parlaient de leur mère; d’autres de leur belle-mère. J’ai aussi rencontré un duo mère-fille, Noémie a été la plus jeune du groupe, une éducatrice spécialisée dans la vingtaine. Toutes étaient intéressées par le projet et curieuses de connaître le résultat de mes recherches.
En évoquant des « femmes arbres », à quoi faites-vous allusion ? Pouvez-vous nous faire part d’une anecdote liée à cette métaphore ?
Ma relation avec les arbres remonte aux années quatre-vingt-dix. À Rivière-Rouge, où j’ai vécu une grande partie de ma vie. Il y avait un vieux chemin abandonné, vestige d’une montée datant du temps de la colonisation du Nord que le curé Labelle appelait les Pays d’en-haut. Les arbres qui bordaient le sentier avaient plus de cent ans, je les imaginais regardant passer, les charrettes des colons, les Indiens allant sur leur territoire de chasse, puis les premières automobiles. Ils étaient toujours là, témoins muets, à la merci des intempéries, de la pollution toujours grandissante, incapables de s’échapper. J’ai vite fait un lien avec les femmes qui au cours des générations subissaient les dictats de la mode, les coutumes culturelles avilissantes et les lois religieuses. Les arbres sont devenus ces femmes. J’ai fabriqué des sculptures en papier, grandeur humaine avec la couleur et la texture du bois. Il y en avait 9. Elles portaient des noms signifiants : Massounga la féconde, la nina Lupita, Ange-Aimée la laide, Immaculée la mutilée… Ce fut le début de cette relation arbres-femmes. Plus près de nous en 2021 j’ai habillé 10 arbres à l’image de femmes artistes surréaliste dans la ville de Carleton dans la baie des Chaleurs et finalement ce dernier projet des Femmes de Shefford.
Quel message véhiculez-vous dans vos œuvres d’art ?
J’aime surprendre et faire sourire. Il y a une dizaine d’années, en collaboration avec une amie artiste, nous avons dressé une table de 24 couverts entièrement constitués de roches précambriennes : potages, boulettes, riz, fromages et desserts. A priori, les gens étaient mystifiés, puis ils rigolaient et nous racontaient leurs propres histoires de roches. Le fait d’utiliser des objets qui font partie du quotidien amène une lecture différente de l’œuvre d’art pour le spectateur. Il en est de même avec le textile. Dans le projet des femmes de Shefford, j’ai confectionné des gaines lacées à la manière d’un corset, pour chacun des arbres représentant une héroïne. J’ai cherché à raconter leur l’histoire en utilisant des tissus appropriés. Par exemple, pour Lucy Kilborn, une des femmes faisant partie de la cohorte des pionniers, qui était fille de colonel et marié à un capitaine, j’ai utilisé un lainage rouge rappelant les uniformes des loyalistes et réutilisé un vieux pantalon en laine grise du pays, le tout agrémenté de dentelle, de broderie et de boutons dorés. Pour Rebecca Amstrong fermière ayant vécu 50 ans plus tard c’était une cotonnade à carreaux et le rebord d’un vieux chapeau de paille. Les tissus nous parlent, ils sont chargés d’histoire et les gens s’y reconnaissent à cause de cela.
Pourquoi avez-vous choisi de créer des installations éphémères préservées par la photographie ?
En général, les gens s’arrêtent pour contempler un paysage, ou méditer dans l’intimité d’une forêt. Moi, j’aime investir un lieu, y laisser une petite trace de mon passage par une petite installation éphémère. Ce lieu reste à jamais gravé dans ma mémoire, il fait partie de moi, je peux même me rappeler les odeurs, le bruit de l’eau, le chant des oiseaux. La nature est bien souvent mon atelier, la photographie devient le seul témoin de l’œuvre qui s’effacera avec le temps.
Pensez-vous que même dans un monde pleinement « technologisé », la sensibilité de l’être humain peut encore se laisser émouvoir par l’art ?
J’arrive de visiter Plurial, cette grande fête de l’art contemporain et nous discutions justement au sujet de la matérialité dans les œuvres d’art. Il y a un retour en force d’œuvres utilisant la matière brute. La céramique, le tricot, l’utilisation des tissus sont des indices qui permettent de croire qu’il y a un retour vers la production des œuvres qui utilisent la matière.
Une dernière question Lise : L’art contribue-t-il au bonheur ?
J’ose espérer que l’art contribue au bonheur. Il peut nous apporter tant de choses. Nous aider à trouver des réponses, apporter de la beauté dans cette sombre époque truffée de guerres atroces. C’est un lien magique avec le passé, que dire de ce que nous pouvons ressentir devant un tableau de la Renaissance. L’artiste sera toujours à la recherche de la vérité, de sa place dans l’univers c’est ce qui rend l’art si unique. Comme l’a chanté Léonard Cohen : « Il y a une fissure, une fissure dans tout… C’est comme ça que la lumière entre. »
Merci !
Nathasha Pemba








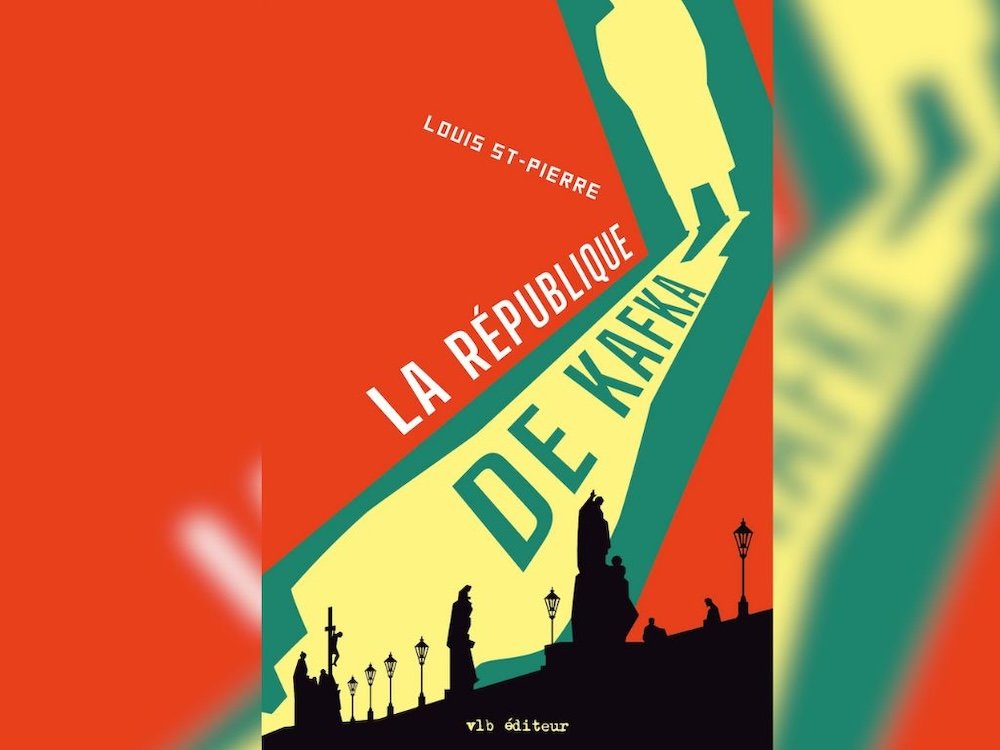

2 commentaires
Très inspirant
De son vivant, le curé Labelle n’a jamais employé le terme Pays d’en Haut pour parler du Nord. Ce terme est une invention de l’écrivain Claude-Henri Grignon pour sa série télévisée sur l’histoire de Séraphin Poudrier, un avare de Sainte-Adèle. Il avait nommé cette série «Les Belles Histoires des Pays d’en Haut» qui fut présentée à la télévision de Radio-Canada de 1956 à 1970. Dans les faits, le curé Labelle parlait de la vallée de l’Ottawa qui comprenait le territoire des Laurentides.