Bonjour, Xavière, comment allez-vous ?
Bonjour Nathasha, je vais bien, toujours très occupée par la vie familiale, l’écriture, et par la sortie de Follement écrivaines.
Votre prénom est peu courant et très beau. A-t-il un sens particulier pour vous, ou le considérez-vous comme un prénom comme un autre ?
Par le fait même des réactions qu’il suscite, je ne peux le considérer comme un prénom comme un autre. Des réactions positives, heureusement. L’anecdote la plus fréquente est que les gens s’attendent à parler à un homme et sont surpris lorsqu’ils me voient pour la première fois.
Selon vous, qu’est-ce qui fonde l’engagement féministe aujourd’hui ?
Cette question, posée juste après les résultats de l’élection américaine, m’amène à penser que le féminisme doit retrouver plus que jamais sa forme militante et soudée comme du temps des suffragettes. Oui, des avancées ont été faites depuis ce temps, mais des droits fondamentaux comme l’avortement sont aujourd’hui remis en question. Nous avions de grands espoirs avec le mouvement Me Too mais le ressac a été puissant et continu de l’être. L’égalité sur papier est atteinte dans les pays occidentaux, mais pas partout dans le monde et, dans les faits, je ne la vois pas tant cette fameuse égalité.
Considérez-vous l’écriture comme une forme d’engagement féministe ?
L’investissement d’un domaine encore dominé par les hommes est en soi un engagement féministe, conscient ou non. La littérature relève d’une chasse gardée masculine. Il n’y a qu’à voir les statistiques du prix littéraire le plus prestigieux en France, à savoir le prix Goncourt : depuis les 20 dernières années, seules 4 femmes l’ont obtenue, soit 20% des lauréats, c’est une non-parité flagrante.
Vous avez écrit l’essai Follement écrivaines. Est-ce une réflexion sur le droit ou la liberté fondamentale d’expression des femmes ?
Vous touchez à un point essentiel avec cette question, à savoir que même si les femmes obtiennent le droit et la liberté d’écrire (comme en occident par exemple), elles n’ont pas nécessairement les moyens physiques, psychologiques et matériels de mettre en œuvre cette écriture. J’analyse dans cet essai les freins, à mon sens, majeurs, à l’écriture des femmes.
Dans votre essai, vous dénoncez la «tendance à cristalliser les femmes écrivaines dans leurs derniers instants ». Cette remarque répond-elle simplement à une critique sociale, ou bien cela représente-t-il, selon vous, un élément important de l’histoire de la création féminine, où les femmes sont encore trop souvent « hystérisées » même après leur mort ?
Comme vous le soulignez, les femmes sont plus facilement cataloguées dans la case « folles », notamment les femmes qui osent s’exprimer, se mettre en colère, et écrire cette colère. Et une fois étiquetées, il est quasi impossible pour elles de se défaire de cette image, même dans la mort.
Pouvez-vous expliquer votre choix des auteures auxquelles vous avez consacré votre œuvre : Virginia Woolf, Sylvia Plath, et Marina Tsvetaïeva ?
C’est par la lecture de l’essai Le bal des absentes de Julie Boulanger et Amélie Paquet que j’en suis venue à m’intéresser à ces trois autrices. Pourquoi ces autrices-là plutôt que les autres présentées dans le livre ? C’est effectivement leur suicide qui m’a interpellée. Je voulais comprendre ce qui avait pu amener trois des plus brillantes écrivaines à commettre ce geste. Cette interrogation initiale s’est transformée en lecture d’une partie de leurs œuvres puis en écriture d’un essai à ce sujet.
Aux pages 20-21 de votre livre, vous évoquez votre propre expérience dans des environnements de travail difficiles, avec le télétravail, la réduction de votre mandat, etc. En tant que femme et écrivaine, vous identifiez-vous, d’une certaine façon, aux femmes que vous citez dans votre essai ?
J’ai été frappée de la similitude des difficultés éprouvées par ces écrivaines, alors qu’elles viennent de trois pays et deux générations différentes, mais surtout des similitudes avec ce que je peux moi-même vivre dans un contexte et une époque radicalement différents. Je suis allée chercher ce qui relève de l’universel dans leur parcours pour comprendre comment leurs vies nous rejoignent aujourd’hui.
Quelles stratégies adoptez-vous pour poursuivre votre écriture dans un contexte aussi contraignant ?
Ma stratégie d’écriture a été et est une stratégie de la survie. Je ne pouvais pas continuer à travailler, élever des enfants et écrire. Je devais laisser tomber un des trois aspects. Il était inconcevable pour moi de laisser mes enfants, et sans l’écriture, je ne trouvais pas de sens à ma place dans ce monde. J’ai donc quitté mon emploi pour me consacrer aux deux autres aspects.
Vous parlez dans votre essai de la nécessité d’« un espace à soi ». Pensez-vous que, bien que cet espace soit crucial, la sororité reste également essentielle pour les femmes dans le monde de la création ?
Plus que dans la création elle-même, la sororité dans l’accueil de l’acte de création des autres femmes par les femmes devient effectivement indispensable. Nous voyons de plus en plus d’initiatives dans ce sens, mais il y a encore un long chemin à faire dans la défense des œuvres des femmes par les femmes.
J’aimerais entendre votre point de vue personnel sur la nécessité d’écrire… Pour vous, Xavière Hardy, que représente cette nécessité ?
Comme mentionné plus haut, cette nécessité s’est imposée. Ce n’était pas un choix rationnel, plutôt un instinct de survie. Marina Tsvetaïeva a très bien traduit ce sentiment dans la phrase : « J’écris parce que je ne peux pas ne pas écrire ». L’écriture est devenue pour moi la seule façon évidente d’appréhender le monde.
Vous avez mentionné votre intérêt pour Nelly Arcan. En tant qu’autrice franco-canadienne, comment percevez-vous les visions féministes actuelles dans chacun de ces pays ?
La société québécoise offre actuellement de meilleures perspectives pour les femmes que la société française. On peut citer par exemple le RQAP dont les prestations sont plus longues lors de la naissance d’un enfant, pour les deux parents et pas seulement la mère. Ce sont des gestes concrets qui améliorent progressivement les conditions des femmes. Cela dit, nous n’avons pas encore atteint ici au Québec la fameuse triade égalité/parité/équité. Et il suffit du retour de politiques plus conservatrices pour voir ces avancées remises en question. Quant à la France, j’ai été profondément choquée de l’accueil fait par une partie des intellectuels français lors de la remise du prix Nobel de littérature à l’écrivaine Annie Ernaux. Au lieu de clamer leur fierté de voir une de leurs compatriotes récompensées, certains intellectuels ont vivement critiqué sa légitimité et son œuvre. C’est violent, mesquin et profondément misogyne. Cela en dit beaucoup sur l’état des choses en France.
À la page 52 de votre essai, vous parlez de vos propres attentes face à la vie. Vous écrivez : « J’ai cru que je ne laisserais pas les figures pourrir et éclater à mes pieds, que je pourrais tout avoir : carrière, enfants en santé, loisirs, vie de couple, et par-dessus tout, l’écriture comme passion. J’ai échoué. » Que représente pour vous cette affirmation ?
Le discours ambiant nous a vendu et nous vend encore la fameuse conciliation travail-famille, comme si celle-ci était réellement possible. Nous sommes littéralement ensevelis par les articles, les podcasts, les livres sur comment optimiser notre organisation personnelle afin de tout avoir en même temps. C’est impossible. C’est un mythe qui peut causer un profond sentiment d’inadéquation, surtout pour les femmes à qui la société demande encore la perfection, et avec le sourire s’il vous plaît, comme du temps de La femme mystifiée de Betty Friedan.
Peut-on dire que les écrivain·e·s, même ceux dits « à succès », vivent souvent avec l’idée d’une réalité idéalisée qui n’existe pas ?
La recréation par l’écriture d’une autre réalité, idéalisée ou non, permet de se réapproprier cette douleur entre le monde perçu et ce que l’on voudrait qu’il soit.

Chez les écrivaines que vous étudiez dans Follement écrivaines, leur rayonnement semble souvent posthume. Est-ce un fait inévitable, selon vous, que les femmes intellectuelles doivent disparaître pour briller pleinement ? Est-ce un sort dont elles n’échappent pas encore ?
Heureusement nous avons des exemples de femmes brillantes, je pense à Anne Hébert, à Annie Ernaux, femmes que je cite à certains moments du livre, qui ont été reconnues de leur vivant. Mais pour combien d’autres qui ont été occultées et ne seront redécouvertes que plus tard grâce à un travail acharné et minutieux, afin de leur rendre leur juste place dans l’histoire littéraire.
À travers votre essai, il semble que vous proposez une sorte de « sacralité désacralisée » de la femme dans toute sa complexité. Est-ce que cette interprétation vous semble juste ?
Si par sacralité désacralisée, vous entendez remettre la figure emblématique de l’écrivaine au cœur de la vraie vie, celle quotidienne, faite de lessives et de doutes sur ses propres capacités, alors oui, effectivement, on peut le percevoir comme un renversement de ce qui est généralement attendu. La focale est différente, mais elle se base sur leurs écrits et sur des détails souvent occultés, négligés, alors que pour elles, ils étaient plus essentiels qu’on ne le croit.
Comment interprétez-vous la célèbre phrase de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient », en lien avec les thèmes de votre essai ? Pensez-vous que le suicide ou l’effacement volontaire de certaines de ces écrivaines puisse s’inscrire dans ce processus de « devenir femme » ?
Simone de Beauvoir a démontré l’importance du processus de socialisation dans le « devenir femme ». La petite fille qui grandit a alors un choix à faire qui passe soit par le rejet total du rôle de la femme tel que défini par la société, soit par l’embrassement complet de ce rôle, ou encore par l’acceptation résignée. Dans mon essai, les écrivaines citées naviguent entre ces trois choix sans qu’aucun ne soit pleinement satisfaisant. Le suicide, et la dépression qui y mène indiquent une perte d’espoir et le seul moyen d’en sortir est l’effacement de soi.
Enfin, la montée du masculinisme prônant le retour au patriarcat vous inquiète-t-elle ? Comment le percevez-vous dans le contexte actuel de la lutte pour les droits des femmes ? Votre œuvre est-elle un cri de cœur ?
Je suis très inquiète de la montée en puissance d’un certain type de discours par des influenceurs qui se qualifient de « mâles alpha », entre autres choses. Le mouvement TradWife, qui prône lui aussi un retour au rôle traditionnel de la femme au foyer, mouvement porté par les femmes sur les réseaux sociaux, relève de la même rhétorique. L’élection américaine et son résultat nous démontrent qu’un homme vindicatif, menteur, condamné par la justice et ouvertement misogyne a plus de chances d’être élu président des États-Unis qu’une femme compétente. Par deux fois. Ce sont ici les signes évidents d’un retour du balancier et si nous n’y prenons garde, nous nous laisserons ébouillanter telle la grenouille dans la casserole.
Mon œuvre, hélas, n’a pas fini de crier. Elle ne fait que commencer.
Merci infiniment pour le temps que vous nous accordez et pour votre éclairage.
Merci beaucoup, Nathasha, pour vos brillantes et pertinentes questions.
Nathasha Pemba









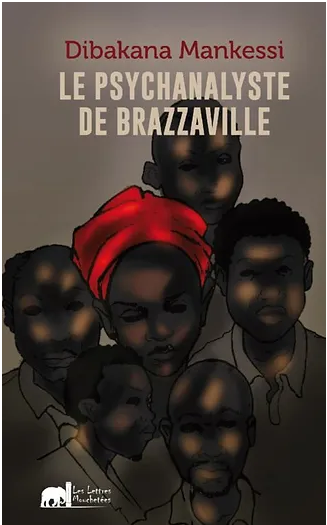

2 commentaires
entretien de haute tenue. Très intéressant.
Merci