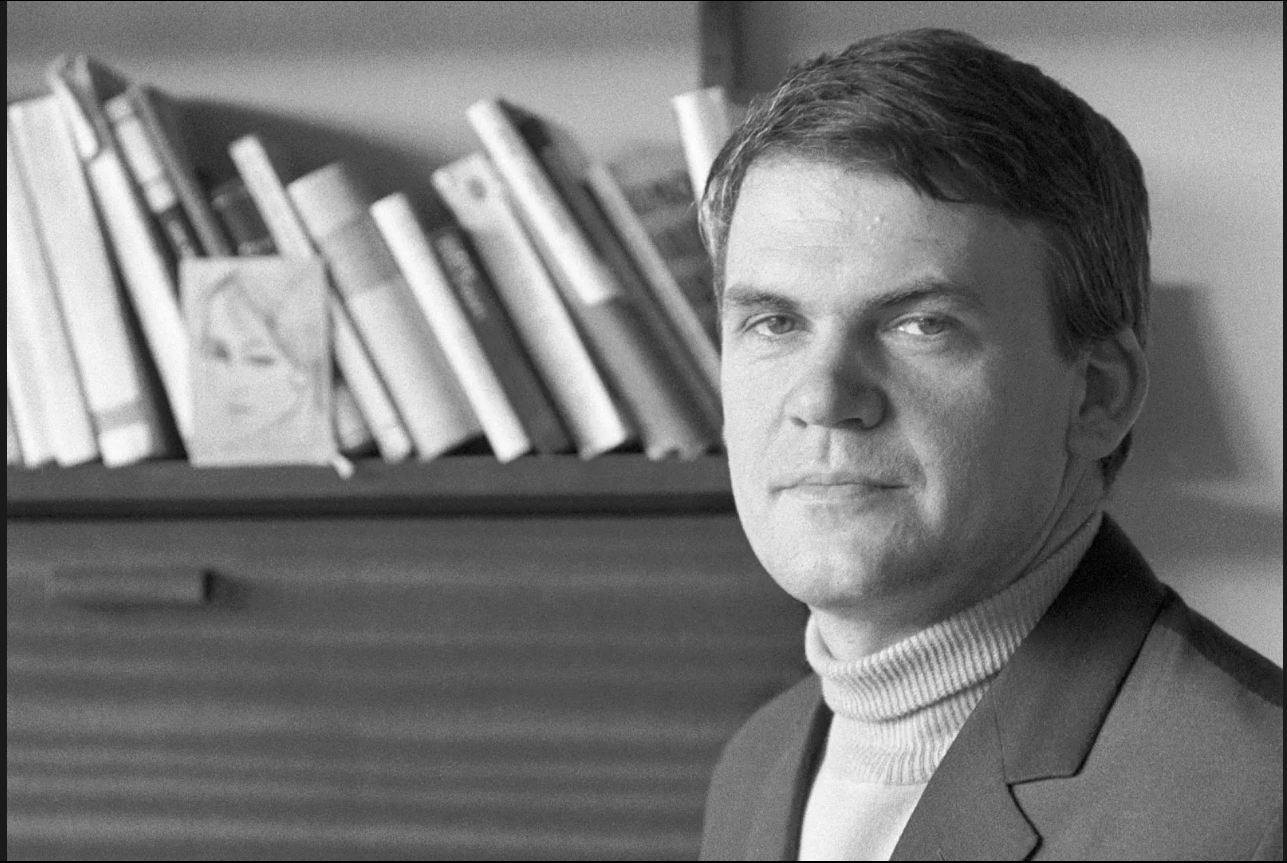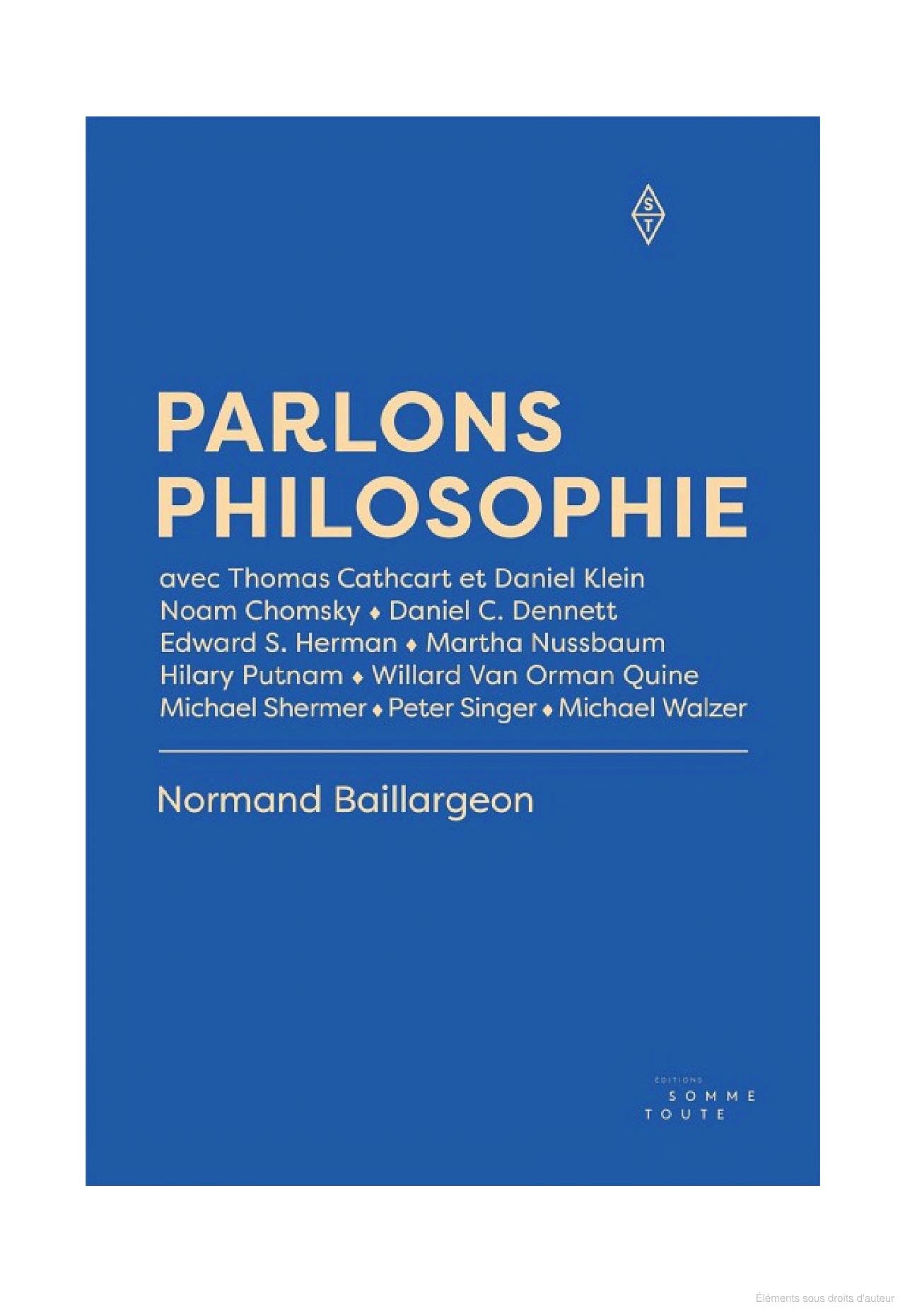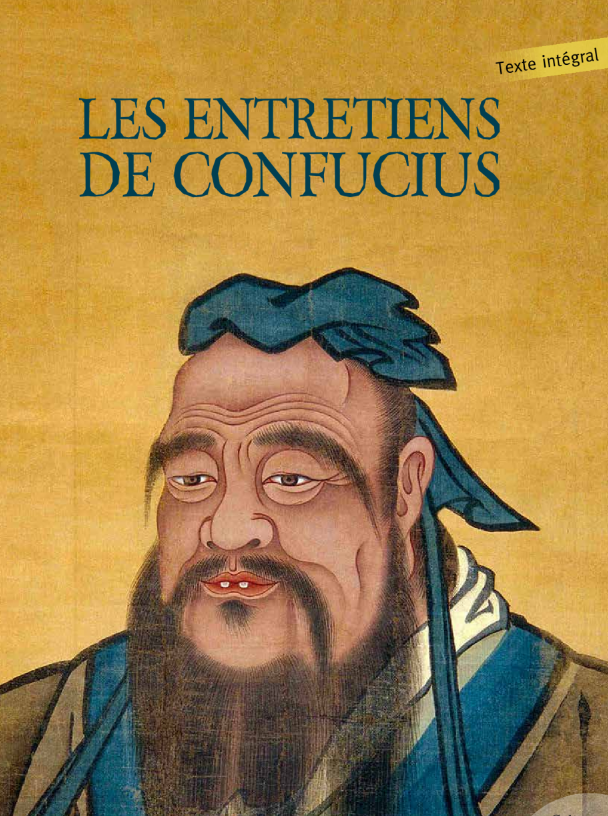Dr Jean-Marie Yombo, vous êtes spécialiste de Milan Kundera. Vous avez consacré plusieurs travaux scientifiques à son œuvre romanesque. Comment l’avez-vous « rencontré » ?
Je découvre Milan Kundera grâce au professeur Richard Laurent Omgba, mon directeur de thèse à qui je sais gré de m’avoir proposé d’étudier l’univers romanesque de cet écrivain majeur du monde contemporain. Je dois avouer qu’au premier abord, l’architecture complexe de cette œuvre romanesque, écrite sans artifice, m’a laissé penser que Kundera appartient à la catégorie des écrivains qui ont perdu la patience d’écrire pour ceux qui n’ont pas la patience de le lire. De même, perdu dans ce labyrinthe, sans fil d’Ariane, j’avais l’impression de faire face à un mur infranchissable, car il me paraissait impossible d’unifier ces récits fourmillant d’intrigues. Mais aussi paradoxale que cela puisse paraître, c’est cet obstacle qui a aiguillonné la volonté de lire patiemment Kundera et mon désir d’associer de la cohérence à la poétique de l’ordre négligé pratiquée par ce romancier. Pour tenter d’y arriver, j’ai non seulement lu et relu son œuvre colossale, ses critiques et les auteurs qui ont influencé Kundera. Et comme j’avais remarqué que par ses choix techniques, Kundera prend ses distances avec la révolution esthétique pratiquée par les romanciers de l’ère du soupçon, qu’il assimile au « modernisme titularisé », je me suis dit qu’il s’agit d’un roman après le nouveau roman et j’ai été piqué par l’envie de l’étudier pour mettre au clair ce qui fait la spécificité de sa poétique romanesque.
Dans quelle mesure peut-on dire que Milan Kundera a révolutionné le genre romanesque ? Qu’est-ce qui caractérise l’esthétique postmoderne que couvent ses romans ?

Pour répondre à cette question, il faudrait tout d’abord remarquer que Kundera arrive en France au tournant des années soixante-dix, une époque où le monde littéraire français est habité par ce qu’Antoine Compagnon nomme Le Démon de la théorie, pour désigner un climat général caractérisé par la floraison des théories sur le texte. Ce sont ces théories qui justifient les excès formalistes de l’avant-garde, laquelle conçoit l’art sous le prisme de l’expérimentation, valorise l’aventure de l’écriture au détriment de l’écriture de l’aventure et considère la modernité comme une rupture radicale avec le passé. Contrairement aux auteurs de cette période, Kundera ne pratique pas la table rase, mais revient aux catégories romanesques jugées suspectes sans pour autant renouer avec le code roman balzacien.
Cela revient à dire que pour Kundera, la modernité ne coïncide pas avec l’idée de rupture, mais correspond plutôt à une évolution qui intègre les acquis de la tradition. Voilà pourquoi il explore les possibilités ouvertes par les premiers romanciers européens et se réclame pour cette raison de « l’héritage décrié de Cervantès ». Dans cette perspective, son art romanesque prend ses distances avec le radicalisme d’avant-garde, pour proposer une pratique libérée du dogme de l’innovation sans pour autant succomber à la tentation du philistinisme qui fait florès durant cette période de décrispation esthétique où la littérature, inféodée au kitsch de l’ordre marchand, se définit par son indigence intellectuelle. C’est en raison de cela que je considère que son esthétique, caractérisée par la pratique de l’expérimentation non conditionnée et se défiant de l’autorité, relève du postmodernisme. Il s’agit d’un imaginaire engendré par l’essoufflement de l’avant-garde, lequel correspond sur le plan philosophique à ce que Jean François Lyotard nomme « le déclin des métarécits », c’est-à-dire des discours ayant la prétention de fournir une explication globale et un schéma de cohérent de l’histoire.
Ainsi, au lieu de la religion du progrès, le postmodernisme propose une lecture critique de la modernité dont les multiples dévoiements ont servi à révéler la collusion perverse des idées de progrès et catastrophe. Voilà pourquoi Kundera, dont l’œuvre n’énonce pas de certitudes sur le monde, mais explore plutôt l’existence pour en révéler les ambiguïtés, conçoit la période postmoderne comme celle des « paradoxes terminaux », dans la mesure où l’homme moderne qui croyait dominer la nature est désormais assiégé par ses propres productions. Son univers romanesque s’emploie à examiner lesdits paradoxes en mettant en scène des « individus problématiques » piégés par le langage, dévastés par la force brute de l’Histoire ou par le totalitarisme des médias qui, dans le monde né des luttes idéologiques, met tout à découvert et fait ainsi coïncider privé et public.
Comment le kitsch est-il pris à revers par Kundera ?
Je pense qu’il y a chez Kundera la volonté de démasquer les impostures, de questionner les idées reçues pour prendre à revers le kitsch dans toutes ses variantes. Mais que faut-il entendre par ce mot ? Sur la foi des recherches d’Abraham Moles, le mot vient de l’allemand kistschen qui signifie « bâcler et en particulier faire de nouveaux meubles avec des vieux ». Le verbe verkitschten qui en est dérivé signifie refiler en sous-main, vendre quelque chose à la place de ce qui avait été demandé. Ainsi, le kitsch est-il une catégorie associée à l’idée du faux : il correspond à la camelote, à la pacotille, à ce qui sert de substituts aux originaux. Dans le domaine artistique, il coïncide, selon Matéi Calinescu, avec la forme esthétique du mensonge. Historiquement, son essor est lié à celui du mouvement romantique dont la propension au lyrisme justifie son inadéquation avec le monde et son désir d’assouvir la nostalgie d’unité qui résonne au plus profond de l’être.

Sous la plume de Kundera, et notamment dans L’insoutenable légèreté de l’être, le kitsch est conçu comme une catégorie existentielle subsumant les rêves d’un monde débarrassé de toute contradiction et excluant toute attitude critique. Il promeut ainsi une image aseptisée du monde qui fait dire à Kundera que « le kitsch par essence, est la négation absolue de la merde au sens littéral comme au sens figuré ». Le kitsch est, suivant cette logique, une représentation enjolivée de la réalité nourrie aux sources de la religion judéo-chrétienne qui fait de l’homme l’image et la ressemblance de Dieu. L’homme kitsch est donc un homme qu’exaspère une demi-perfection, un homme qui, habité par la nostalgie du paradis perdu, s’identifie à une âme pure et perçoit le corps et notamment l’acte de déféquer comme des souillures. Pour cette raison, il constitue une invitation au voyage qui, en aiguillonnant notre faculté d’illusion, nous rend semblables à Emma Bovary dont la vie dans l’univers parallèle secrété par ses lectures révèle son inadéquation au monde.
Dans sa volonté de démasquer le kitsch dans toutes ses variantes, Milan Kundera montre que cette catégorie lyrique affecte tous les domaines de l’existence que son œuvre se donne comme mission d’explorer. En régime communiste, il correspond à la volonté de recréer le monde à travers l’image lénifiante d’une société où tous les individus fraternisent. Dans ses romans du cycle tchèque, cet argument spécieux de l’idylle pour tous justifie les tragédies orchestrées par la liaison dangereuse du communisme avec l’idée totalitaire d’un monde unifié. La doctrine artistique correspondant à ce kitsch du bloc de l’Est est le réalisme socialiste qui, assujetti aux dogmes du parti, promeut une conception instrumentale de l’art pouvant occasionner une révolution politique. En régime capitaliste, Kundera fait coïncider le kitsch avec « la société du spectacle », où le mythe de l’individu épanoui justifie le désir irrépressible d’exposer son image. Ce kitsch, que François Ricard assimile à l’idylle privée, est aussi totalitaire que le premier, dans la mesure où il ne tolère aucune attitude concurrentielle. La pratique littéraire qui en émane est la re-narrativisation de soi, laquelle donne lieu à ces écritures autoréflexives dont la circulation massive est due à l’effondrement des logiques communautaires et à l’émergence concomitante du réflexe hédoniste, de l’autogestion et de l’autoglorification. Dans son roman Le Livre du rire et de l’oubli, Kundera forge le concept de « graphomanie », pour rendre compte de cette manie d’écrire sur soi qui s’accompagne d’une indigence criarde au plan artistique.
Pour prendre à revers le kitsch et décaper le maquillage dont il revêt la réalité pour l’embellir, Milan utilise les moyens romanesques, et tout d’abord, l’ironie. Grâce à ce procédé, il fait entendre un rire dont le cynisme permet de montrer le ridicule des personnages-kitsch. C’est notamment le cas de Iakov, fils de Staline dont Kundera raconte dans L’insoutenable légèreté de l’être, qu’il s’est jeté sur les barbelés électriques parce qu’il s’est senti humilié par des co-détenus exigeant qu’il nettoie les latrines souillées par ses excréments. Le jugement que Kundera porte sur sa mort en la considérant comme « une mort métaphysique au milieu de l’universelle idiotie de la guerre », est teinté d’une ironie qui tend à tourner en dérision ce personnage qui, habité par le kitsch, se croyait au-dessus de la condition humaine. En plus de l’ironie romanesque, Kundera utilise l’art du contrepoint et des variations qui lui permettent, à partir du point de vue de plusieurs personnages, de développer des micro récits et de faire voler en éclats l’idée de vérité. Ainsi, loin d’articuler une thèse sur le monde, parce qu’il ne détient pas ce que Bakhtine nomme « l’excédent interprétatif essentiel », Kundera, par ses récits, ouvre une boîte de pandore qui prend le contre-pied du plan de référence unique promu par le kitsch. C’est pour cette raison que ce romancier est perçu par Eva Le Grand comme un joyeux mystificateur et comme un bon avocat du diable, dans la mesure où sa posture anticonformiste a pour but de renverser les idées reçues afin de sortir l’homme de l’illusion que « la vie est ailleurs ».
Le cinquième roman de Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être (Gallimard, 1984), est devenu un classique de la littérature. Qu’est ce qui, selon vous, rend ce roman aussi pertinent et adulé ?
Je crois tout d’abord que le titre de ce roman est aguicheur et incite le lecteur à vouloir découvrir son contenu et la manière dont il est pris en charge par le romancier de génie qui l’a conçu. C’est du moins le sentiment que j’ai eu en entendant ce titre pour la première fois. Voilà pourquoi une fois que j’ai eu le roman entre les mains, je me suis empressé de le lire. C’est un roman alternativement focalisé sur Tomas, Tereza, Sabina et Franz, protagonistes à travers lesquels Kundera explore les paradoxes de l’amour, puisque ses personnages sont écartelés entre l’image lyrique du couple fusionnel rappelant le modèle de Tristan et Yseult et l’attitude donjuanesque qui inscrit l’instabilité du désir dans la variation des partenaires. Le romancier y associe l’amour lyrique à la pesanteur qu’incarnent Tereza et Franz, tandis que la légèreté y a partie liée avec le caractère labile de Sabina et de Tomas avant son union avec Tereza. Ces deux thèmes irriguent le roman et permettent de réfléchir sur plusieurs autres problèmes de l’existence humaine et notamment sur le kitsch auquel Kundera consacre toute la sixième partie du roman et sur la grande marche de l’Histoire mondiale qui tire à sa fin et révèle en dernière instance son immaturité.
C’est un roman où on ne peut pas explorer une dynamique actionnelle téléologiquement orientée vers un dénouement, dans la mesure où le romancier s’emploie à rendre le récit chaotique. Mais il convient de remarquer que malgré cet apparent désordre, le récit est unifié par des correspondances télescopiques qui produisent des effets de symétrie entre des lignes d’intrigues apparemment autonomes. Ainsi, c’est le principe de la variation à partir d’un thème qui permet de penser que L’insoutenable légèreté de l’être est un désordre génial dont l’effet de produire, chez le lecteur en quête de cohérence, une jouissance esthétique offrant la possibilité de dépasser le malaise orchestré dans son esprit par la mise en intrigue du déferlement de la barbarie de l’Histoire sur le peuple tchèque. Le succès de ce grand roman est aussi lié au fait qu’en représentant les ambiguïtés de l’amour à l’ère des « paradoxes terminaux », Kundera utilise ce poncif des études littéraires comme un principe herméneutique pour interpréter le parcours du roman et incidemment celui du monde européen en proie à une sexualité désertée par la mémoire du désir et subordonnée à l’impératif de la performance laquelle, en dévitalisant le sujet, indique l’avènement d’un monde périlleux, où la légèreté insoutenable du souci de soi se substitue à l’éthique du devoir.
Vous avez écrit un article intitulé : « Roman cinématographique et effet de vie chez Milan Kundera ». Quel rapport établissez-vous entre l’œuvre romanesque de Milan Kundera et le cinéma ?
Milan Kundera s’est intéressé très jeune à l’art cinématographique ; il l’a enseigné plus tard à Prague et à Paris et a permis, en tant que coscénariste, l’adaptation de La Plaisanterie et de L’insoutenable légèreté de l’être. Par ailleurs, il s’est lié d’amitié avec Hynek Bôcan, à qui il a autorisé l’adaptation filmique de sa nouvelle intitulée « Personne ne va rire », extraite de Risibles amours. En dépit de ces noces scénaristiques de son roman avec le septième art, Milan Kundera a souvent pris position contre les adaptations cinématographiques et contre la pratique du rewriting qui ont pour effet de déformer le roman par la fabrique des scripts qui lui enlevant son caractère inénarrable. C’est pourquoi dans L’Immortalité, lorsqu’il discute avec son ami, le professeur Avenarius, au sujet du roman qu’il est en train d’écrire, il lui déclare : « Quiconque est assez fou pour écrire encore des romans aujourd’hui doit, s’il veut assurer leur protection, les écrire de telle manière qu’on ne puisse pas les adapter, autrement dit qu’on ne puisse pas les raconter ».Ces propos signent le divorce du roman avec le septième art en montrant que le roman ne peut subir le processus de la transcription filmique sans que sa morale, qui consiste à explorer l’existence à partir du point de vue de plusieurs personnages ne soit violée.
Dans Les Testaments trahis, Kundera reproche à Orson Welles d’avoir, dans son adaptation filmique du Procès de Kafka, fait de Kafka « un homme-qui-se-révolte-contre-la violence » et d’avoir ainsi dénaturé ce personnage qui, si on lit le texte, obéit aux intrus qui sont dans sa chambre au lieu de se révolter contre la violence. De même, dans son Introduction à une variation de Jacques et son maître, on peut lire : « Que périssent tous ceux qui permettent de réécrire ce qui a été écrit ! Qu’ils soient châtiés et qu’on leur coupe les oreilles ». Par cette déclaration que Boyer-Weinmann juge digne du tribunal islamique, Kundera montre le lien du cinéma avec la forme romanesque qui débouche sur une mésalliance. Cependant, il faut relever qu’en dépit de son opposition aux adaptations cinématographiques, l’imaginaire de l’auteur, enseignant du septième art et fortement imprégné de ses techniques compositionnelles, a influencé la structuration de ses romans, surtout depuis L’Immortalité où il fulmine pourtant contre l’adaptation filmique. Ainsi, le cinéma se présente-t-il comme paradigme de la création littéraire au même titre que la musique dont il a toujours affirmé la parenté structurelle avec ses œuvres.
En effet, la composition du récit chez Kundera et notamment dans son premier roman correspond à la segmentation séquentielle qui, dans le métalangage du septième art, prend le nom de « syntagme cinématographique ». Il s’agit d’une série de plans discontinus épousant le mode de l’ellipse par lequel la narration produit des effets de hiatus cinématographiques en truffant le récit de chaque personnage de lacunes provisoires dont le comblement ultérieur sera assuré par une autre voix narrative. Il en résulte une construction aspirant à la forme filmique, puisque les diverses lignes d’intrigues s’apparentent à des quasi-scénarii que le lecteur-spectateur doit réorganiser en recollant les morceaux dispersés dans le texte pour en faire un tout cohérent.
La vie, la pensée et l’écriture de Kundera sont donc, essentiellement, un élan de dissidence et de subversion, et une célébration de la « déconstruction ». Y a-t-il un lien à établir entre Jacques Derrida et Milan Kundera ?

Kundera ne s’est jamais défini comme un dissident politique. Cette étiquette dont il est affublé par certains critiques issus du « centre », participe de la manie qu’ont ces derniers de considérer les écrivains venus des petites nations comme des auteurs inaptes à aborder des questions autres que celles relevant de la politique ou de la volonté de défendre des valeurs communautaires. Opposé à cette image réductrice, Kundera, qui possède le génie de faire des variations sur un thème, ne défend pas dans son œuvre un point de vue politique ou une vérité, mais explore plutôt l’existence pour ébranler les certitudes et pour mettre découvert les indécidabilités qui montrent comme chez Derrida, que l’écriture est un pharmakon, c’est-à-dire un poison dont la vertu est de contaminer le logos pour émietter l’idée de vérité. Cela revient à dire que Kundera, comme Derrida, s’attaque à l’édifice de la métaphysique occidentale concevant le signe linguistique comme binaire et oublieux de son caractère différentiel qui le dispose à toujours renvoyer à quelque chose d’autre que le déconstructiviste français nomme la « supplémentarité ». Ainsi, la supplémentarité qui est au fondement de la philosophie derridienne est aussi à l’œuvre dans la pratique de Kundera qui construit le récit en superposant les voix et parfois, comme c’est le cas dans la sixième partie de L’insoutenable légèreté de l’être, en partant d’une digression qui peut devenir le centre insoupçonné d’un récit qui lui-même sera la matrice d’une réflexion élargie montrant l’inachèvement sémantique des mots, des situations, des êtres et des objets dans l’univers relatif du roman.
Quel est l’héritage de Milan Kundera à cette ère du « Brutalisme » qui est marquée par la banalisation de l’humain, la course effrénée vers l’avoir-matériel et des guerres aux intérêts égoïstes notamment ?
L’ère du « brutalisme », caractérisée par les aberrations cumulées du projet émancipateur des Lumières, signe le divorce de l’homme avec ses propres créations qui se retournent contre lui pour le dévaster. Révélatrice de ce que « la technique est devenue l’être de notre temps » comme le pense Hiedegger, cette période que Kundera considère comme celle des « paradoxes terminaux » met en scène un individu problématique, aiguillonné par la quête personnelle de la joie animale de la présence au monde, sacrifié aux discours messianiques, déterminé selon Foucault par l’économie, le travail et le langage, réduit à un numéro matricule par l’effet de la rationalité computationnelle, dépendant des nanotechnologies au motif de son augmentation et désormais asservi la logique marchande et au bavardage médiatique qui met à découvert son intimité. L’ère du « brutalisme » est donc faite de ces aberrations que Kundera analyse avec les moyens du roman.
Pour Kundera, la forme romanesque dans la période dite des « paradoxes terminaux » ne peut que prolonger la vision kafkaïenne l’homme, réduit à occuper un simple poste d’arpenteur, alors que naguère il avait été érigé par Descartes comme le maitre et le possesseur de la nature. Dans la même veine, il montre que le moi, dans cette période de la modernité tardive, est confronté à la problématique de ce que Houellebecq appelle « l’extension du domaine de la lutte », puisque, en plus d’être en proie aux états morbides de la conscience que décrit le roman psychologique, le moi est désormais appelé à faire face aux déterminismes extérieurs comme Monsieur K. assiégé un matin par des inconnus. Ces derniers incarnent entre autres les forces hostiles de l’Histoire (dont le retournement catastrophique a désarçonné Ludvik dans La Plaisanterie ou Mirek dans Le Livre du rire et de l’oubli), des caméras dont Agnès, dans L’Immortalité constate qu’ils filment les gens à leur insu et leur fait perdre leur individualité, de la performance sexuelle qui dénature l’attitude originelle de Don Juan, du kitsch qui le soumet à la fausse culture lénifiante diffusée par les médias.
Comme on peut donc l’observer, Kundera peint la situation spirituelle décadente du monde contemporain où la floraison des discours de la fin induit un changement de paradigme qui explique pourquoi le roman de l’ère du « brutalisme » ne peut qu’être celui de l’homme excédé dans un univers sans Dieu. C’est aussi un roman qui revient aux possibilités explorées par les premiers romanciers européens et dont l’inscription notoire dans le concret de la vie participe d’un besoin de réinvention de soi à partir d’une écriture qui explore les réalités inédites de la vie et assure de cette façon l’émerveillement de l’homme devant le mystère ininterrompu de l’être oublié par la tradition humaniste dont la parenthèse se referme avec l’image d’un monde qui s’effondre. Dans cette perspective, Kundera lègue à la postérité les moyens romanesques de son ré-enchantement dans un monde détruit par la technique.
Un événement en perspective après ce décès de l’écrivain franco-tchèque ?
Je compte organiser une journée d’étude sur cet écrivain majeur du monde contemporain ; un tel événement nous donnera l’occasion de nourrir des réflexions enrichissantes sur l’œuvre de ce « monstre sacré de la littérature ».
Merci, Dr Yombo !
Par Boris Noah