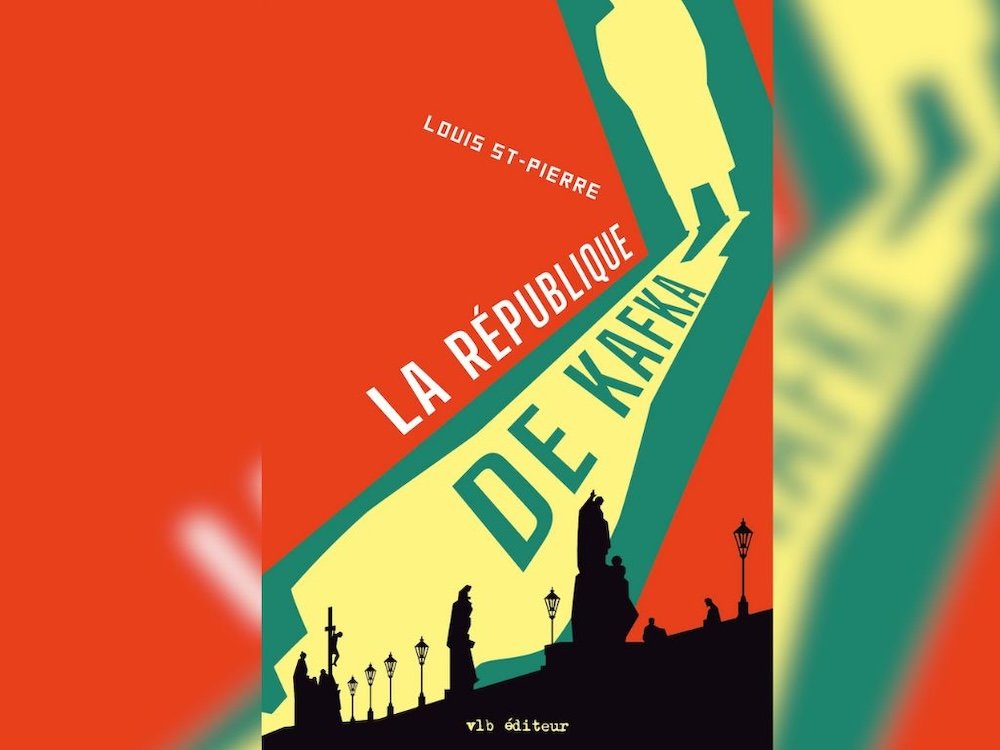Analyse littéraire
Nos rédacteurs chevronnés décortiquent, décomposent, passent les ouvrages littéraires francophones au peigne fin pour observer le sens, la structure et la portée d’une parution récente ou vous font redécouvrir un grand classique.
Honneur à Louis-Philippe Hébert, Essais cliniques aux laboratoires Donadieu, Montréal, Lévesque Éditeur, 2020.
P
ourquoi faut-il lire le dernier Louis-Philippe Hébert?
Le virus de la fatigue est une nouvelle tirée du recueil Essais cliniques aux Laboratoires Donadieu de l’écrivain québécois Louis-Philippe Hébert. Le recueil a été publié en février 2020.
Le virus de la fatigue est une sorte de journal quotidien relatant régulièrement l’avancée de la maladie.
Tout commence par une grosse fatigue qui s’empare de tout le monde. Au début, les gens semblent ne pas y prêter attention. Pour eux, ce n’est peut-être qu’un effet de la paresse. L’auteur parle d’ailleurs de paresse excessive. Et, comme souvent, dans ce genre de situations, il y a toujours des gens qui paient les pots cassés. Pourtant, les sermonneurs finissent vite par se résigner parce qu’eux-mêmes sont contaminés. Tout le monde est fatigué au point où même manger devient un calvaire. Les animaux, eux aussi, n’en peuvent plus. Certains traînent plus que d’autres parce que tous ne sont pas infectés de la même manière. Cependant, de manière globale, tout ralentit, que ce soient les entreprises ou les appareils de communication, les chauffeurs d’autobus ou les camionneurs. Des accidents de toutes sortes se produisent.
Je tiens à souligner que cette nouvelle est très riche non seulement du point de vue littéraire, mais aussi du point de vue thématique.
Ce qui frappe dès les premières lignes de la nouvelle, c’est que quelque chose de terrible est en train de prendre possession de l’univers. comme une odeur de fin des temps, car, en fait, personne ne sait comment ça se passe. C’est comme si d’un coup le monde s’arrête de tourner parce que tout le monde est fatigué et cette fois, ce n’est à personne de décider de l’arrêt du travail ou du départ en vacances. C’est le corps et l’esprit qui lâchent, ne laissant à l’être humain que l’âme et le souffle.
Le virus de la fatigue s’était emparé de nous. Un grand nombre semblait être affecté. Les gens s’endormaient au volant ; tombaient en plein milieu des escaliers, surtout de ces escaliers qui montent tout seuls et qu’on appelle des escaliers roulants ; dans les piscines publiques, des nageurs aspiraient de l’eau à grands ronflements après quelques brasses à peine ; des piétons se couchaient par terre en traversant les rues devant des automobilistes qui fonçaient dans les vitrines des voies commerciales parce qu’ils n’en pouvaient plus
La date du déroulement de cette pandémie n’est pas mentionnée, encore moins le lieu où il se produit. L’histoire pourrait donc se dérouler dans n’importe quel coin du monde.
Le suspense du récit est construit pas à pas. Le début de la nouvelle met le lecteur dans une situation d’attente. Il s’attend à une rupture qui n’arrive pas. Étrangement, plus on s’introduit dans la lecture, dans la torpeur décrite, plus on attend ce qui va arriver. On se demande : quand prendra fin l’épidémie? Les gens vont-ils s’en sortir ou bien tout le monde sera décimé?
Louis-Philippe Hébert ne plante pas seulement le décor. À partir d’une description minutieuse de l’état du Lieu et de la manifestation du virus, il construit dans l’esprit de son lecteur, un lieu habité par l’engourdissement suscité par l’épidémie de la fatigue. Il utilise une voix narrative surprenante qui nous fait poser la question suivante : est-ce une fiction ou une histoire réelle?
Le narrateur, à la fois spectateur et acteur, est fatigué, lui aussi. Néanmoins, il a le temps d’observer et de réfléchir, de raisonner au fond de lui. Fervent admirateur de sa femme, il cogite sur l’état actuel de cette dernière. Dans cette tragédie, il y a aussi le souvenir du temps où le virus n’était pas encore présent. Le passé refait surface.
Le narrateur semble être épargné, mais il n’en est pas trop sûr. Le deuxième jour par exemple, même le réveil est fatigué parce qu’il sonne avec beaucoup plus de retard que d’habitude. Le narrateur est donc témoin de la chute progressive de son épouse qui passe un temps fou pour se rendre aux toilettes, pour sortir de son lit. Elle a certainement contacté le virus. Ce qui est encore plus alarmant c’est qu’il ne peut lui venir en aide.
On finit par se demander si le narrateur est écrivain ou s’il réfléchit dans sa tête. Sur certaines lignes, le narrateur sort de sa subjectivité pour adopter un ton neutre, plus objectif qui fait croire que dans ce qu’il écrit, il y a un questionnement implicite lié à l’actualité :
Nous étions quelques-uns à être épargnés, mais l’étions-nous vraiment? Je crois que c’est notre constitution différente de celle de nos voisins qui nous permettait de mieux lutter contre le virus. Ou cette attitude que nous partagions de ne pas fréquenter des endroits où il y avait trop de monde collé les uns sur les autres. Des endroits où nous mangions dans la même vaisselle, buvions dans les mêmes tasses, manipulions à l’infini des sachets de sucre ou de sel et de Ketchup. Depuis quelques années déjà, on encourageait les clients à apporter leurs propres contenants.
Il y a une réalité essentielle que j’ai pu noter : le narrateur n’est pas extérieur au récit, car il utilise le pronom personnel « je » pour parler et, le pronom démonstratif : « ma » pour parler de sa conjointe. Il a une manière de décrire l’existence du moment qui fait penser que pour lui, il y a bien de choses qui sont étonnantes :
Je mets encore plus de temps à me rappeler où sont les tasses, et tout le café aura amplement le temps de remplir la cafetière d’ici à ce que je les aie dénichées.
Il y a une réalité essentielle que j’ai pu noter : le narrateur n’est pas extérieur au récit, car il utilise le pronom personnel « je » pour parler et, le pronom démonstratif : « ma » pour parler de sa conjointe. Il a Avec l’épidémie du virus de la fatigue, le confinement s’impose. La solitude s’installe :
Je me sens de plus en plus seul. Même les animaux nous abandonnent. Nous n’étions maintenant que trois, et les jeux de cartes avaient cette fâcheuse caractéristique de souvent exiger quatre joueurs.
Le temps existe autrement…
Impossible de tenir le temps! Ceci n’est pas un agenda. Trois semaines font six mois. Les jours se suivent sans se démarquer. Le calme s’est répandu comme l’eau d’une inondation qui se glisse dans le moindre espace, qui envahit tout, qui disparaît de là et réapparaît par ici. Le temps s’est aussi dilué.
Au fil de la lecture, on retrouve dans la nouvelle des mots forts comme « Guerre », qui rappelle le discours du président français Emmanuel Macron annonçant l’état d’urgence sur la pandémie Covid-19 : nous sommes en guerre! Cela souligne l’actualité de cette nouvelle qui sonne comme une prémonition. Effectivement, si la pandémie est une forme de guerre, le confinement (l’isolement) comme conditionnement est le moyen de préservation de la santé :
Je ne sais pas quand nous pleurerons nos morts, ou même si nous allons les pleurer. Peut-être éprouverons-nous une sorte de soulagement? Comme à la fin de chaque grande guerre. Comme après les catastrophes les plus dévastatrices. Volcans, tsunamis, tremblements de terre, glissements de terrain. Ouf, ça fait du bien!
Dans cette nouvelle de Louis-Philippe Hébert, c’est la question de la condition humaine qui est scrutée, comme chez Camus (La peste), chez Malraux (La condition humaine). Il ne faut jamais oublier que le virus concerne toujours la personne humaine, le cas aujourd’hui pour le Covid-19. Parfois, on a l’impression que l’homme est devenu le pire ennemi de l’homme, notamment quand il ne tient compte d’aucune règle pourtant établie pour son bien-être.
Nous vivons à nouveau une épuration. Trop de rats. Trop de fourmis. Il faut réduire la population de chenilles : l’arbre n’aura bientôt plus de feuilles à offrir. Ce que l’humanité néglige de faire, la nature s’en charge. Là-dessus, les philosophes de droite et de gauche sont bien d’accord. Ce qu’on ne sait pas, c’est si l’homme n’a pas un peu trop forcé la main de la nature. En fait, tout le monde le sait.
Cette nouvelle apparaît, à quelques endroits comme une invitation au repos certes, mais elle est aussi une invitation à prendre soin de soi et à jouir de la présence d’autrui. Il y est, à mon sens, question d’une espérance susceptible de nous permettre de vivre positivement ce temps de confinement.
Moi, je soupçonnais que l’apparition de la maladie avait donné à tous ceux que le travail avait absorbés, comme les ouvriers dans les usines, les excavateurs de rue, le personnel de chantier et les médecins, dont la tâche ne cessait d’augmenter au fur et à mesure que progressait l’affliction, l’occasion rêvée (pardon!) de freiner leurs activités, d’accéder à un repos dont ils entretenaient les médias depuis des années
On trouve donc, dans ce texte, l’une des idées fondamentales que l’on retrouve dans les publications de Louis-Philippe Hébert ainsi que sa vision de la condition humaine : le respect de l’autre.
Le narrateur ici incarne l’homme soucieux de la destinée humaine.
Ce que nous rappelle finalement Louis-Philippe Hébert c’est que, l’humanité et l’environnement sont toujours menacés, par le trop plein de travail ou par la fatigue. En cela il fait écho à l’impératif catégorique du philosophe Hans Jonas sur le Principe responsabilité : « Agis de telle sorte que tes actions soient compatibles avec la permanence d’une vie humaine authentique sur la terre ». La responsabilité envers l’humanité présente et future est un principe parce que c’est sur elle que se fonde l’éthique, toute éthique. Et les questions implicites que je retiens de la lecture de cette nouvelle : quelle humanité, quel environnement léguerons-nous à notre progéniture? Le virus de la fatigue est-il une métaphore qui vient pour nous rappeler quelque chose?