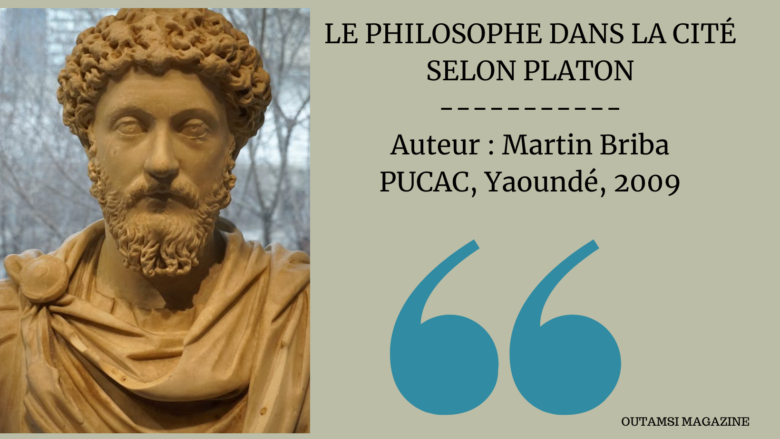Ne soyez ni fier, ni spirituel ni même à l’aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. (…), il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de chose : on doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé. (…) l’assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès : les médiocres ont pris le pouvoir »
Voici autant de questions auxquelles l’auteur tente de répondre sans langue de bois ni concessions. Philosophe et universitaire canadien, Alain Deneault est aussi chercheur au Réseau pour la justice fiscale. Il enseigne la théorie critique à l’Université de Montréal et tient une chronique dans la revue Liberté. Il s’intéresse beaucoup aux bouleversements que connaissent nos sociétés sous le vent du « capitalisme ultramoderne ».
Dans cet ouvrage l’auteur tente de comprendre la tendance et la dynamique sociale qui enjoignent à une production moyenne.
Pour Alain Deneault, « la médiocrité désigne le stade moyen en acte plus que la moyenne. Et la médiocratie est conséquemment ce stade moyen hissé au rang d’autorité ». C’est donc un système qui encourage « l’ascension aux postes de pouvoir des acteurs moyennement compétents au détriment des super compétents ou des parfaits incompétents ». Ces derniers parce qu’ils ne font pas l’affaire et les premiers parce qu’ils risquent de remettre en cause le système et ses conventions. Il explique l’avènement du pouvoir médiocre, entre autres, par « la division et l’industrialisation du travail (manuel comme intellectuel) ». La médiocratie nous incite de toute part à sommeiller dans la pensée. Il s’agit donc d’un système qui nous plonge dans une léthargie intellectuelle. Il nous « idiotifie ». C’est un système qui a horreur des notions comme « l’innovation », « la participation », « le mérite et l’engagement » qui sont pourtant, des expressions de la volonté individuelle dénuée de tout conformisme. L’auteur analyse la prise de pouvoir par les médiocres en quatre (4) chapitres. Le premier chapitre porte sur Le « Savoir » et l’Expertise. Le deuxième sur Le Commerce et la Finance. Le troisième est intitulé Culture et Civilisation. Le dernier chapitre quant à lui porte sur La Révolution : rendre révolu ce qui nuit à la chose commune. Cet ouvrage est un véritable cocktail savoureux qui taraudera, sans nul doute, les esprits les plus avertis.
LE « SAVOIR » ET L’EXPERTISE
Dans ce premier chapitre, Alain Deneault s’attaque au « dark side » du monde universitaire. D’abord, il considère que le monde de la recherche ainsi que les formations développées par les institutions universitaires sont à l’origine de multiples problèmes que connaît notre société (crise écologique, les inégalités, la surconsommation, le renversement de la culture en une industrie du divertissement, la colonisation de l’esprit par la publicité…). Ensuite, il constate avec amertume que les universitaires ont abandonné l’esprit critique. L’université a créé des cases et des moules dans lesquelles il faut à tout prix se loger au risque d’être banni du milieu. En outre, l’université est devenue « une composante du dispositif industriel, financier et idéologique contemporain » (p. 20). On voit se développer une forme de marchandisation des Universitaires. Ces derniers sont à la solde des grandes entreprises qui financent leurs recherches. Alain Deneault souligne qu’« en s’arrimant sans réserve aux grandes entreprises ainsi qu’aux institutions du pouvoir, les institutions de recherche ne se sont pas contentées de vendre du savoir à leurs clientes. Elles se sont aussi faites partenaires d’entreprises de manipulation » (p. 26-27). L’auteur pointe ici du doigt le malheur de l’université qui a accepté de courber l’échine pour obtenir des subventions pour la recherche. Les universitaires sont désormais plus tournés vers « l’avoir » que « l’être ». Cette course effroyable du matériel rend le chercheur médiocre. Dorénavant, l’université ne forme des hommes qu’en fonction des besoins du marché. Il y a une sorte de « robotisation » des étudiants, car les étudiants qui sortent de l’université sont des produits qui sont vendus aux entreprises privées et institutions qui financent cette dernière.
On constate, en outre, que dans le milieu universitaire une multiplication des références, une production massive, mais sans perspective globale. En étant aux services des entreprises, l’université sert de caution à ces dernières. En effet, les entreprises font recours de manière systématique aux « experts et universitaires » pour donner une image salutaire à un projet. Une entreprise, consciente que son projet est susceptible d’avoir un impact négatif sur l’environnement, va financer une université afin que ses chercheurs qualifient le projet d’inoffensif d’un point de vue écologique. L’expertise consiste de plus en plus souvent à vendre son cerveau à des acteurs qui en tirent profit. L’auteur, en citant Éric Eugène, considère que « l’expert n’est pas indépendant et que ses travaux sont forcément orientés par les modes de financement » (p.27). La figure de l’expert est au cœur du pouvoir « médiocratique ». Il n’est pas incompétent, mais il formate sa pensée en fonction des intérêts de ceux qui l’emploient. Il fournit les données pratiques ou théoriques dont ont besoin ceux qui le rétribuent pour se légitimer.
Le monde universitaire a perdu pied dans cet océan immense qu’est la médiocratie. Les universitaires sont devenus des « mercenaires du verbe ». Ils ont capitulé face à la toute-puissance du monde industriel et financier. Ils sont devenus des amoureux du politiquement correct dans le choix des mots. On préfère, par exemple, utiliser les notions « actes douteux », ou « mal gouvernance » plutôt que « crimes » ou « actes de pillages ». Les universitaires deviennent donc des experts dans l’enjolivement des mots et même des maux. On demande donc à l’universitaire, en référence à un code de la bienfaisance universitaire, de s’aligner sur les balises que fixe « l’idéologie dominante ». Pour réussir dans le milieu universitaire, il faut se conformer à ses « pairs ». En d’autres termes, il faut « Jouer le jeu ». L’opacité dans l’écriture, le recours systématique au PowerPoint, les exigences de publication à outrance, sont des illustrations parfaites de ce conformisme. On a donc mis en place un système où l’on pousse les gens à être moyens. La fierté du travail bien fait a donc tendance à disparaître.
Il est évident qu’un tel constat n’est pas à généraliser de manière excessive dans la mesure où il y a encore des universitaires qui font preuve d’esprit critique. Cependant, nous ne pouvons pas nier le fait que la tendance au conformisme est une réalité de plus en plus présente dans le milieu universitaire. Un phénomène que la recherche des subventions a renforcé.
LE COMMERCE ET LA FINANCE
Dans ce deuxième chapitre, l’auteur oriente sa critique sur la domination de la finance et de la bourse sur « l’économie réelle ». Il met en perspective le danger que représentent, pour les citoyens lambda, les produits financiers « pourris » et l’emballement spéculatif à la Bourse. Les traders ainsi que les experts en finance sont cette autre catégorie de médiocres qui ont pris le pouvoir. À la solde d’une poignée de privilégiés, les « oligarques », ces « médiocres » avec leurs programmes informatiques « jouent » avec des milliards dans leur arène : « Le Marché ». Ainsi, « la rationalité économique relève désormais de programmes informatiques que des experts jettent dans la mêlée, sans précisément savoir ce qu’il adviendra des milliers de milliards qu’ils mettent quotidiennement en jeu » (p. 79).
On constate malheureusement que « l’économie réelle » est devenue l’esclave de la spéculation boursière. Les machines sont devenues des instruments de contrôle du quotidien des citoyens sans qu’ils s’en rendent compte. La fragilité de l’économie s’explique par le fait que « ces machines jouent en Bourse l’épargne des petites gens, les dettes publiques des États, la valeur des monnaies… » (p. 79). L’auteur regrette le fait qu’aujourd’hui tout est fait, grâce aux compagnes de vulgarisation, pour faire intéresser tous les citoyens à la vie des marchés financiers. L’objectif étant de paralyser leur esprit critique face à la domination de ce « nouveau monstre ». Démarche que les magnats du marché considèrent comme démocratique. La démocratie, ici, « consisterait à faire des citoyens et citoyennes des partenaires capables de maîtriser le vocabulaire et les rudiments de cette “science”, moins pour agir sur elle que pour s’y laisser enfermer » (p. 83). L’auteur n’hésite pas à qualifier cette économie spéculative, d’« économie stupide ».
Une économie qui empêche les citoyens à faire preuve d’analyse minimale. Une économie au service des « multinationales » et de la « classe des grands fortunés ». C’est cette économie qui tue « l’économie réelle » et pousse les États à faire « subir année après année des régimes de “rigueur” budgétaire et “d’austérité’ à leur peuple ». La situation des pays comme la Grèce, l’Italie ou le Portugal, est une illustration topique de ce phénomène.
Dans cette « économie stupide », les oligarques renflouent leurs comptes bancaires, tandis que le citoyen lambda peine à joindre les deux bouts du mois. Hélas, cette situation ne semble interpeller la conscience de personne. C’est la raison pour laquelle l’auteur s’interroge : « Pourquoi tant d’inhibition intellectuelle devant d’aussi choquantes situations ? Et de répondre lui-même, “Parce qu’il n’y a pas de domaine où la médiocrité sévit avec autant d’aplomb que dans celui qu’elle s’entête d’ailleurs à toujours appeler « l’économie »” (p. 87).
L’auteur fait aussi le constat selon lequel un médiocre est un « malade d’argent ». Et nul ne semble être, sauf quelques exceptions, à l’abri du mal. « L’argent a fini par s’imposer dans l’histoire tel un but suprême paradoxal » (p. 101) rappelle l’auteur. Pour lui, « aimer l’argent, être attiré par l’argent, c’est être follement épris de ce qui nous donne accès à tout, et c’est n’être en réalité attiré par rien » (p. 102). L’argent pervertit notre esprit. Il l’enferme dans des considérations purement matérialistes. Les figures qui l’incarnent sont : l’avare, le dilapidateur, le cupide, le blasé, le cynique. Notre quotidien est riche en exemples permettant d’affirmer que « la culture de l’argent fait écran » à l’affirmation des valeurs non marchandes. Il serait peut-être temps pour chacun d’interroger le rapport qu’il entretient avec l’argent. Demeure-t-il un serviteur ou a-t-on fait de lui un maître ?
En dehors de « l’économie stupide », l’auteur estime qu’une autre forme d’économie favorise l’émergence de la médiocratie, c’est « l’économie cupide ». Mais qu’est-ce que « l’économie cupide » ? La réponse la plus pertinente, on la trouve dans l’analyse de la situation de l’Afrique. Pour Alain Deneault, « L’Afrique, quoique très riche en ressources, du moment qu’elle demeure dépourvue d’infrastructures et qu’elle laisse des entités étrangères tout simplement piller ses biens, ne façonne aucune économie forte d’elle-même ». (p. 110-111). Les capitaux financiers qui alimentent l’économie africaine ne sont pas le résultat « de la production et de la mise à disposition de biens dans une société organisée ». Ce sont des fonds qui viennent de l’extérieur et qu’elle obtient grâce à sa politique de la « main tendue ».
Le contraste des extrêmes est glaçant en Afrique. D’un côté, il y’a « les très riches – les multinationales, leurs expatriés et les potentats locaux – qui abusent de leurs privilèges » et de l’autre « les indigents qui ont souvent perdu toute possibilité stratégique de s’affranchir de leur condition » (p. 112). La politique menée par les premiers pour, soi-disant, sortir les seconds de leur situation est vouée à l’échec. C’est une politique par petites touches et non globale. Or, c’est en menant une politique qui touche toutes les couches de la société qu’« on pourra libérer un peuple de la culture d’assistanat dans lequel le colonialisme économique le plonge » (p. 113). Mais la question que l’on peut se poser est celle de savoir si le cordon ombilical a réellement été coupé lors des indépendances. Une question à laquelle la réponse paraît comme une évidence. Que ce soit en matière de devise, de références politiques et culturelles l’ombre du colon est omniprésent. Ce qui fait dire à l’auteur qu’« à la manière de fantômes, les puissances coloniales habitent le territoire de par la forme même des régimes politiques qui y persistent ». Il renchérit, « La concentration du pouvoir entre les mains d’un seul atteint des sommets en Afrique, avec la bénédiction, si ce n’est le concours actif, de la France et de puissances occidentales ». Le constat est, certes, amer, mais la réalité et l’actualité sur le continent ces dernières années tranchent en faveur de l’auteur.
La conclusion qu’Alain Deneault tire de la situation de l’Afrique par rapport à l’Occident est révoltante, mais incontestable. Il souligne que « L’Occident a placé les Africains dans une position humiliante, semblable à celle des participants à certains jeux télévisés abjects qui tentent, dans une bulle de verre, de grappiller dans les airs des billets de banque soufflés par un ventilateur » (p. 115). Il faut, de notre point de vue, voir dans ce propos un appel à la prise de conscience collective des Africains. L’auteur dénonce avec fermeté cette politique des Occidentaux consistant à mettre à genoux les pays du Sud dont les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Alain Deneault, condamne également la tendance, ou disons, la prééminence des notions managériales, boursières, dans la sphère politique et publique. Sa critique la plus vive porte sur la sacralisation de la notion de « gouvernance ». Cette dernière « se présente à nouveau comme un art de la gestion privée hissée au rang de la politique qui se veut par conséquent confiscatoire » (p. 143). La gouvernance est l’incarnation du « penser mou ».
CULTURE ET CIVILISATION
Ce troisième chapitre est le prolongement du précédent. Ici, Alain Deneault questionne d’abord le rapport entre l’argent et la culture (particulièrement l’art). C’est le rapport entre « l’économie psychique » et « l’économie matérielle » qui est mis en exergue. La dernière se sert de la première, mais est aussi à son service. Ce qui fait dire à l’auteur qu’“il arrivera à l’argent de servir l’art et de se servir de l’art (…) comme moyen de médiatiser des affects dans l’ineffable splendeur de la médiocrité”. (p. 149).
« L’économie psychique » est l’espace où s’enchevêtrent tous nos désirs intérieurs. Désirs dont la finalité est normalement leur manifestation extérieure. Or, notre société invite les individus à l’autocontrôle. Il faut toujours passer ses intérêts pulsionnels (« Le Ça ») au filtre du « Moi ». Le Moi s’efforce de faire régner l’influence du monde extérieur sur le Ça. Soumis au principe de réalité, il a un rôle de régulateur et de médiateur dans la conception freudienne. Le filtre du « Moi » conduit au refoulement. Alain Deneault souligne que « la morale et les lois comptent au nombre des instances qui contraignent les sujets à refouler » (p. 150). Cependant, le filtre du « Moi » ne s’applique pas aux maîtres de « l’économie matérielle ». Pour ceux qui ont l’argent, « l’économie psychique » s’exprime aisément, puisque ce sont eux qui déterminent la marche de la société. L’auteur rappelle que « la richesse et ses attributs donnent libre cours à de viles attitudes que la condition d’homme fortuné vient de toutes les manières racheter » (p. 152).
Notre condition sociale détermine-t-elle la façon dont nous manifestons nos intérêts pulsionnels ? L’auteur en est convaincu. Selon lui, « l’argent en tant qu’on le concentre massivement vient pulvériser la barrière des scrupules. Investissement suprême, on est prêt à bien des efforts pour se hisser socialement au stade où tous ces efforts psychiques nous seront épargnés » (p. 153).
L’auteur porte aussi sa critique sur un autre phénomène qui détruit l’art et l’artiste. C’est le dictat des riches. Il dénonce cette « injonction qui est faite aux artistes de travailler en fonction des finalités du marché plutôt que de leur démarche » (p. 163). Cette injonction conduit les artistes à créer moyennement. L’expression de leur génie est cantonnée aux exigences du marché. L’artiste doit être au service de « l’industrie culturelle ». En outre, il est demandé à l’artiste de se convertir à la religion du management. “Il faudra donc lui apprendre à l’école de bonnes manières à séduire des partenaires autrement que par ce à quoi il était cantonné jusqu’ici (jets de peintures, discours empourprés et autres steppes) c’est-à-dire en trouvant des arguments d’affaires amenant les grandes entreprises à déposer leur marque directement sur l’emballage de ses œuvres”. (p. 165). Une démarche de nature à tuer l’artiste. Une philosophie qui pousse l’artiste à « la médiocrité artistique ».
Ce qui est dommage, constate l’auteur, c’est que “des artistes jouent le jeu et, de fait, participent à un cirque d’un genre nouveau. Ils réinventent, étendent et consolident un nouvel art de la fiction, pour finalement trouver plus significatifs les bénéfices comptables d’une compagnie culturelle (…) que les conceptions esthétiques qu’elle propose” (p. 166). Mais en même temps « s’il ne se soumet pas à ce dressage, l’artiste ne compte pas ». Tout ceci conduit certainement à la consolidation de la médiocratie. L plus regrettable, c’est de voir l’artiste jouer le rôle de marionnette. Comme l’expert, l’artiste soumis aux paramètres de la gestion privée devient celui qu’il faut utiliser dans des situations dramatiques. Il « est appelé au chevet des victimes, pour dépolitiser l’événement par d’innombrables concerts-bénéfice et déclarations de soutien. On cherche alors à en faire le travailleur social de la vie collective » (p. 174).
Un autre secteur par lequel la médiocratie s’exprime c’est le monde des médias. C’est le moyen pour les médiocres d’asservir les citoyens et d’orienter leur mode de pensée et dilater leur sens critique. La télévision est l’instrument par excellence de la « démassification », alors qu’elle est considérée comme un média de masse. En effet, la télévision « scinde et isole les sujets qui forment la collectivité pour leur offrir simultanément et similairement la même chose » (p. 179). On coexiste socialement à partager un réel qu’on ne consomme plus qu’isolément. C’est l’outil par excellence du formatage des individus. Il permet d’orienter leur façon de concevoir et de voir le monde. La télévision pour l’auteur constitue « de la purée pour l’esprit ». Elle nous éloigne du réel en nous donnant l’impression de nous en rapprocher.
LA RÉVOLUTION : RENDRE RÉVOLU CE QUI NUIT A LA CHOSE COMMUNE
Ce dernier chapitre est un véritable appel à la résistance face à la toute-puissance de la médiocratie. L’auteur constate que « tout est fait pour qu’aucune rupture de ton n’advienne, sinon dans l’utopie rêveuse d’intellectuels égarés » (p. 192). Face à cette logique, il faut lancer une vraie révolution. Nous devons être des révolutionnaires. À ce propos, il cite Rosa Luxemburg qui disait que « nul n’est révolutionnaire par amour de la crise et de la catastrophe, mais par appréhension de la crise et de la catastrophe vers laquelle nous mène le régime instauré » (p. 192). Il existe de nombreux moyens pour lutter contre cet état ambiant qui ne nous porte pas vers le haut.
Alain Deneault nous invite à entrer en résistance pour faire plier ce pouvoir médiocre. Il faut réussir à rendre révolu : la destruction folle des écosystèmes, la domination outrancière de la finance, les institutions et les pouvoirs qui portent gravement préjudice à la chose commune. Pourquoi est-il nécessaire de rendre révolu tout cela ? Parce que « l’université corrompue débouche sur des institutions marchandes d’expertise. L’économie corrompue donne lieu à l’oligarchie financière » (p. 198). Vu le degré de corruption de la société, de l’université, de l’économie, de la culture, une seule solution s’impose. Il faut suivre la recommandation d’Alain Deneault qui nous invite à une rupture collective. C’est ce qu’il appelle « CO-ROMPRE ».
Mais comment résister face à ce pouvoir qui semble avoir le contrôle de tout et sur tout ?
Nous devons avoir non seulement la capacité de dire, avec la plus grande fermeté, « Non », mais aussi et surtout avoir le courage de revenir aux fondamentaux comme nous l’invite l’auteur. Dans un entretien portant sur cet ouvrage, il propose deux pistes intéressantes pour réussir la résistance et la révolution, des pistes auxquelles nous souscrivons. Il faut d’abord dire « Non, je n’occuperai pas cette fonction, non, je n’accepterai pas cette promotion, je renonce à cet avantage ou à cette reconnaissance, parce qu’elle est empoisonnée. Résister, en ce sens, est une ascèse, ce n’est pas facile ». Ensuite, « Revenir à la culture et aux références intellectuelles est également une nécessité. Si on se remet à lire, à penser, à affirmer la valeur de concepts aujourd’hui balayés comme s’ils étaient insignifiants, si on réinjecte du sens là où il n’y en a plus, quitte à être marginal, on avance politiquement. Ce n’est pas un hasard si le langage lui-même est aujourd’hui attaqué. Rétablissons-le ». Le mot d’ordre serait donc : EN MARCHE POUR LA RÉSISTANCE A LA MÉDIOCRATIE.
Références:
Alain Deneault, La médiocratie, Montréal, Lux Éditeur, 2015.