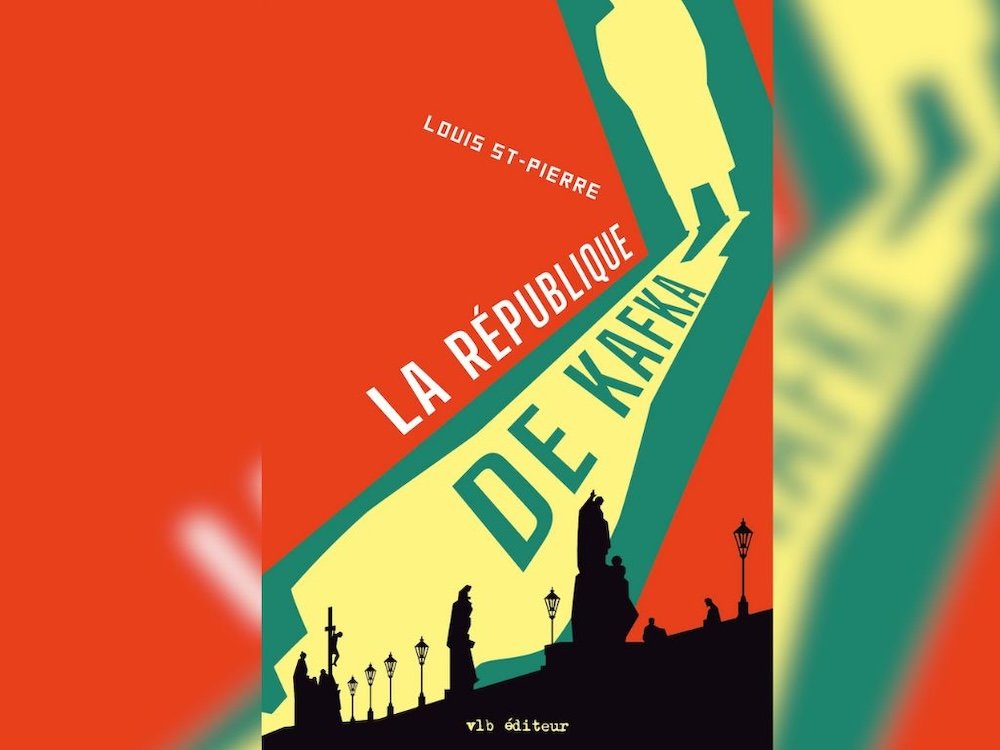« La poésie est venue à moi. »

Bonjour, Marie-Léontine Tsibinda Bilombo, nous sommes heureux de vous recevoir dans Ou’Tam’Si Mag. Nous vous prions de vous présenter à nos lecteurs.
Marie-Léontine Tsibinda est mon nom de jeune fille, celui que je garde aussi pour ma création littéraire, en accord avec Jean-Blaise Bilombo, mon époux. La création littéraire est le fil d’union de notre vie. Si je n’avais pas publié Poèmes de la terre, je ne l’aurais sans doute pas rencontré. Dieu fait grâce, nous tenons debout au fil des jours.
Je découvre au fil des temps que la culture n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais la culture reste ce bouillon de vie où s’élève l’âme sublime d’une nation, d’un peuple. La culture est altérité, partage, communication. Elle est « La marmite de Koka Mbala » qui bout et dénonce les inégalités sociales pour un monde meilleur, demain. Désir de demain, désir de justice et de droiture pour toute la terre.
J’anime un Blogue littéraire « mltsibinda.com » pour partager ma passion des livres, des arts et de la culture, des rencontres multiples de cœurs épris d’amour et de liberté.
Vous êtes l’une des figures marquantes de la littérature congolaise et africaine en général. En quatre décennies, vous avez publié une dizaine de livres. Nous sommes curieux de savoir comment en êtes-vous arrivée là, et plus précisément, comment est née votre passion pour l’écriture ?
La passion pour l’écriture a tracé son chemin dans ma vie non par ma volonté, mais par la grâce divine. La poésie est venue à moi. Elle m’a fait découvrir l’immensité du ciel, le chant des oiseaux, le soleil, la pluie, le vert de la terre, le murmure des eaux qui passent entre les arbres des forêts, notamment la forêt du Mayombe qui est mon environnement écologique donné par Dieu. Les rires, les pleurs des hommes autour de moi, les échos du monde à travers les livres lus, les enseignements des professeurs, les médias sociaux. Des éléments qui se sont ensuite installés en moi et qui au fil du temps ont donné les livres que vous voyez aujourd’hui.
Je n’avais jamais pensé faire carrière dans l’écriture, je me voyais plutôt interprète. Mais les mystères de la vie sont insondables, n’est-ce pas, d’autant plus que dans la maison de mon papa, nous n’avions pas de bibliothèque. Mon papa, Léon Moungoudi, avait la Bible comme livre principal. Une Bible en kikongo, une langue qui n’est même pas ma langue maternelle. Oui ma passion pour l’écriture est une grâce de Dieu. Je suis née avec cette orientation fabuleuse en moi programmée par Dieu lui-même. Comment l’expliquer autrement ? J’entends encore ma mère, Catherine Makanga, dire « a b c d e…» elle n’a jamais été à l’école, ses frères oui. À leur époque, une fille à l’école ne servait à rien, tout comme d’autres avaient pensé, qu’une secrétaire dans un bureau serait un beau gâchis.
Dans un article écrit par Jean-Blaise Bilombo Samba, vous êtes présentée comme « Une défricheuse de sentiers, de la poésie à la fiction théâtrale et romanesque ». Qu’est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes la pionnière de la littérature congolaise féminine, partant du fait que vous publiez votre premier livre en 1980 ?
Il est vrai que mon premier livre Poèmes de la terre fut édité en 1980, aux Éditions Littéraires Congolaises, mais les textes de ce livre furent d’abord publiés dans la revue universitaire de l’université de Brazzaville sous la lumière du Professeur Eugène Ngoma, lui-même poète, auteur du recueil Primitives. Le Professeur Eugène Ngoma fut mon professeur de littérature et civilisation américaines. La revue La Saison des Pluies publia par la suite mes premières nouvelles qui font partie des nouvelles éditées par ACORIA sous le titre des Hirondelles de mer (Paris, 2009).
L’une des nouvelles de ce recueil fera sans doute l’objet d’un film, Dieu voulant, à suivre…
Poèmes de la terre fut reçu comme le premier livre de la femme congolaise pour la bonne et simple raison qu’« il existait une manière de complexe de Cendrillon qui la faisait hésiter à la porte du bal littéraire comme si elle avait de la peine à trouver chaussure à son pied… » comme le soulignait Simon N’tary, le préfacier de Mayombe, mon second recueil de poèmes.
En signant Poèmes de la terre, s’ouvrait effectivement un sentier nouveau pour la Congolaise rompue aux luttes populaires, rouges et révolutionnaires des experts marxistes et léninistes, aux chaires universitaires, aux parquets de la justice, aux urgences des hôpitaux.
Et tout naturellement, la Congolaise était rompue aux tâches ménagères et familiales du logis.
J’avoue que je suis agréablement surprise de la tournure que prend cette passion aujourd’hui. En même temps, je me dis que Dieu qui a construit le monde en sept jours et s’est reposé a mis, dans le cœur des hommes et des femmes que nous sommes, de construire leur existence année après année dans la joie, le chaos, le calme ou la tranquillité. Force est de constater que plusieurs Congolaises empruntent désormais le sentier littéraire avec audace et intelligence. Je suis émerveillée…
Vous êtes donc la première femme à « partager avec les autres écrivains du Congo le pouvoir de la parole », comme le dit Simon N’Tary. Comment avez-vous été accueillie par les autres écrivains et quel a été l’impact de votre entrée dans le landerneau littéraire congolais où l’homme régnait en maître ?
Vous le dites si bien « l’homme régnait en maître » et le premier maître fut Jean Malonga avec son roman Cœur d’Aryenne, en 1953 qui est aussi l’année de ma naissance. J’ai vu le jour le 6 septembre 1953 à Girard, une gare du Chemin de fer Congo-Océan, au bord de la rivière Loukoula. L’homme demeure capable de tracer des chemins extraordinaires, car les hommes congolais dans la création littéraire ont prouvé qu’ils sont semeurs d’œuvres de qualité et bien durables. Je prendrais pour exemple la pièce La marmite de Koka Mbala de Guy Menga qui a fêté ses 50 ans d’existence ! Elle dénonce les inégalités sociales qui perdurent encore jusqu’à nos jours et la reine dans cette pièce a le pouvoir de la parole pour conseiller son époux, le roi.
La femme a toujours eu le pouvoir de la parole, à mon avis. Kimpa Vita, la reine Nzinga en sont la preuve dans nos civilisations en Afrique et il y en a bien d’autres, ailleurs aussi.
En marchant sur les platebandes de mes frères en littérature, j’ai porté ma pierre à l’édifice littéraire du Congo. Je me sens roseau au milieu de ces limbas impressionnants qui n’ont pas rejeté ma parole, mais l’ont appréciée à sa juste valeur. Et je reprends la parole de Simon N’tary le préfacier de Mayombe, pour mieux répondre à votre question, elle dit ceci « Puisse ce talent qui éclate dans chaque vers gonfler les voiles d’une ambition légitime tendue vers les rivages où l’on se fait un nom en littérature…»
Grâce à cette parole, j’ai rencontré Sylvain Bemba, Sony Labou Tansi, Dominique Ngoïe Ngalla, Eugène Ngoma, Kadima Nzuji, Bilombo Samba, Matondo Kubu Turé, Cécile Diamoneka, Marcelline Fila Matsocota, Caroline Bourgine, Tanella Boni, Monique Ilboudo, Ken Bugul, Zenab Koumanthio, Caya Makhele, Arlette Chemain, Tchicaya U Tam’si, Serge Cham, Yannick Dutely, Huguette Jean-François, Liss Kihindou et bien d’autres…
Dans le monde virtuel : Boniface Mongo Mboussa, Naomy Nancy Carlson, Mary Weems, Josilène Pinheiro-Mariz, Emily Thais, Irène Assiba, Clarisse Kiriia, Sylvie Kandé, Isabelle Pranayama, Nathasha Pemba, Marie-Françoise Ibovi, Fatoumata Sano… La liste est trop longue.
Poèmes de la terre est votre premier livre dont le titre fait écho aux Poèmes de la mer de Jean-Baptiste Tati-Loutard. Il s’agit d’un recueil de poèmes où vous célébrez votre enfance passée à Girard (votre village natal) et dans la ville de Dolisie, ainsi que votre adolescence passée à Brazzaville. Comment vous est venue l’idée d’écrire ce recueil de poèmes alors même que vous étiez encore étudiante à l’Université Marien Ngouabi ?
Exact, Poèmes de la terre, ce sont tous les parfums de mon enfance qui remplissent mon espace. Enfance heureuse, simple au milieu de mes frères, de mes sœurs, parce que les frères et sœurs n’étaient pas seulement issus du même père et de la même mère, mais c’est toute la tribu des cousins, cousines et des enfants des voisins. Une grande famille en vérité. Nous formions une troupe d’enfants joyeux sans télé, ni ipad, ni iphone. Mais la radio était présente, car nous écoutions les contes, mais aussi le foot pour les aficionados du foot. Nous écoutions aussi en live, les légendes la nuit, autour du feu, nous construisions des pirogues avec des troncs d’arbres pour voguer sur la Loukoula. Quand il y avait des matendas-dynamites, on ramassait du poisson frais qui flottait sur l’eau. Nous mangions des koumbis, des pangolins, des singes, appelés aussi couz ou cousin, pour rire, sans craindre ébola, corona et compagnie…
Oui, Girard où l’eau fait Loukoula-Loukoula, comme Aimé Césaire disait le Congo « où l’eau fait / likouala-likouala », Girard, un village peuplé de forêt, forêt du Mayombe en particulier, et d’eau, d’oiseaux et de fracas de trains, trains marchandises, comme La Petite Vitesse (la PV), train Comilog, transportant le manganèse du Gabon jusqu’au port atlantique de Pointe-Noire, trains voyageurs. Girard des feux de mon enfance, pas loin des Feux de la planète, un autre titre de Jean-Baptiste Tati-Loutard.…
Dolisie est la ville où j’ai commencé mes études scolaires : j’habitais chez Maman Leki, Marianne Iboumbi, la petite sœur de ma mère, Catherine Makanga, mariée à Papa Georges Matangana. « Je voguais » ainsi d’une maison à l’autre, d’une ville à l’autre, sans crainte. Je constate que j’ai voyagé très tôt. J’ai quitté Dolisie parce que le mari de Maman Leki s’est réinstallé dans son village Vounda et Maman Leki ne me voulait pas dans ce village. Elle me voulait à l’école. Bref, j’ai séjourné à Les Saras, chez l’oncle Job Sathoud et sa femme Emilienne Mvoumbi avec leurs enfants Cécile et Marie Françoise. L’école à Les Saras surplombait et surplombe le village et s’étalaient au loin la gare, la rivière Loukoula et le cœur du village… Des moments inoubliables… On allumait des feux de camps pour marquer la fin de l’année scolaire…
Enfin à Brazzaville, chez mon oncle Albert Sathoud et sa femme Andrée Bernadette Sathoud, de mes années de l’école primaire jusqu’à l’université, j’ai habité avec eux et leurs enfants, Éric, Corinne, Régis. Aujourd’hui l’oncle et sa femme vivent en France, pays de leurs amours, entourés de leurs enfants et petits-enfants.
Tout naturellement Mayombe est venu pour ne pas éteindre le feu allumé depuis Poèmes de la terre. Écrire devenait une tour-refuge face aux nouveaux défis de la vie. L’enfance s’estompait pour entrer dans le monde de l’adolescence et de la jeune adulte avec d’autres préoccupations.
L’Afrique brûlait avec les guerres comme celle de l’Angola plus proche du Congo, les coups d’État, l’apartheid en Afrique du Sud et les signaux étaient alarmants. MPLA. Soweto. Mandela. Winnie. Savimbi… Tout cela résonnait en nous, brûlait en moi… les malheurs du monde nous/me giflaient…
Écrire Poèmes de la terre, c’était partager l’espérance qui jaillit en nous malgré les souffrances qui jalonnent nos vies. Poèmes de la terre, écho à Poèmes de la mer, parce que la terre et la mer congolaises ne font qu’un au cœur de nos Racines congolaises, pour emprunter le beau titre de Jean-Baptiste Tati-Loutard, le poète de la mer, l’enfant de Ngoyo…
Étudiante, je suis allée, avec d’autres étudiants, en Côte-d’Ivoire d’Houphouet Boigny, grâce aux échanges universitaires et j’ai visité Khorogo, Grand-Bassam, San Pedro et bien évidemment Abidjan, la belle capitale et d’autres villes dont les noms m’échappent.
Ce recueil de poèmes a été le déclic d’une longue et riche carrière littéraire. Vous avez publié de la poésie, du théâtre, des nouvelles, des romans et des contes. Au regard de vos publications, vous semblez avoir un penchant particulier pour la poésie. Que représente le genre poétique pour vous ?
La poésie et moi resterons liées à jamais. Elle ne me quitte pratiquement pas. Des poèmes j’en écris presque tout le temps. Elle est attachée à mon âme. Elle pleure et rit avec moi. Souffre et danse avec moi. Elle sourit et fortifie mon cœur. De la poésie, je peux écrire un récit, comme de la nouvelle, un roman. Rien de nouveau sous le soleil, d’autres l’ont fait avant. La poésie, un souffle évanescent qu’il faut saisir quand il « pope » dans ton cœur. Brise ou feu. Elle est comme un messager du vent qu’il faut vite saisir pour ne pas perdre la quintessence qu’il apporte. Elle peut s’écrire en trois mouvements « boum boum boum » ou s’étendre en une braise difficile à éteindre. Elle t’allume et te consume tant que tu ne la sors pas de tes entrailles. C’est elle qui te donne le rythme, pas autrement.

C’est en 2017 que vous publiez votre premier roman Lady Boomerang (Éditions L’Interligne). Pourquoi une si longue attente ? Doit-on penser que vous aimez moins le roman que les autres genres ?
Bonne question, mais comment donner une réponse satisfaisante ? Je vous ai dit plus haut que la poésie est venue à moi, je ne peux trouver d’autres mots. La nouvelle, le conte et le théâtre ont suivi et l’écriture romanesque a été le « dernier des mohicans ! » Pourquoi cet ordre ? Quand Sylvain Bemba me disait : « Marie-Léo, tu dois publier ton premier roman avant tes 30 ans » j’avais essayé et le manuscrit qui a perdu bien de pages au passage du temps, a survécu aux guerres et aux voyages. J’ai le cahier avec moi. Je pense que mon subconscient n’était pas encore prêt. Et quand j’ai écrit pour l’anthologie Sirène des sables, en 2014, avec mes consœurs au pays et de la diaspora, la nouvelle Lady Kimpa V, il y a eu comme un déclic, la nouvelle est devenue Lady boomerang, mon premier roman publié en 2017, à Ottawa, aux Éditions L’Interligne, presque un siècle plus tard, dirai-je ! Aujourd’hui, j’ai quelques manuscrits de romans. Il me faut les relire et retravailler en un mot, remettre l’ouvrage sur le métier. Les genres viennent à moi, au temps convenable, gonflent et prennent le large comme un bateau qui prend la mer. L’écrivain essuie tempêtes et orages, entre au port, épuisé, mais heureux de partager une idée, un message, une espérance…
Vos livres témoignent d’un attachement à votre terre natale. Vous clamez votre amour indéfectible au Congo, vous y regrettez les tumultes que traverse l’Afrique et vous y formulez l’espoir d’un lendemain plus reluisant. Comment vous définissez-vous en tant qu’écrivaine ?
J’ai passé toute ma vie au Congo entre Girard mon village natal, Dolisie, ma ville scolaire, Vounda, village du mari de Maman Leki, Les Saras, village de l’oncle Job et Brazzaville, chez l’oncle Albert, sans oublier Pointe-Noire, chez Tante Anne alias Keke, (la sœur de mon père, car les autres parents appartiennent au clan maternel), pour les vacances et j’ai vu un Congo heureux malgré le ciel qui lui tombe sur la tête. Les gens se confient en Dieu pour passer au travers des calamités qu’ils rencontrent. Et ces personnes qui pleurent et qui rient sont mes compagnons dans ma création littéraire. Elles sont mes racines congolaises qui me poussent à aller plus loin. Elles me donnent l’assurance de ne pas travailler en vain, m’encouragent et à ce titre, je me sens l’écrivaine des sans voix. Elles me donnent la force de résister face aux prédateurs de nos vies. Aujourd’hui plus que jamais, je sais que Dieu ne nous abandonnera pas, ne nous délaissera pas, car lui seul est maître des temps et des circonstances.
Votre dernier livre, Ô Yesu, un cantique nouveau, parait en juin 2021 aux Éditions CANA, en France. Il s’agit d’une poésie qu’on pourrait qualifier de chrétienne. Vous y témoignez votre amour à Dieu, Yesu en votre langue maternelle. Pouvez-vous nous parler de ce livre ?
Ô Yesu, un cantique nouveau sont en effet des textes inspirés de la Bible, ce sont les paroles de la Bible qui chantent dans mon cœur. Il m’arrive d’entendre des mélodies quand je lis ma Bible et comme je ne sais pas chanter, j’écris. Si d’autres les chantent, tant mieux. C’est mon vœu.
Outre la parole, il y a dans ce recueil des chants chantés dans mes songes et que je n’ai pas oubliés à mon réveil. Il n’y a qu’un texte, Ô Yesu, en lumbu, ma langue maternelle, mais vous trouverez des textes en kikongo, une des langues du Congo, parlée aussi au Congo-Kinshasa et en Angola. Oui Dieu est omniprésent dans cet ouvrage. Dieu aime qu’on le loue, l’exalte et sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu est esprit et vie. La manger chaque jour comme on mange son pain ou son manioc est reposant.
Ô Yesu un cantique nouveau, est une louange à l’Éternel, vous voyez comment les foules s’allument lors des concerts des artistes du monde, le délire qui s’empare d’elles ? Osez alors imaginer, pour l’éternité, la louange des anges de Dieu louant l’Éternel dans les lieux célestes !
Le pouvoir de la louange est un mystère que l’homme n’a pas encore fini de comprendre et de maîtriser.
Selon vous, quel est « l’itinéraire d’une femme dans la forêt des hommes des lettres du Congo-Brazzaville » ?
Un parcours de paix et d’unité qui marche et épouse le rythme soutenu des chants des hommes des belles lettres du Congo. Un parcours qui laisse des traces pour les générations d’aujourd’hui et celles de demain. Une forêt de limbas à qui je souhaite succès et réussite. Se donner la main, chercher et accepter l’altérité, partager les joies et les peines et toujours écrire, écrire, écrire…
Les lettres congolaises rendent un bel hommage à notre Congo. Toutes les lettres de noblesse viennent de cette création florissante qui brille de tous ses feux. Une littérature traduite en plusieurs langues, portée au cinéma, à titre d’exemple, je citerai le romancier Emmanuel Dongala et son livre Johnny chien méchant, que Stéphane Sauvaire a adapté au cinéma en 2008, sous le titre de Johny Mad Dog.
Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle qu’a joué la Femme dans le processus d’émergence de la littérature africaine ?
De nombreuses personnes pensent que les femmes sont bonnes pour servir uniquement de matelas et de siège pour s’y reposer. Il n’y a pas que ça. Dieu leur a donné une intelligence et une force incroyable pour faire face aux difficultés et combats de la vie. Combats pour la liberté, se libérer du joug oppresseur de l’ennemi, de l’esclavage comme Harriet Tubman des USA, Kimpa Vita du Congo, les Amazones du Bénin, Winnie Mandela et Myriam Makeba de l’Afrique du Sud pour ne citer que celles-là.
Aujourd’hui naissent d’autres voix, d’autres figures comme Nathalie Yamb, Aminata Dramane Traoré et qui se lèvent pour dénoncer encore et encore les politiques abjectes contre l’Afrique. La lutte sera longue, « Gare aux pieds nus ! » comme disait Tchicaya U Tam’si!
Les femmes osent marcher pour la liberté…
Souvenez-vous, elles sont os et chair, pas argile. Un os c’est du solide. Il y a un mystère dans cet être que personne ne peut comprendre. Elle est créatrice de vie et dans les arts, elle est toujours là. C’est elle par exemple qui enseigne l’art du chant à ses enfants par les comptines. Une littérature chantée dès le berceau.
Pensons par exemple aux Sud-Africaines et leurs maisons aux différents merveilleux designs. Aujourd’hui, à travers l’écriture multiforme, cinéma, théâtre, musique, littérature, le monde artistique n’a plus de secret pour la femme congolaise, africaine ou d’ailleurs. Pour moi, les choses se mettent en place au temps voulu par Dieu.
Aminata Sow Fall, la Sénégalaise, a montré qu’une femme peut publier des livres qui mettent en valeur le rôle de la femme dans la société. Sans la femme, la société ne sera qu’un jardin immense de solitude. La femme est le roc fondamental d’une maison, d’une société qu’elle bâtit pas à pas, à la sueur de son visage. Faiblesse et force l’habitent. La couronne littéraire est une flèche de plus dans sa gibecière. Et il n’y a plus que Aminata Saw Fall, la chaîne s’allonge, s’étend à l’infini, de Tanger au Cap, de Brazzaville à Dar-el-Salem…
L’année 2020 a été particulièrement marquante pour la littérature africaine francophone en général et en particulier pour la littérature africaine féminine, avec notamment le parcours élogieux de l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal au prestigieux Prix Goncourt. Elle ne l’a pas gagné certes, mais elle est passée si près et s’est contentée du Goncourt des Lycéens et de multiples autres choix. Que vous inspire ce succès en tant que pionnière ?
Oui, une année du « taotao » ou du tonnerre, comme dirait Joseph Gabio, un journaliste bien connu dans le milieu sportif et littéraire du Congo et dans le monde.
Quand Djaïli Amadou Amal publie Les impatientes et devient la première africaine à remporter le Goncourt des Lycéens, après Leonora Miano en 2006, elle ne s’attendait pas à cet honneur. Elle mérite bien ces louanges. À chaque personne ses chances. Je ne peux que la féliciter, me réjouir avec elle. Les batailles ne sont pas finies tant que les violences conjugales, familiales et les religions abusives demeurent des pièges pour l’être humain partout dans le monde. Ces violences planétaires et aveugles nous rendent misérables, malheureux, pauvres et nus devant la compassion, l’amour du prochain qui devraient primer plus que tout. On peut aussi penser au roman de Mariama Ba Une si longue lettre, qui a déjà dénoncé les malaises et abus des foyers polygames. Longue est la nuit, dit Tchichellé Tchivela, vive est la lumière qui finira par poindre un jour… Oui, Demain est un autre jour, dis-je et comme Maya Angelou, Amal peut clamer sans hésitation Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage, car ce qu’elle décrit dans ses livres l’a profondément touchée pour avoir vécu et subi ces violences. Vous savez le ciel est un tapis où les étoiles petites et grandes acceptent leur place, apportent chacune sa lumière et quand le soir arrive et que Madame la Lune étale son tapis, la paix l’accompagne pour le bonheur des hommes qui ne peuvent qu’admirer cette harmonieuse beauté céleste. Le jardin littéraire doit demeurer un ciel étoilé…où chacun se réjouit des œuvres de l’autre et des siennes, petites ou grandes.
Selon vous, que faut-il faire pour que la femme africaine s’affranchisse du joug patriarcal et accède à plus de liberté ?
La liberté a toujours fait partie de la vie de la femme africaine. Quand nous lisons La légende de Mpfoumou Ma Mazono de Jean Malonga, Hakoula la grande héroïne est une femme libre…Oui, elle a eu des amants au grand dam de la famille de son mari. Personne ne se réjouit de l’adultère, car la couche ne doit pas être déshonorée ni souillée. Mais le temps a fini par assagir Hakoula et sa repentance a donné les fruits merveilleux du pardon et de la réconciliation…en toute liberté. La femme est née libre et la société veut l’encadrer, la contenir dans ses élans, en vain. Elle mérite amour, amour, amour pour qu’elle donne le plein potentiel qui picote en elle…
Propos recueillis par Boris Noah, 19 septembre 2021.