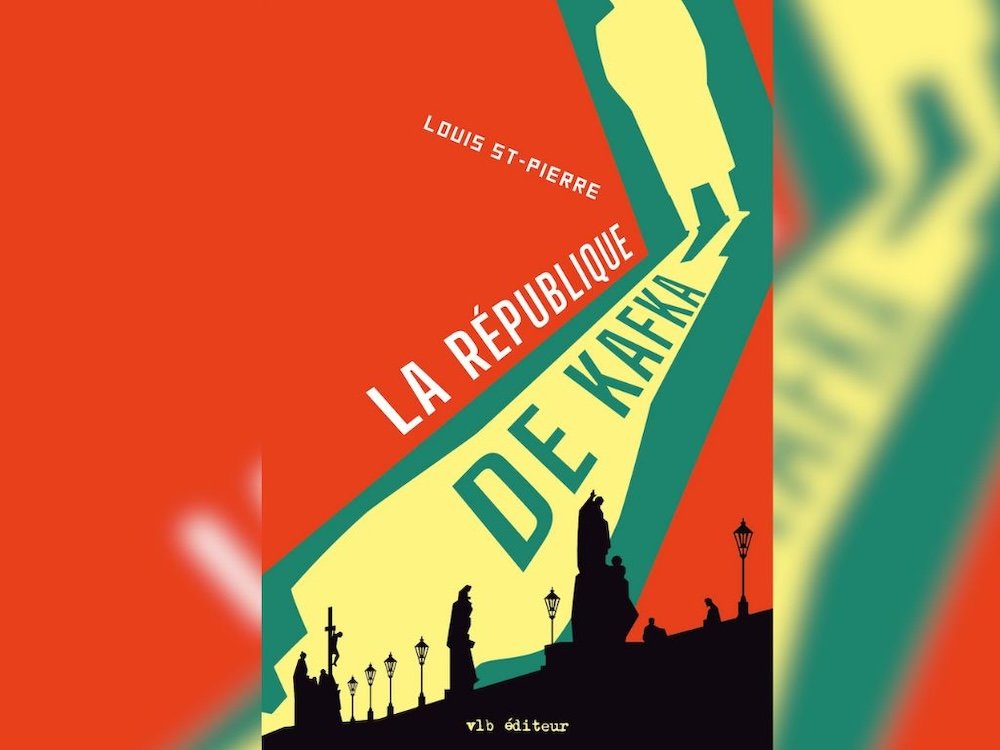« Je choisis Ahmadou Kourouma pour illustrer le discours masculin comme forme et le discours féminin comme matière. »
Bonjour, Julie, comment allez-vous ?
Bonjour Nathasha. Je vous remercie pour votre intérêt sur mon livre et ma personne. Je vais bien merci. Et vous ?
Moi aussi je vais bien. Merci Julie. Dites-nous un peu, Julie, qui êtes-vous ?
Je suis Professeure de français Langue Étrangère (FLE) au Centre social de Villiers-sur-Marne, en Île-de-France. Mon histoire est celle d’une femme d’origine camerounaise, venue poursuivre des études en France. Mon père était un homme de Lettres, et ma mère une brave femme instruite. Ma famille maternelle est constituée d’une généalogie féminine. Mon arrière-grand-mère était une griotte. Elle chantait et dansait des louanges des grandes personnalités. Quant à ma grand-mère, elle me disait de lui apprendre l’alphabet et les chiffres. Enfant, je le faisais avec joie et j’aimais entendre la sonorité de sa voix lorsqu’elle lisait l’étiquette sur sa bouteille de bière. Lire était évident pour moi, mais pas pour elle. Je lui disais « spécial » et elle disait « esspecial », et nous recommencions à l’infini pour qu’elle articule comme je le voulais « spécial » et nous finissions par en rire aux éclats. Cette leçon donnée à ma grand-mère était très importante pour moi. Car il y avait une transmission orale et une sorte d’échange entre deux générations différentes : celle de l’oralité et du rire d’une part, celle de la jouissance d’un savoir livresque et celle de la langue et de la norme écrite, d’autre part.
C’est pour elle que j’ai écrit pour la première fois une histoire, celle de l’origine de ma tribu qu’elle me racontait. C’est pourquoi j’ai voulu parler de ce qui me relie à la vie et aux femmes de ma famille. Est-ce la parole, l’écriture, la transmission, la généalogie féminine ? En venant faire mes études en France, mon projet a été de contribuer à la recherche, notamment, dans le domaine des écritures féminines et celui de la langue française coloniale.
Les auteurs qui ont bercé mon enfance sont entre autres, Maïmouna d’Abdoulaye Sadji, Ville cruelle de Mongo Beti qui parle de la femme africaine et du colonialisme. J’ai soutenu une thèse de littérature française et francophone, en France. L’ouvrage « Émancipation et création poétique. De la négritude à l’écriture féminine » est un essai tiré de mes travaux de recherche. Il est destiné, entre autres, aux femmes. J’aime l’écriture et la lecture. Très jeune, il m’est arrivé d’admirer mes enseignantes de Français. Les femmes qui lisent et qui écrivent exercent sur moi une fascination.
Une question pour vous : Qu’est-ce que le langage ? Peut-on parler d’un monde sans langage ?
Le langage est la marque de communication relevant ou non de l’oralité. Il est le signifiant qui excède le signifié, il est le moyen d’expression. Le langage est aussi le logos dans toute son amplitude, la racine unique, issue de la civilisation grecque, la raison, le discours, la parole, l’écriture, la voix. Enfin, en tant qu’africaine je crois que le chant, la danse sont aussi un mode d’expression. Ce concept de langage est riche. Jacques Derrida, qui est un auteur difficile à comprendre, montre que le logos grec a capitalisé toutes les formes de communication et ceci a pour conséquence de relier ou même de conditionner la communication au langage oral. Ce grand théoricien du langage explique les nuances et définitions du langage dans L’Abécédaire de Jacques Derrida.
Premièrement, il est fondamental de savoir qu’« il n’existe pas de sujet antérieur au langage, je peux penser à quelque chose avant de l’écrire, mais même le fait d’y penser découle de toute une tradition de langage et de pensée ». Je tiens préciser que cette citation est tirée dans le livre S’initier à la philosophie, page 215.
Deuxièmement, en plus de l’antériorité du langage, nous pouvons constater que le langage est une notion abordée par la littérature et la philosophie. Il est le lieu de la communication, de l’échange, mais aussi de l’aporie, du manque, du « sans » du débordement. Dans la part de la philosophie qui privilégie le langage, la grammaire comporte une part très importante. Ainsi que la rhétorique qui concède une importance particulière au mot, à la syntaxe, au niveau de langues. En effet, la langue est la matière dans laquelle la philosophie se déploie avec précision, le bon usage des mots. Tout ceci supposant qu’il y ait des conventions, des contraintes, bref une forme érigée en modèle. On se rappelle les mots de Nicolas Boileau : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ».
À partir de la parole, et en occurrence de la parole élégante, distincte, on voit que l’on peut être identifié, classé par la façon dont on s’exprime. La langue est donc bien le lieu de la discrimination. Toutefois, le langage introduit l’incertitude, le débordement. En effet, le philosophe Derrida emploie la langue non pas comme un endroit de vérité, mais comme un lieu où les certitudes, les savoirs, peuvent être remises en question. Pour lui, le domaine de la langue, la parole ne doivent pas être régis par un héritage, un savoir grec, mais par un vide au sens de l’accueil. Le langage est toujours à prendre dans son « rapport à l’autre ».
Pour moi, le langage est considéré comme le point de départ de l’existence. La distinction entre l’homme et l’animal, le langage est à l’origine de toutes organisations sociales. Il est aussi la matrice de l’exercice du pouvoir. Je postule que le langage nous fait sans cesse redéfinir les mots, la pensée, le langage, le signe, le phonème, le graphème. C’est le jeu de la différence. Il n’y a pas de valeurs stables du sujet comme le définit le logos, en proposant la raison, le langage, la pensée, etc. Le langage redéfinit le sujet, y compris le sujet grammatical, pour comprendre cette projection du sujet en train de se jeter dans la pensée et de se coucher dans l’écriture, et redéfinir un sujet, un langage dont l’identité et les valeurs sont celles du monde contemporain. La question de l’autonomie du langage est ainsi posée, le langage qui devient performatif et s’accomplit comme langage en lui-même. Je me propose de considérer le langage comme un discours qui répand une partie de son discours par-dessus bord.
La part du langage qui est pris en compte par la philosophie place le langage comme le point de différenciation entre l’homme et l’animal. Dans le contexte philosophique, la philosophie depuis Platon s’est penchée sur la question du logos et son implication dans le langage et la pensée. Or, à l’origine c’est la philosophie et la métaphysique, avec ce qu’elles comportent de vérités établies qui déterminent que l’homme est supérieur à l’animal par sa capacité à s’exprimer et à penser. Cependant, la question de l’homme est celle du sujet. Le logos tient un discours conventionnel sur le sujet, en le définissant comme un être de raison, capable d’accéder à l’être symbolique, au langage, au logos plaçant l’homme en opposition à l’animal qui n’a pas de parole. Dans cette perspective, un monde sans langage serait un monde sans pensée, sans raison.
Or, nous voyons aujourd’hui que dans cette perspective, celle du logos grec, d’un homme supérieur à l’animal, l’humain laisse revenir ses désirs et ses pulsions les plus profondes par des actes de violence notoires et de barbaries telles qu’on le voit agir dans la nature humaine. Le monde a produit des catastrophes tels l’esclavage, les invasions, les génocides, les nombreuses guerres, les impérialismes, l’immigration illégale, les coups d’État. La question du sujet du langage est complexe. Le langage devient le lieu où s’exprime cette violence; il est le lieu de la catharsis, l’espace où l’on peut ressortir ce qui a été refoulé. Mais Derrida pose la question de la définition du sujet du langage et de l’écriture, telle qu’elle a été déterminée par le logocentrisme, et pour lui, le sujet est d’abord ce qui résiste à toute définition et à toute identité. Il s’agit de mettre la définition du sujet non pas dans cette catégorie du savoir grec, mais au contraire avoir la capacité de reconnaitre l’autre comme un être total assumant sa part d’animalité, sa singularité, sa part de complexité, de violence, de frustration, de pulsion, que la bienséance refoule et refuse de nommer. La question de l’autonomie du langage est posée.
Pensez-vous que les écrivains originaires d’Afrique ont de plus en plus besoin de positionnements clairs de la part des spécialistes sur certaines questions ?
Les écrivains originaires d’Afrique s’inscrivent dans un espace et un contexte où il y a possibilité d’action, leur littérature est produite selon les conditions historiques d’asservissement et d’aliénation coloniale. Ces auteurs bénéficient d’un héritage linguistique, culturel, colonial et d’une culture nationale. Ils rapportent dans la langue française les divers apports dont ils ont bénéficié par leur double culture. Ils interrogent ce balancement de la langue française de part et d’autre de son centre. Cette mise en valeur de la diversité, de la pluralité et ce mélange des langues sont une richesse et une source de créativité. On peut observer à partir de cette rencontre, la naissance des langues telles que les créoles, le français langue coloniale, le pidgin, le petit nègre … Diverses formes d’expressions et de thèmes caractérisent, par ailleurs, les ouvrages des auteurs africains : l’oralité, le rythme, la musique, le chant, le corps. Ils installent une hospitalité poétique dans un champ littéraire, politique, sociale ou féminin .Par cette rencontre avec l’Occident logocentrique, le mélange prend vie. Il est important que les spécialistes s’attardent sur ces questions : langue, écriture, culture, politique, d’engagement.
Car ces questions deviennent des questions fondamentales. Les auteurs africains ont besoin que ces théoriciens, ces linguistes, ces spécialistes qui ont des positionnements clairs. Le spécialiste et poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor qui a un positionnement clair sur la Négritude (néologisme qui vient du mot nègre,) insulte faite à l’Homme noir qui a été asservi, humilié. La Négritude selon ce théoricien est essentiellement culturelle. Il promeut le rendez-vous du donner et du recevoir. Ainsi, les poèmes africains s’approprient de la langue française et son écriture en lui apportant les tournures orales, un rythme différent.
Pour ces théoriciens, il est essentiel de se détacher de l’écriture telle qu’elle était pratiquée sans aucune marque culturelle. D’Édouard Glissant à Aimé Césaire, en passant par Lise Gauvain ou Patrick Chamoiseau, avec ces spécialistes, nous distinguons la question du lieu. Ces spécialistes posent la question du lieu de l’écriture. Où sommes-nous ? Le lieu historique de la langue française qui serait la racine unique celle dont Edouard Glissant dit qu’« elle tue tout alentour ». Edouard Glissant dans son ouvrage La Poétique de la relation explique sa philosophique de la relation où il explique bien la théorie de la relation, les notions de traces dans l’écriture, et d’opacité. Il parle du lieu de l’écriture qui fréquente la diversité du monde. Il met en exergue une relation entre les possibles qui se touchent, s’harmonisent. Pouvons-nous faire la synthèse entre l’un et le multiple ? La permanence et le changement ? L’ordre et le chaos ? Le repos et le mouvement ? Lise Gauvin reprend le terme d’errance en précisant que la langue se construit par l’autre en soi. Jean Paul Sartre dont on connait l’engagement pose la question de savoir s’il est possible, pour un Africain, d’exprimer sa révolte dans la langue du colonisateur. Ces positionnements clairs des spécialistes sur certaines questions, dont celles de la langue française, du lieu de l’écriture, de l’asservissement colonial historique, de l’engagement littéraire, sont importants pour les auteurs africains.
Pourquoi avoir choisi Ahmadou Kourouma pour comprendre le discours féminin comme matière et le discours masculin comme forme?
À l’origine de l’écriture féminine africaine, nous pouvons citer les textes féministes de Marie Claire Matip, par exemple Ngonda, dans lequel l’auteur fait dire à son narrateur que la femme est faite pour le mariage, la cuisine et l’éducation des enfants. Pour ce même narrateur, l’école pervertit la femme. L’écrivaine en Afrique est doublement « motivée » : d’une part, son imaginaire – davantage que celui de l’homme – est ancré dans les contes, les berceuses, les chants de la tendre enfance, par le rôle social qui lui est encore dévolu. D’autre part, il lui faut plus encore que l’homme se distinguer dans la compétition littéraire. La littérature féminine est née en Afrique subsaharienne après les indépendances. Mariama Bâ est l’une des pionnières de cet élan. Dans son roman épistolaire, Une si longue lettre, l’auteure s’adresse à sa camarade, et lui raconte les péripéties de son mariage et de son veuvage en situation de polygamie. Cette auteure veut dénoncer les pratiques humiliantes et spoliatrices réservées aux femmes veuves, durant leur période de deuil. Son écriture s’inscrit dans le prolongement des récits oraux, des contes, des berceuses, des chants des cérémonies de mort ou de naissance que produisent les femmes dans un apport culturel à la société traditionnelle. Les auteurs féminins d’Afrique subsaharienne dits « de la nouvelle génération de la littérature » entrent en ligne de mire par une écriture, qui s’illustre dans un lexique particulier. Dans cette catégorie, on peut citer Were-Were Liking et Calixthe Beyala qui n’hésitent pas à passer de la retenue, de la résignation à l’audace, au sarcasme dans leur langue.
Dans Les Soleils des indépendances, l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma dresse un tableau touchant de la femme africaine. Ce texte montre un personnage, Salimata, écartelée, qui incarne l’ouverture inconditionnelle de la différence et de la « différance » sans négativité. Salimata est le personnage qui vient bouleverser une tradition séculaire. L’excision, elle s’y plie, mais elle est charcutée et non excisée. Elle n’est donc, ni parmi les mêmes excisées (femmes, selon certaines traditions, dignes de respect et de considération), Elle n’est pas parmi les femmes révoltées contre l’excision (femmes ayant pris en main leur corps) elle ouvre une nouvelle voie, une nouvelle place, celle de celles qui sont hors de la place, hors de la case, hors du but à atteindre, hors des traditions et des mots, mais, également hors du temps. Salimata est aussi ce personnage qui est « à côté », c’est-à-dire qu’elle incarne ces femmes qui n’ont pas leur « chambre à soi », un lieu et une écriture où se déverser, à la façon de Virginia Woolf. Amadou Kourouma traduit son cri étouffé. Je ne souhaite pas séparer le fond et la forme de l’écriture féminine.
Toutefois, je choisis Ahmadou Kourouma pour illustrer le discours masculin comme forme et le discours féminin comme matière, car dans sa thématique. Il montre l’humiliation, la violence, les sacrifices subis par des femmes. Il parle aussi des sacrifices, d’excision et des viols, la violence de son écriture frappe, mais aussi son contenu analytique. Dans son texte, avec le fait de l’excision qui est rapportée par sa justification coutumière et presque religieuse : il parle de la recherche de pureté. Le refus de la confusion entre plaisirs et procréation sont aussi notés. Dans la forme, il y a la force et la conviction attribuée à l’écriture masculine, selon les clichés. D’autre part, la forme de ce discours est un récit oral, proche du chant, de l’ode, l’admiration la louange. Ahmadou Kourouma, qui chante la femme africaine, utilise les techniques du conte, il sait manier l’oralité qui est un genre qui est utilisé dans les berceuses, les chants, les contes, qui sont généralement attribués aux femmes. L’écriture d’Ahmadou Kourouma lorsqu’il décrit Salimata.
Cette écriture orale est un chant, une louange, une admiration pour la femme africaine, un cri et un hurlement, mais aussi une conviction et une forte opposition contre le silence des femmes qui vivent hors de leur corps. J’ai choisi la définition de l’écriture masculine et féminine de Jean François Lyotard. Jean-François Lyotard, énonce les clichés de l’écriture masculine et de l’écriture féminine dans Rudiments païens : « La féminité de votre écriture dépend, croit-on, de ce qui y passe. On dira qu’elle est féminine si par exemple elle opère par séduction, plutôt que par conviction ». Dans ce genre de vision de la féminité, l’écriture est « féminine » par métonymie, elle opère par un glissement vers la qualité distinctive de la femme, la « séduction », par opposition à la force de la « conviction » prêtée aux hommes. La conviction serait masculine parce qu’il s’agit de l’imposer et, pour ce faire, il faut toute la vigueur et l’énergie masculines, pour ne pas dire la violence. L’écriture féminine, selon les stéréotypes du féminin, serait donc une écriture de la séduction, de l’émotivité, de la sensibilité, de l’impulsion, de l’hystérie. Mais nous pourrions dire aussi que la séduction est une force présente chez l’homme comme chez la femme, même si l’homme en use lorsqu’il s’adresse à la femme Ahmadou Kourouma, qui comme Mongo Beti, a écrit sur la femme africaine, a innové sur la forme.
Ainsi pour montrer l’écriture féminine comme matière et l’écriture masculine comme forme, Ahmadou Kourouma dépasse les clichés de l’écriture masculine ou féminine. Son écriture fait place à l’accueil, l’ouverture, le mouvement. Nous retrouvons en marge de ce récit, le contraire de l’écriture d’Une chambre à soi de Virginia Woolf. Amadou Kourouma dresse le portrait d’une femme et substitue son propre cri, sa sensibilité, son émotivité, son oralité, sa répétition, car ce personnage n’est qu’une profusion des images du corps, le sang, les sensations, d’un personnage livré , un personnage qui est dans le don, et qui n’a rien à dire. C’est l’auteur qui prend en compte l’interpellation des lecteurs qu’il prend dans une relation conteur et récepteurs; car il chante une certaine femme africaine, douce, affable, humiliée, blessée dans sa chair à vif; et nous trouvons aussi la lucidité et la conviction analytique, attentive et descriptive. Car il analyse les excisions, les viols, les sacrifices avec détachement, lucidité et sans complaisance. D’emblée, notons que Kourouma utilise la métaphore de la femme « differante » qu’est Salimata pour illustrer le rapport irréductible au temps. L’écriture saisit tout ce qui est dans l’instant, le présent, l’immédiateté. Cette écriture « différante » ne peut pas être lue de la même manière par le Français et par le colonisé et ne peut pas non plus être lue de la même manière à des époques différentes. C’est donc bien du mouvement de l’écriture dont il est question.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots le rapport à la création littéraire, la langue coloniale et les émancipations intellectuelles, politiques et littéraires ?
Les poètes tels que Léon Gontran Damas montrent qu’il y’ a eu interaction entre la création littéraire et les indépendances. L’écriture de Léon Gontran Damas est une écriture volontairement revendicative de la mémoire, de l’oralité et aussi de l’appropriation de l’Afrique. Mais nous pouvons aussi postuler que cette écriture prépare les indépendances. Dans Limbé le poète évoque un ennemi, en quelque sorte désigné par le mot « ils » désignant ceux qui sont venus brouiller une construction, une sagesse, un mot, un palabre. En fait ce qui a été cambriolé c’est la culture, une culture indigène représentée par les mots « mains, terre, cadence, etc.» Le langage donne du cri, de la colère, de la tristesse par son corps, son rythme, sa monotonie, sa langueur, sa noirceur. C’est la langue qui devient le lieu de création d’une certaine « production noire » c’est-à-dire que la langue du poète devient le lieu de la mélancolie, des idées noires, de la colère, de l’hostilité.
Le travail de l’écriture et de la langue telle que les écrivains de la Négritude le pratique implique une forme de revendication d’identité, du langage, du nom, du propre. « Ils ont cambriolé l’espace qui était mien ». Le ton impérieux de ce poème Limbé montre la volonté de se dégager de l’impérialisme occidental La mémoire est aussi présente dans cette poésie, C’est une écriture qui retrace les origines anciennes, le passé, les traditions d’un peuple, d’une communauté. Cette poésie est une écriture qui n’est pas là pour restituer une parole, mais qui est juste de la trace, et qui dessine un nouvel horizon, quelque chose qui fait effraction d’une écriture reflet du logos. L’écriture serait ce nom qu’on est le seul à pouvoir déchiffrer. La parole devient ce par quoi le poète se réapproprie sa langue, sa culture, son chant. « Rendez-moi mes poupées » est l’impératif du commandement du poète lui veut renouer avec une origine que lui a volé la culture occupante, et en même temps, cette altération l’interpelle, le somme d’interpréter sa propre culture, de la chercher et c’est en étant privée d’elle, qu’il en voit la nécessité, d’où la parataxe « mains… noires ». Il serait question d’une création poétique fantasmatique, qui serait au premier degré, une réclamation.
D’emblée, la complainte du poète est sans doute ce jeu de la langue qui peut se faire colérique, triste, langoureuse, mélancolique ou encore violente, même suppliante, ou nostalgique. L’écriture va rendre présente cette affectation : la poésie de Léon Gontran Damas est déjà u chant de colère, de mélancolie, une litanie, une complainte, une affectation dans le sens d’affecter, c’est-à-dire transmettre dans un autre lieu, le lieu de la tristesse et de l’exaltation lyrique. « Ils ont cambriolé l’espace qui était mien ». Ici, l’oralité est relayée par l’usage des répétitions, et par des instances qui font penser, du fait de leur surabondance, à une « rançon de l’absence » laissant place paradoxalement au comble de la voix et de la nomination, à l’oralité.
Le poète Léon Gontran Damas montre cet instant de la voix, une voix qui s’inscrit dans le présent, le maintenant, l’ici, le « je » performatif, le « je » de l’écriture. Il y’a un écart entre la colère et ses causes, qui révèle la créativité de l’écriture située dans cet écart entre la vocifération (de l’émotion de la voix qui crie pour crier) et la charge polémique d’un discours politique en filigrane (qui crie pour dénoncer une situation de domination). Toutefois : est-ce que le poète n’est pas dans un néant ? Est –ce qu’il n’est pas dans l’exaltation d’un imaginaire africain ? Dans ce poème, Limbè que nous prenons en exemple de l’interaction entre la création politique et les émancipations intellectuelles, politiques et littéraires, la langue se distingue par cette multiplication du « moi » qui peut évoquer l’écriture lyrique recentrée et repliée sur « soi » où le poète est sujet et objet du langage. Le rapport entre la création littéraire, la langue coloniale et les émancipations politiques intellectuelles et littéraires se voient dans les œuvres de Calixthe Beyala, Aimé Césaire, Amadou Kourouma, car ces auteurs ont comme Léon Gontran Damas, établi un rapport d’hospitalité poétique dans un champ politique, social ou féminin.
Existe-il une ou des littératures ? A-t-on le droit de dire « littérature féminine », « littérature africaine », littérature immigrante » ?
La Littérature, la langue, l’écriture, le langage, le style ont connu dès l’origine des modifications des canons. La Grèce Antique, montre que la langue est le lieu de différenciation du barbare et du civilisé, ceci entraîne la consécration du parler grec, car il faut parler ‘hellène’ (hellenistein) et non pas comme les barbares (barbaristein) Au onzième siècle, la langue latine est la langue du clergé, maintenant la distinction et le sacré du latin. Au quinzième siècle Rabelais dans Gargantua ou Pantagruel se propose de donner une image burlesque et pittoresque de l’écriture et de la langue française. Le 17e siècle a connu ses lois sur l’esthétique de la littérature française. Jean-Paul Sartre s’interroge : qu’est-ce que la littérature ? Qu’est-ce qu’écrire ? Pourquoi écrire ? Pour qui écrit-on ? En réponse, la littérature féminine ou les littératures immigrantes témoignent de cette coïncidence de soi à soi. Il s’agit de laisser une trace de soi dans l’écriture.
Ces littératures ont mis dans le discours littéraire, l’histoire des Africains, la voix des femmes, les thématiques des migrants; accordant une importance, non pas seulement à ces thèmes, mais à la valeur littéraire de ces écrits. Almut Nordmann-Seiler dit ceci dans son oeuvre La littérature neoafricaine : « Dans ce livre, nous entendons donc par littérature néo africaine les œuvres littéraires écrites qui reflètent, soit par leur style, soit par leur thématique la civilisation et la culture actuelle de l’Afrique subsaharienne. » Et aussi c’est en ces termes qu’il (Léopold Sédar Senghor) définit la Négritude. « La Négritude c’est l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu’elles s’expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des noirs ». Nous concédons qu’il y a un engagement littéraire dans la littérature africaine, en choisissant de partir de la littérature à l’écriture, avec la citation de Roland Barthes : « … L’écriture est un acte de solidarité historique. Langue et style sont des objets. L’écriture est une fonction : elle est le rapport entre la création et la société, elle est le langage littéraire transformé par sa destination sociale, elle est la forme saisie dans son intention humaine et liée aux grandes crises de l’histoire. » La littérature féminine porte un discours de revendication féminine, un engagement qui peut être social, politique, culturel, idéologique, permettant d’évaluer ou de défendre la condition de la femme.
C’est au nom d’une tradition contre l’oppression que les femmes ont pris acte de ce qui était dit sur la femme. Les femmes ont écrit sur la domination phallocentrique. Mais les femmes écrivains se gardent d’une quelconque récupération féministe. Il s’agit de créer une écriture libre de toutes injonctions. C’est dans la langue, le style, le langage que nous pouvons chercher une singularité de la Littérature, une distinction de la littérature. D’emblée, la langue est un corps, un corpus, qui nous est donné, indépendamment de notre volonté, le dictionnaire existe avec ses mots, dans une époque donnée. Derrida dans l’œuvre « Le monolinguisme de l’autre », dit ceci : « 1- On ne parle jamais qu’une seule langue; 2- On ne parle jamais une seule langue ». La littérature est une et on le voit, car nous sommes prisonniers des conventions, de l’époque, de l’histoire, du corps de la langue, car les signifiants sont arbitraires et existent indépendamment de l’écrivain. Néanmoins la littérature est diverse, car l’idiome de l’écrivain est lié à la destinerrance des envois.
Qu’entendez-vous par nationalisation des littératures existe-t-il une ou des littératures ?
La littérature négro-africaine s’est longtemps contentée de relater la souffrance due aux exactions coloniales. Elle se propose de libérer le noir de l’aliénation coloniale » et c’est ce que nous avons vu plus haut avec la poésie de Négritude, celle de Léon Gontran Damas, qui se veut une arme de combat politique et poétique. La littérature produite est militante. Mais le mouvement de la Négritude a ses défenseurs et ses détracteurs. En Afrique, les détracteurs avancent les arguments sur la liberté e l’écriture. Cette peur de s’enfermer dans les injonctions qui constitue un frein, une main mise sur la créativité, car la création littéraire s’oppose aux idéologies, se donne la liberté, de forger une langue française enrichie par un apport culturel différent. La revendication des nationalisations des Littératures peut s’entendre dans une évolution naturelle des littératures.
L’écrivain en général est le témoin d’une société et d’une époque. Lorsqu’on est un auteur africain venu du Cameroun, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Congo. Lorsqu’on est auteur créole, arabe, malgache…, il ne s’agit pas de véhiculer une logique communautaire ou une approche ethnocentriste, mais de se servir du privilège qu’ils ont de parler à la fois le français et une langue nationale, et donc de pouvoir puiser un geste, un rythme, un mode littéraire nouveau dans le génie de la langue française. Il s’agit de pratiquer une sorte « d’éruption verbale » au sens où la langue et le style d’un auteur peuvent dépasser la superficialité de la langue commune, pour atteindre l’essence profonde d’un style, d’une langue de l’intérieur. Cet arrachement à la langue maternelle produit des textes français, enrichis par la langue vernaculaire. Réné Maran l’avait prédit, en affirmant qu’il ne s’agirait plus de « parler le français petit –nègre, mais parler malinké ou ewondo en Français ».
Cette littérature nationale permet de s’affranchir des injonctions de la Négritude, et de laisser la place à la création littéraire. Nous pouvons souligner que les auteurs africains revendiquent fondamentalement une « identité » d’écriture, celle qui n’est ni africaine ni nationale, mais qui est artistique. Il est fondamental de noter que ces auteurs écrivent dans la langue du colonisateur, souvent parce que leur langue et leur culture leur ont été interdites, mais aussi parce que les langues nationales d’Afrique ne bénéficient pas du même rayonnement au niveau international au même titre que le français ou l’anglais. Il y a certaines exceptions comme Mariama Ba qui a vu son œuvre Une si longue lettre, être traduite en langue nationale. Les lecteurs peuvent l’acheter, l’aimer dans le monde entier, car c’est le contenu qui importe le plus. Néanmoins, elle met en exergue la vérité de la littérature; peu importe la race, la langue, le lieu, géographique d’où l’on parle, la littérature revendique son autonomie.
Quel est le premier livre que vous avez lu et apprécié ?
Les ouvrages qui ont bercé mes premières années sont Ville cruelle de Mongo Beti dans ce livre, l’auteur relate l’itinéraire d’un jeune homme confronté aux injustices coloniales, Leurres et lueurs de Birago Diop, révèle dans son poème l’oralité, la phonologie, le rythme, le son, la sonorité, le frémissement de la langue. Il met ses éléments en parallèle aux corpus de l’Afrique traditionnelle Maimouna d’Abdoulaye Sadji, montre la destinée d’une certaine femme africaine, rurale, traditionnelle face aux réalités du monde contemporain et moderne.
Le langage donne du cri, de la colère, de la tristesse par son corps, son rythme, sa monotonie, sa langueur, sa noirceur. C’est la langue qui devient le lieu de création d’une certaine « production noire » c’est-à-dire que la langue du poète devient le lieu de la mélancolie, des idées noires, de la colère, de l’hostilité.
Votre amour pour la littérature africaine vous vient-il d’un milieu précis ou d’une rencontre précise ?
J’aime la culture orale et au Cameroun dont je suis originaire, la culture est caractérisée par l’oralité. Lors des veillées, des palabres et des fêtes, j’ai écouté les contes, les devinettes et les chants. Lors des mariages ou des baptêmes retentissaient des pas de danse, des tambours, partagés par tous dans un élan communautaire. Au-delà du caractère folklorique, il faut dire que la culture africaine en général et celle du Cameroun en particulier véhicule des enseignements divers. Elle est aussi formatrice.
Qu’avez-vous découvert d’intéressant dans la littérature africaine ?
J’ai découvert dans la littérature africaine que le voyage emporte toujours l’origine avec lui. L’histoire des peuples africains est unique. L’écriture poétique avant les indépendances est marquée par l’originalité de style d’Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor et Léon Gontran Damas. Nous pouvons regarder de très près cette écriture ou cette poésie, faite d’oralité et influencée par les traditions africaines, les tam-tams, les griots, les danses et masques, les rythmes. La rencontre de l’Occident et de l’Afrique est mise en exergue par la littérature africaine.
Comment s’est construite votre relation avec la France ?
Je suis arrivée en France comme étudiante. J’ai mis du temps à porter à terme le travail de thèse, ça n’a été possible que par ma détermination, ma persévérance, par les rencontres, telles que celle de ma Directrice de thèse, Mireille Calle- Gruber, les associations telles que le CISED. J’y suis également arrivée grâce à Dieu, à qui j’exprime ma gratitude. Comme étudiante, j’ai fait face aux conditions de vie difficile Ainsi, j’ai dû exercer de petits boulots d’étudiants parallèlement aux enseignements que je recevais à l’Université. Ceci dans la mesure où je ne disposais pas de bourse d’études. Ce parcours est fondamental. La France est un pays attractif pour divers secteurs. La France offre diverses opportunités.
En littérature, comment parvenez-vous à concilier votre part africaine et votre part française?
Je souhaite reprendre les subtilités de la pensée des auteurs comme Achille Mbembe lorsqu’il dit que « l’identité n’est pas essentielle, nous sommes des passants ». L’identité semble donc se dissoudre dans ce « Tout-monde » pour reprendre le titre de l’un des ouvrages d’Edouard Glissant. Dans ce monde qui n’est qu’un seul, il y a cette volonté pour l’écrivain ou pour les chercheurs de tendre vers l’altérité.
Cela suppose de transcender les réalités « locales », c’est-à-dire celles de son milieu de naissance (ou natal) pour aller à la rencontre de l’autre. Bien évidemment qu’aller à la rencontre de l’autre suppose non pas de perdre complètement son identité, mais de composer avec l’identité de l’autre. Du coup, cela remet en scène la problématique de l’identité « pure ». Le débat sur « l’identité française » mérite à cet effet d’être bien questionné, au-delà des considérations ethnocentristes pour ne pas dire « nationalistes », qui traduiraient que nous retournons à l’ère des « replis sur soi ».
La littérature peut-elle sauver l’Afrique ?
L’esclavage colonial, la domination, la soumission, la violence, la mémoire postcoloniale, les préjugées racistes sont souvent les thèmes qui ont été abordés par différents auteurs tels que Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Jean Paul Sartre. Ce dernier dit dans la Nouvelle poésie nègre et malgache : « C’est aux noirs que ces noirs s’adressent et c’est pour leur parler des noirs; leur poésie n’est ni satirique ni imprécatoire : c’est une prise de conscience ». Toutes ces questions ont souvent été posées par des auteurs africains ou non africains, ceux vivant en Afrique ou hors de l’Afrique. Pour autant, cinquante ans après les décennies d’indépendance, l’Afrique peut –elle se dire émancipée par la littérature? La négritude a-t-elle réussi son pari d’interpréter poétiquement l’Afrique en la changeant politiquement ? L’Afrique centrale est prise en otage de l’extérieur, pour exemple, la conférence de la Baule, l’instauration de la démocratie, a été faite de l’extérieur. Les multinationales aux méthodes répréhensibles, les gouvernements corrompus, les coups d’État, la famine, l’émigration, sévissent encore en Afrique.
On peut élargir le questionnement : Comment ces questions vitales telles la famine, l’émigration illégale massive, le chômage, la corruption, les coups d’État qui sévissent en Afrique sont-elles mises en discours par les écrivains de l’Afrique subsaharienne ? Pourquoi les auteurs qui vivent de leurs œuvres sont parfois à l’extérieur ? Le livre est-il accessible aux populations sub-africaines moyennes ? Sachant que pour avoir accès à la culture par le livre, il faut avoir les moyens intellectuels et financiers qui permettent de lire. Les livres ayant encore un coût élevé, ils sont relégués au second plan par rapport à la radio, à la presse, à la télévision, lesquels sont des organes publics d’information principaux. La culture littéraire est déjà une richesse pour un homme, qui lui permet de lire les livres, les journaux, les idées, les programmes sociaux proposés, ainsi que le cap politique. Analyser, choisir en comparant, tout ceci peut déjà former des hommes libres qui peuvent juger la valeur d’une proposition politique, sociale, économique en Afrique.
Universitaire, auteure, amoureuse des lettres, vous portez un intérêt particulier à la langue française coloniale. Pourquoi cet intérêt ?
La langue française coloniale, porte entre autres, les marques, les traces d’un désir « de briser les murailles de la culture prison » La langue française est certes importante et nécessaire, mais ce recours permanent à celle-ci montre notre dépendance à la France.
Un mot sur l’avenir de la littérature francophone en Afrique ?
Je formule un vœu de Réussites or, il me semble que les défis sont nombreux concernant l’avenir de la littérature francophone en Afrique. Le premier défi à mon avis c’est la « décolonisation » de l’écriture qui travaille les littératures francophones en Afrique. Car plus de cinquante ans après les indépendances, la littérature francophone se pense, s’écrit et se véhicule à travers la langue française. Le défi ici serait donc de sortir de l’écriture de la littérature francophone à partir de la langue française, en privilégiant les langues nationales des pays francophones d’Afrique.
Des auteurs comme Patrice Nganang proposent d’« Écrire sans la France ». Patrice Nganang soutient d’ailleurs qu’« Écrire sans la France, c’est avant tout écrire par-delà la Francophonie ». On peut penser à partir de cette citation que l’universitaire camerounais vivant aux USA suggère de sortir de l’espace de la Francophonie pour investir d’autres espaces, à l’instar de l’espace des pays du Commonwealth. Le deuxième défi c’est celui des thématiques, voire de la nature des sujets abordés dans la littérature francophone en Afrique. En effet, il y a urgence de sortir des sujets éculés liés au passé colonial entre les pays d’Afrique francophone et la France.
La littéraire francophone en Afrique doit s’inscrire dans ce qu’Achille Mbembe appelle le « post-colonialisme ». Le troisième défi c’est celui de la promotion de la littérature francophone en Afrique. Pour ce faire, les États d’Afrique francophone devraient mettre plus de moyens (humains, financiers, matériels et/ou logistiques) et se servir de « nouveaux médias » (notamment les réseaux sociaux numériques) pour que la littérature soit accessible à l’ensemble de la population.
Propos recueillis par Nathasha Pemba, 11 mars 2019.