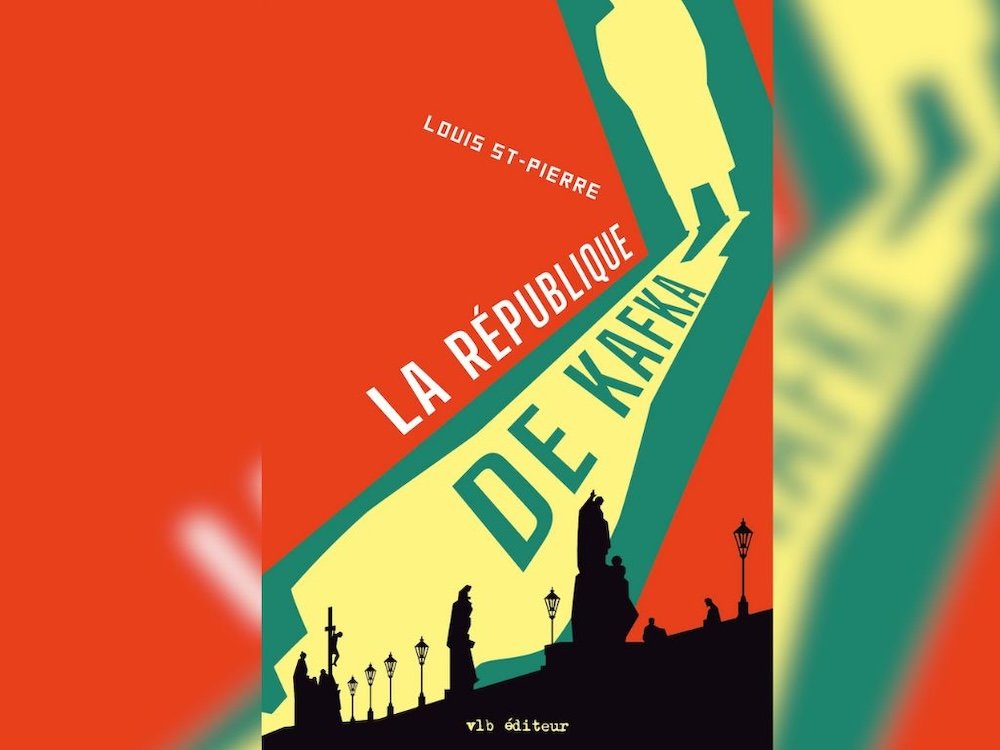Bonjour, Anaïs, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Nous sommes heureux de vous accueillir ici chez nous, au Magazine OU’TAM’SI. Nos lecteurs ont hâte de vous connaître. Qui êtes-vous, Anaïs ?
Je ne suis pas la même qu’avant l’écriture de ce livre, c’est certain. L’identité est une vaste question… Comme je l’écris dans ce livre : « je préfère souvent ne pas me décrire qu’offrir une description périssable et incomplète de moi-même ». Disons que je suis une femme blanche de 35 ans qui aime écrire, danser et qui réfléchit beaucoup trop.

Nous allons commencer par le titre de votre livre. Il me paraît un peu provocateur. Peut-être que je me trompe. Deux mots ont retenu mon attention : Du coup (comme expression) et France… On dit souvent qu’on reconnaît un Français au Québec à sa capacité à utiliser régulièrement les expressions comme Du Coup ou bien pas de souci. Est-ce vrai ?
J’ai mis du temps à prendre conscience que ces expressions sont typiquement françaises et que très peu de Québécois.es — à part peut-être celles et ceux resté.e.s trop longtemps à notre contact — les utilisent. C’est une collègue de travail qui un jour me l’a fait remarquer. Oui, je pense que ces expressions nous trahissent, mais je crois aussi que plein d’autres facteurs permettent de reconnaître un.e Français.e parmi des Québécois.es : l’accent, la façon d’interagir avec l’autre… La culture de manière générale. Cela dépend de beaucoup de choses : parle-t-on d’une personne qui vient d’arriver au Québec ou qui y est installée depuis une dizaine d’années comme moi ?
Je me souviens de ce jour où je discutais avec une personne malentendante, elle lisait sur mes lèvres pour me comprendre, mais était capable de parler. Au bout d’un moment, cette personne m’arrête et me demande : tu es Française ? À la façon de bouger mes lèvres, d’articuler mes mots, sans même entendre mon accent et mes « du coup » elle a pu me démasquer ! Je n’y croyais pas.
Pour revenir à votre titre, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons de ce choix ?
Trouver des titres à mes textes est toujours un exercice difficile pour moi. Si aucun titre ne me vient en tout début de démarche, cela se complique par la suite pour parvenir à « étiqueter » un travail de dizaines ou centaines de pages à travers quelques mots. Ce titre n’est pas le titre d’origine, à vrai dire il a changé deux ou trois fois. Lorsque je suis arrivée à l’étape finale de publication, nous en avons discuté avec ma maison d’édition. J’ai dû me poser des questions auxquelles je n’avais pas forcément réfléchi, car j’étais dans une démarche très intime : qu’est-ce que je souhaite que les gens retiennent de mon livre ? Qu’est-ce que je veux qu’il suscite comme réaction ? Comment puis-je, avec ce titre, toucher autant les personnes québécoises que françaises ? Je savais que le « Du coup » parlerait autant aux premières qu’aux Français.es vivant au Québec. Quant au verbe « fuir », il vient d’un ouvrage qui m’a inspiré tout au long de l’écriture (je l’explique dans le livre) : Éloge de la fuite d’Henri Laborit. Il explique que la fuite n’est pas forcément un acte de lâcheté.
Lorsque je vous lis, je constate que vous êtes vous-même issue d’une famille d’immigrés : L’Italie et la Russie. Des parents immigrés d’une certaine époque où partir était essentiel… VITAL. Pensez-vous que les raisons d’immigration de cette époque de vos parents sont les mêmes que celles des gens d’aujourd’hui ?
Les raisons qui m’ont poussée à partir sont clairement très différentes de celles qui ont forcé mes arrière-grands-pères russes et italiens à quitter leurs pays. C’était une autre époque, une question de vie ou de mort en effet. Dans ce contexte, les raisons sont différentes, car en France, ma vie n’était pas en danger. Mais tout le monde n’a pas le même privilège que moi, celui de partir par choix et non par contrainte. Beaucoup de personnes doivent encore quitter leur pays aujourd’hui pour les mêmes raisons que mes arrière-grands-pères il y a près de 100 ans. Avoir le choix est un immense privilège dont je n’avais pas pleinement conscience avant de me lancer dans l’écriture de ce livre.
En contexte de globalisation, a-t-on encore besoin d’utiliser le mot immigration ? Ne devrait-on pas parler simplement de déplacement ou de voyage, puisque nous sommes tous citoyens du monde ?
Je ne sais pas, il me semblerait étrange d’utiliser le mot « voyage » autant pour parler d’une personne quittant son pays, car elle est menacée de mort par son propre gouvernement que de quelqu’un partant pour une semaine dans un hôtel à Cuba par exemple. Le sens des mots évolue en même temps que le monde, et je crois que les mots « justes » n’existent pas. Mais puisque nous parlons une langue dite « vivante » nous devons remettre en question ce langage. Peut-être en effet que le mot « immigration » ne sera plus ou n’est déjà plus pertinent pour certains… À nous de réfléchir à la façon de le transformer. La cofondatrice de la compagnie de théâtre autochtone dans laquelle j’ai eu la chance de travailler m’a écrit après avoir lu mon livre, elle m’a dit cette phrase poétique et pleine de sagesse : « ce n’est pas parce que les mots justes n’existent pas qu’on ne peut pas les chercher ».
La citoyenneté mondiale, y croyez-vous ?
Je dois avouer que je ne suis pas très familière avec ce concept. De ma compréhension, il s’agit d’une manière de percevoir la citoyenneté au-delà d’un attachement à un territoire, de mettre l’emphase sur ce qui nous rassemble en tant qu’humain et non sur ce qui nous divise en tant qu’habitant d’un certain pays ? J’imagine que cela peut-être un idéal à atteindre, mais que nous en sommes encore bien loin.
Chère Anaïs, si vous deviez expliquer à des jeunes du secondaire la différence entre expatrié et immigrant, comment le diriez-vous, en termes simples ?

Pour moi (et le sens des mots est différent pour chacun.e d’entre nous), les deux termes signifient la même chose. La personne expatriée est celle qui a quitté son pays. La personne immigrante, elle, s’est installée dans un autre pays que le sien. Donc en théorie l’expatrié.e est un.e immigrant.e et l’immigrant.e est un.e expatrié.e. Sauf que dans la vie de tous les jours, nous avons davantage tendance à utiliser le mot « expatrié.e » pour parler de personnes comme moi qui ont quitté un pays de façon volontaire et le mot « immigrant.e » pour celles qui ont été contraintes de le quitter. À l’heure actuelle, dans l’usage que nous faisons de ces mots, la différence se trouve juste selon moi dans les raisons qui poussent à partir.
Il y a cette phrase de votre livre… à la page 13 : « J’ai l’intime conviction que tous les Français de ma génération, quels que soient les arguments qu’ils avancent, sont aussi dans la fuite. Certains parlent de l’envie de voyager et de découvrir le monde. Je pense que c’est secondaire ». Est-ce un constat ou une conviction ? Dans les deux cas, que fuient-ils selon vous ?
C’est plus une conviction. Je n’ai mené aucune enquête légitime pour pouvoir affirmer que c’est un fait. Comme je l’explique dans le livre, même si certain.e.s affirment partir pour « découvrir le monde », on peut se demander si cette envie de découverte n’est pas aussi d’une certaine manière une fuite du connu. On fuit ce que l’on connaît, un quotidien : un confort pour certain.e.s ou un malaise pour d’autres. Une société morose, un système politique désuet et impuissant, le chômage, le manque de perspectives… Même si ce n’est pas la principale raison de notre départ, on a tous quelque chose à reprocher à la France, une bonne raison de la fuir.
En France, on parle beaucoup d’intégration. Ici au Canada, on parle de multiculturalisme ou d’interculturalité, comment-vivez-vous cela ? Peut-on coexister sans intégration ? Une intégration sans assimilation est-elle envisageable ?
Il faudrait que j’écrive un deuxième essai pour répondre à cette question ! Blague à part, la France et le Canada sont dans des situations historiques, économiques, culturelles… très différentes. Leur situation géographique et leur rapport aux frontières ne sont pas comparables non plus. Par conséquent, les mots que les deux pays utilisent ne sont pas les mêmes. Ce que l’on nomme « intégration » peut vite se transformer en assimilation, à quel moment s’arrête l’un et commence l’autre ? Difficile à dire selon moi. Alors que dans le multiculturalisme et l’interculturalité on ressent a priori une plus grande volonté de coexister, de faire cohabiter nos différences. Ça me parle. Mais parfois, je me demande si utiliser ces mots n’est pas juste une façon politiquement correcte pour le Canada de parler en réalité d’intégration voire d’assimilation. J’ai le sentiment que ce n’est pas parce que l’on parle davantage de multiculturalisme au Canada qu’il y a moins de xénophobie que de racisme. Essayer de trouver les mots « justes » est une chose, faire en sorte que ces mots reflètent une réalité et non un simple désir en est une autre.
Rencontrez-vous des problèmes identitaires ?
Après plusieurs années à vivre en dehors de mon pays, j’ai commencé à me poser des questions identitaires que je ne me posais pas en France, car je n’étais pas dans une situation minoritaire. J’étais « la norme » et je ne me posais pas de questions. Je ne dirai pas que je rencontre des problèmes identitaires, mais disons que c’est une question qui m’intéresse, elle est à la fois complexe, personnelle, universelle et tellement mouvante. Ce n’est pas un problème à proprement parler, mais par exemple, je trouve cela drôle de voir que les gens en France m’appellent « La Canadienne » alors qu’ici au Québec je suis toujours la Française. C’est toujours tentant de vouloir faire entrer les gens dans des cases, mais au final ce qui compte est de savoir nous-mêmes qui nous sommes.
Dans votre livre, vous mentionnez qu’à votre arrivée, vous vous sentiez bien en compagnie d’autres immigrants. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Votre perception du citoyen québécois a-t-elle évolué ?
Je me sentais bien en compagnie d’autres immigrant.e.s, mais surtout j’avais plus de faciliter à me lier d’amitiés avec ces personnes, car nous avions un point commun, celui de ne pas être « chez nous ». Je pense que c’est toujours le cas aujourd’hui. La connexion se fait plus facilement avec une personne vivant des enjeux similaires aux nôtres, ce n’est pas toujours un processus conscient. Quant à ma perception des Québécois.es, bien sûr qu’elle a évolué : je suis arrivée ici avec ma valise et mon ignorance, j’ai fait beaucoup de chemin depuis !
Un petit tour dans votre bibliothèque personnelle… Quels sont les dix livres avec lesquels vous passerez une nuit ?
Celui qui m’a accompagnée pendant l’écriture de mon livre sans hésiter : Éloge de la fuite d’Henri Laborit. Sinon, en ce moment je dirais dans un ordre aléatoire :
- Réparer les vivants de Maylis de Kerangal
- La vie devant soi de Romain Gary
- Le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché
- Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain
- L’insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera
- Uiesh — Quelque part de Joséphine Bacon
- Les vaisseaux du cœur de Benoîte Groult
- Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir
- Une chambre à soi de Virginia Woolf
Quel est selon vous l’avenir de la langue française dans le monde ?
Je crois que je ne m’intéresse pas suffisamment à cette question pour pouvoir y apporter une réponse pertinente. Je sais qu’au Québec beaucoup de personnes s’inquiètent pour l’avenir de la langue française, ce qui est compréhensible au regard de la situation géographique et historique de la province. De mon point de vue non-expert (peut-être un peu naïf) je ne sens pas que ma langue soit en danger.
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
Oui, je suis en train d’écrire mon premier roman. Un processus très différent de celui par lequel je suis passée pour mon premier livre, plus léger aussi et fortement inspiré de mon vécu.
Merci Anaïs.
Merci à vous !