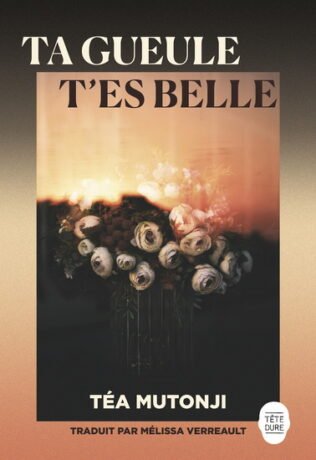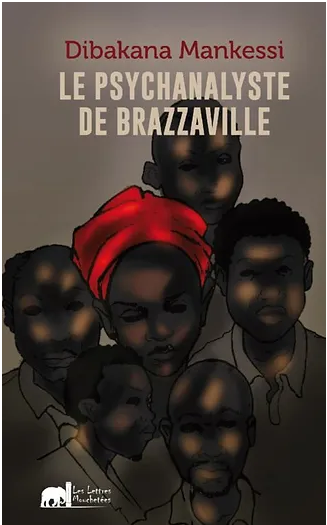Analyse littéraire
Nos rédacteurs chevronnés décortiquent, décomposent, passent les ouvrages littéraires francophones au peigne fin pour observer le sens, la structure et la portée d’une parution récente ou vous font redécouvrir un grand classique.
Honneur à Josip Novakovitch, Café Sarajevo, Montréal, Éditions Hashtag, 2020.
C’
est une merveille littéraire que viennent de me faire découvrir les Éditions Hashtag, à travers Café Sarajevo. Josip Novakovich est un écrivain canadien, d’origine croate qui a, à son actif, plusieurs publications. Après avoir lu ce recueil, je reste convaincue que le mouvement de la traduction de ses œuvres majeures en français amorcé il y a quelques années déjà poursuivra son chemin.
Les récits qui encadrent Café Sarajevo sont des récits de l’exil, de questionnement, d’hésitation, d’amitié, de retrouvailles. Je me résume en disant que ce sont des récits de la rencontre, parce que toute transcendance de soi est toujours à la faveur d’une rencontre, de tout type de rencontre. Et dans le recueil, il s’agit précisément de cela.
Dans la nouvelle qui donne au recueil son titre, la question de l’altérité au cœur de la rencontre occupe une place essentielle. Il y a, par exemple, la rencontre avec Sobaka, le chat, qui épouse toutes les couleurs d’une rencontre fraternelle. Les personnages de différentes nouvelles sont des gens qui considèrent les autres, des gens qui pensent que la vie n’est possible qu’avec les autres, des gens faits de désirs et de certitudes.
L’histoire autour du Café Sarajevo qui a fermé ses portes est à la mesure du contexte actuel où la pandémie oblige certains propriétaires de Cafés à fermer; fermer, parce que ces lieux ont perdu leurs vocations premières : la rencontre. Un Café est d’abord un lieu de rencontre et si la pandémie oblige à la société une certaine forme d’isolement, le Café comme lieu de vivre-ensemble n’a vraiment plus sa raison d’être. Toutefois, la spécificité même de ce Café qui a fermé ses portes, c’est d’avoir été un lieu de ressourcements. un lieu de ré-enracinement, un lieu de prise en charge des souches diverses. C’est tout le regret, il me semble, du narrateur de cette nouvelle. Il déplore, par ailleurs, une tendance commune aux différentes Amériques côtoyées : tuer l’ancien pour laisser place au nouveau. Il évoque le souvenir de ce Café qui l’avait influencé dans le choix de son logement. Il parle d’une boulangerie appelée Balkan et d’un autre Café, Adria. Un Café qui lui rappelle ses origines. Il évoque sa rencontre avec les propriétaires de ce Café, leurs origines. Des origines qui le ramènent à sa propre histoire, l’histoire des origines ethniques de l’ex-Yougoslavie. Le narrateur se remémore la présence des membres de sa communauté dans la ville de Montréal. Il évoque le communisme. l’histoire, comme pour signifier que le déracinement n’est pas pour l’humain. Personne n’oublie jamais d’où elle vient, peu importe la force des politiques d’intégration, de son pays d’accueil.
L’évocation des origines par le narrateur porte une dimension intime très essentielle, car même s’il soulève certains revers, il ne tombe jamais dans le pathos de l’immigrant aigri, alors que Branko, ancien chanteur d’Opéra à Sarajevo, qu’il rencontre à plusieurs reprises peut lui en donner l’occasion. La discussion qu’ils entament est intéressante, car tous les deux cherchent à se partager leurs origines, même s’ils sont conscients qu’ils sont tous deux originaires de l’Europe de l’Est.
Chez Branko, l’exil est vécu comme une cassure, une mort, une blessure. Il évoque le souvenir de la guerre qui l’a emprisonné (dans tous les sens de l’expression). Il n’a pas complètement fait son deuil, parce que même s’il est heureux de se retrouver sur une terre dite de liberté et de paix, il pleure encore ses origines malgré leurs imperfections. Il lui reste encore quelques bribes de son ancienne vie :
J’évite de faire appel à lui de façon trop régulière. Des fois qu’il prenne ça pour une invitation… Je n’ai pas de temps à consacrer aux garçons. Ils ne m’intéressent pas. Quand il est question de femmes : tous coupables! Il n’y a qu’à voir mon père dont on raconte qu’il a violé ma mère, ou le mari de Klara qui est un monstre.
Sangs mêlés est un texte accessible certes, mais qui pourrait susciter des questionnements quant à son contenu. Ce qui est, à mon sens, un gage de réussite, puisqu’un roman est celui qui questionne avant tout.
Ce roman met en avant deux personnages principaux : Sali et Klara. Sali, Sénégalaise, est la fille adoptive de Klara, Néerlandaise. La seconde est psychologue et la première, à l’instar de la première, s’initie à la psychologie. Cependant Sali est une observatrice et elle pense que la vie de sa mère blanche devrait être mise par écrit. Elle ne se doute pas que, dans cette initiative, Klara est peut-être sa véritable première cliente, car en entreprenant la rédaction de cette biographie, c’est vers une catharsis qu’elle mène Klara qui va entrer dans toute sa vie pour pouvoir certainement se retrouver et reprendre la vie, après la trahison de son homme, Jérémie Sain-Dior.
On va dire que ce roman est un récit dans un roman, un voyage au cœur d’une intimité, mais aussi au cœur du monde, une errance, des retrouvailles, un lieu.
Sangs mêlés est-il plus pertinemment écrit? En effet, il faut à Sali du courage pour entrer dans cette histoire qui est aussi la sienne puisque dans la vie de Klara, il y a une part d’elle-même. Découvrir l’histoire de Klara, c’est découvrir ses propres origines. C’est une des forces de la liberté d’esprit, d’écriture et de mobilité de Fanny Campan.
Sangs mêlés est le roman de la femme. Je ne le dis pas parce que les hommes n’y sont pas peints comme des saints, mais parce qu’à travers l’histoire de Klara, il y a comme un passage qui se fait, une sorte d’initiation à la vie. Entre colère et déception, Klara veut transmettre à Sali une conviction : la capacité qu’elle possède de se prendre en charge sans dépendre d’un homme.
(…) Je ne peux rester tranquille pendant longtemps, j’ai été enfermé si longtemps pendant le siège à Sarajevo que maintenant je dois déambuler partout. J’ai peur d’être pris au piège.
Malgré la trahison de ses origines, qui lui ont fait endurer une guerre qui l’a rendu fou, il n’oublie pas qu’une partie, voire l’essentiel de sa vie s’y trouve. Obligé de se soumettre aux jugements et aux verdicts des personnes de sa terre d’accueil, il pense néanmoins que ce qu’il vit ou a vécu est injuste :
Je suis arrivé ici comme exilé et invalide de guerre. Le trouble de stress post-traumatique, qu’on l’appelle ici. À mon avis, c’est pas une question de trouble. Quand on vit ce que j’ai vécu, on devient fou, pas troublé. Cinquante grenades sont tombés dans mon appartement, à différentes occasions, ce qui m’a fait passer des semaines au sous-sol, dans le noir.
Café Sarajevo souligne le caractère à la fois éphémère et nécessaire de la vie, les difficultés et les cicatrices de guerre, des lieux communs pour tous les humains. On vit parfois dans un conditionnement libre alors qu’au fond, on reste emprisonné comme l’est Branko qui, tout en vivant un drame personnel, reste ancré dans une origine et tente, malgré tout de quêter sa liberté tout en étant soumis à la condition humaine.
Ce regard sur les origines et les souvenirs de l’exil me paraît nécessaire pour comprendre le recueil de nouvelles de Josip Novakovich. On ne peut pas le comprendre hors du contexte de l’exil toujours en tension entre le lieu des origines et la terre d’accueil, parfois marqués par l’idée de retour. C’est l’existence de tous les personnages du recueil, même lorsque ces personnages sont des animaux : trouvailles, retour, retrouvailles.
Dans la nouvelle intitulée « Un chat appelé Sobaka », le narrateur évoque les réalités russes de la gestion de l’animal, le chat notamment. Un chat abandonné dans la rue est recueilli par Éva et son père qui réfléchissent sérieusement sur la possibilité de lui donner un toit, de lui donner une identité, une existence. Cependant, à travers toute l’histoire de la misère de ce chat, il y a l’histoire de la misère de certains chats en Russie. D’un point de vue symbolique, ces chats peuvent aussi représenter des humains, des humains que l’on rejette parce qu’ils sont étrangers, différents ou parce qu’ils constituent des charges supplémentaires pour la nation.
Ce que je trouve fascinant dans ce recueil, bien au-delà du style que j’apprécie hautement, c’est que Josip Novakovich veut traduire la réalité humaine telle qu’elle se vit un peu partout dans le monde, notamment en contexte d’exil. Il décrit la rencontre, le souvenir, les aises de la vie, mais tente de maintenir le côté esthétique et éthique de la rencontre. Il nous présente parfois un individu libre, parfois un individu craintif ou encore une famille normale où tout n’est pas toujours idyllique. C’est ce qu’il peint merveilleusement comme dans la nouvelle « Barre transversale » qui est l’une de mes nouvelles préférées. Josip y brille de son art. Il décrit cet épisode sportif avec la passion d’un féru de football. Il décrit la hargne et l’excitation parfois malsaine des admirateurs lorsque leur équipe est vaincue. Il décrit aussi l’insécurité des stades. Cette nouvelle est aussi le tableau de la représentation du spectateur sportif lorsqu’il est assis dans les gradins : Joie, manque de jugement, suivisme maladif et folie.
Les vies des personnages qui parcourent ces nouvelles — vie simple, vie rude, vie fougueuse, vie fraternelle — incarnent l’étrangeté même.
D’une certaine manière, tous les humains sont des exilés. La simplicité des attitudes, parfois banales, retrouve sous la plume de Josip une vie, une histoire, un lieu, une densité, une aspiration. Les personnages sont en mouvement.
J’ai relu plusieurs fois la nouvelle : Réservation d’avance. Elle est, de mon point de vue, celle qui obéit le plus fidèlement aux règles de la nouvelle. Elle est traversée par une chute pérenne, présente, mais curieusement évanescente, car au moment où l’on veut la saisir, elle s’éclipse. En lisant cette nouvelle, j’ai songé à Tom Barbash. La force mêlée à la simplicité des nouvelles ne pouvait pas me conduire ailleurs. Il en est de même pour la dérision, l’exigence délicate et innée, la présence de l’humour discret, l’émotion, l’espoir. Ces propriétés m’ont fait songer à Kafka. Pourtant, il s’agit de Josip Novakovich avec son style et son authenticité, qui évoque les durs moments de la guerre et les habitus de la vie en prenant soin d’éluder les artifices de l’histoire comme représentation.
En somme, je dirais qu’en lissant Novakovitch, le sourire est présent et l’interrogation est immanente. S’il est vrai que son œuvre est une fiction, le regard de Novakovitch est celui d’un sociologue qui ne change rien du cours de l’histoire ni de celle de la réalité de la vie, mais qui invite à un questionnement, à un engagement. Saint Augustin a écrit que pour trouver Dieu, il faut l’avoir perdu, et c’est au-dedans de soi qu’on le trouve. Peut-on dire la même chose pour l’exilé ?