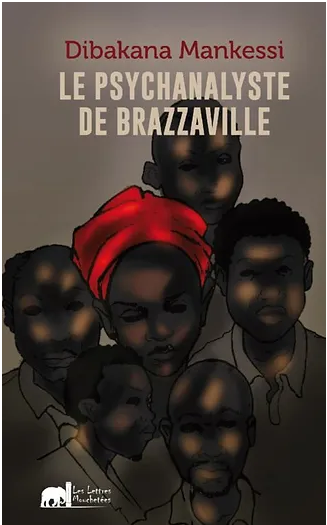On ne peut pas être écrivain ou écrivaine sans remettre en question le socle sur lequel on est debout. Pourriez-vous le faire, vous ? Il faudrait faire face à vos proches qui vous regarderaient de travers. Voilà le prix à payer. Mais après, on peut écrire sur les travers des siens sans gêne. On est libre.
Didier Leclair est un écrivain canadien d’origine rwandaise, né à Montréal en 1967. De son vrai nom Didier Kabagema, il a vécu dans plusieurs pays africains (République du Congo, Togo, Gabon, Bénin notamment) avant de rejoindre à nouveau le Canada pour ses études universitaires. Il étudie les Lettres à l’Université Laurentienne et au Collège universitaire Glendon et s’installe définitivement à Toronto dès la fin des années 1980. Toronto devient ainsi sa ville de cœur, à laquelle il consacre son premier livre intitulé Toronto, je t’aime paru en 2000. La version anglaise de ce livre vient d’être publiée, et il vient également d’être réédité par les Éditions Terre d’Accueil. Par ailleurs, auteur de plusieurs livres, Didier Leclair a remporté le Prix Trillium en 2001 et le Prix Christine-Dimitri-Van-Saanen en 2016.
Bonjour Didier Leclair. Vous êtes né au Canada des parents rwandais, et vous passez votre enfance et votre adolescence dans quelques pays africains, avant de rejoindre à nouveau votre pays de naissance. Pouvez-vous nous éclairer sur ces déplacements incessants qui ont marqué votre jeunesse, et partant votre vie ?
Bonjour, oui, bien sûr. J’ai eu un père médecin. Il travaillait pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Il était affecté à différents postes en Afrique. C’est ainsi que je vécus au Congo-Brazza, au Togo, Gabon, Côte d’Ivoire et Bénin. Ces séjours de plusieurs années m’ont marqué. Cela m’a permis d’aiguiser mon sens de l’observation, de développer un sens concret du panafricanisme. Mon enfance et mon adolescence ont été imprégnées de deux mondes. Celui de mes camarades de quartiers africains et celui de mon lycée au système éducatif français.
Personnellement, comment définissez-vous votre identité ?
Je suis Rwandais. Je suis également Canadien et plus précisément Franco-Ontarien. J’ai été élevé par deux parents rwandais qui m’ont transmis leur culture. Cela dit, je suis aussi Canadien, né sur cette terre. C’est donc une binationalité.
Quel tableau dressez-vous de l’intégration socioculturelle au Canada ?
Je suis toujours optimiste. On progresse. Que nous puissions avoir la possibilité de nous exprimer dans un magazine comme le vôtre et que mon éditrice soit une jeune femme canadienne d’origine camerounaise sont des progrès indéniables. Mais ces progrès sont menacés par des compressions, coupures de financement et autres tracasseries de la sorte. Il faut donc essayer de bâtir des ponts avec des organismes de la diaspora noire, trouver des bases plus solides, ne pas dépendre de bureaucrates à Ottawa, Toronto ou Québec qui peuvent d’un coup de stylo nous priver de notre apport à la culture canadienne et universelle en tant que Noirs.
À travers votre expérience, quelle place donnez-vous au respect et à l’acceptation de l’étranger au Canada ?
L’étranger est accepté au Canada par nécessité. Les Canadiens de longue date (ils se disent de souche, mais leurs parents ou aïeuls ont immigré comme nous) ne font plus beaucoup d’enfants. Par conséquent, le Canada n’a pas le choix. Il doit faire venir des immigrants. Au-delà de cette nécessité, le Canada est serviable, compréhensif avec les immigrants. Nous obtenons de l’aide et il faut remercier les services offerts gratuitement aux nouveaux arrivants. Là où ça se complique, c’est dans la reconnaissance des diplômes. Le Canada reste fermé et offre peu d’opportunités pour les professions libérales. Il y a aussi énormément de violence policière à l’endroit des minorités que le Canada ignore. Les Premières Nations et les Noirs sont les plus nombreux en pourcentage dans les prisons canadiennes. Donc, le tableau n’est pas rose.
La 10e édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone qui se tient chaque année au mois de novembre, au Canada, vient de s’achever. Quelle est selon vous l’importance de cet événement qui s’est déroulé cette année sous le thème : « Nos traditions et notre avenir » ?
Cet événement est très important puisque le Canada est un pays d’immigration. Nous devons remercier ce pays pour l’effort effectué dans l’accueil et montrer du doigt ce qu’il reste à améliorer. Cet événement permet de le faire.
Comment s’est fait le passage de Didier Kabagema à Didier Leclair ? Une manière de ne pas s’assumer ?
Au contraire, ce passage est une manière de s’assumer. Il fallait déclarer mon indépendance vis-à-vis de tout, même de mes racines. On ne peut pas être écrivain ou écrivaine sans remettre en question le socle sur lequel on est debout. Pourriez-vous le faire, vous ? Il faudrait faire face à vos proches qui vous regarderaient de travers. Voilà le prix à payer. Mais après, on peut écrire sur les travers des siens sans gêne. On est libre. Ce que je savais depuis mon enfance de Rwandais loin de sa patrie pour cause de génocide est qu’on ne fuit pas ses origines. C’est impossible. Même de nombreux Canadiens aiment rappeler qu’ils sont d’origine ukrainienne, même après trois ou quatre générations. Donc, je n’avais aucune inquiétude en ce qui concerne ce nom de plume à consonance francophone. Je reste culturellement Rwandais, comme Romain Gary restait Russe de culture juive.

Votre premier livre intitulé Toronto, je t’aime (Éditions Vermillon, 2000) marque un certain attachement à votre actuelle ville de résidence : Toronto. C’est avec ce roman que vous remportez le Prix Trillium en 2001. Quelles sont les motivations qui ont fait sourdre l’écriture de ce texte ?
Je suis né avec l’envie d’écrire. J’écrivais des poèmes dès le début de l’adolescence et je savais que je voulais être écrivain. Mes copains me rappellent souvent qu’ils savaient que j’allais écrire. Je leur montrais des textes à 13 ou 14 ans. Pour « Toronto, je t’aime », il est question d’une rencontre entre une ville multiculturelle et moi, l’écrivain qui a grandi dans plusieurs pays. J’ai atterri dans une cité qui me ressemble. Je fais dire à mon narrateur qu’on ne naît que deux fois. En effet, il y a le pays imposé par les circonstances et il y a le pays choisi. Donc, je me suis assis devant une machine à écrire et j’ai tenté de mettre en mots ce qui m’habitait. Je n’ai jamais eu à réécrire la première phrase du roman. Elle est sortie toute seule.
Que vouliez-vous montrer à travers l’histoire de Raymond qui quitte le Bénin pour Toronto avec plein de rêves dans la tête ?
Je montre une ville vue par des yeux neufs. J’essaye de donner au lecteur, l’aspect mystique que revêt cette cité. Ce n’est pas la plus belle ville du Canada. Les gens sont étonnés quand je le dis. Pourtant, on peut aimer une femme ou un homme qui n’est ni la plus beau ni le plus beau. Montréal est plus attrayante dans l’apparence, même si Toronto fait de beaux efforts. Elle est très chère aussi et son système de transport reste difficile. Mais c’est à Toronto que je croise des gens qui me ressemblent, qui ne me demandent pas d’où je viens à chaque conversation et c’est ici que les accents n’ont plus beaucoup d’importance puisqu’il y en a de partout. Je me sens accepté. Sa mystique vient de sa capacité d’acceptation plus grande que dans d’autres métropoles.
Quel est l’intérêt de faire rééditer ce livre, plus de vingt ans après sa publication ?
Ce roman est très moderne. C’est un cri primal pour choisir une seconde naissance, celle qu’un individu choisit. Aujourd’hui, les déplacements des populations sont constants et « Toronto, je t’aime » illustre le sentiment de renaissance des Torontois venus d’ailleurs. Il y a aussi la question des relations complexes entre les Noirs d’Afrique et les afrodescendants. Il y a le contentieux de l’esclavage qui est un sujet toujours d’actualité. Il faut en discuter si un jour nous souhaitons construire un panafricanisme rayonnant.
Il y a des échecs, mais j’estime qu’il faut voir cet échec comme un nouveau défi. Savez-vous que personne, aucun auteur ou auteure de race noire n’a reçu le Prix du Gouverneur général depuis sa création ? C’est aussi ça, ce pays qui est le mien. Un chapelet d’échecs qu’il faut vaincre.
Avec votre deuxième roman, Ce pays qui est le mien, publié en 2003, vous êtes finaliste du Prix littéraire du Gouverneur général 2004. Il exprime également la désillusion du pays d’accueil. Parlez-nous-en, s’il vous plaît.
À mon avis, il n’y a pas de désillusion. Il y a du découragement, car mon personnage principal était médecin dans son pays d’origine et il conduit un taxi dans les rues de Toronto. Il y a énormément de frustration et cela provoque notamment de la violence conjugale. Ce sont les réalités de la vie de nombreux immigrants. Mais mon personnage persévère et il réussit à faire la paix avec son épouse et ensemble, ils se promettent d’aborder la vie canadienne avec un recul et une solidarité de couple. Je vous ai dit, je suis optimiste. Je ne crois pas à la défaite. Il y a des échecs, mais j’estime qu’il faut voir cet échec comme un nouveau défi. Savez-vous que personne, aucun auteur ou auteure de race noire n’a reçu le Prix du Gouverneur général depuis sa création ? C’est aussi ça, ce pays qui est le mien. Un chapelet d’échecs qu’il faut vaincre.
Vous vous êtes penché sur l’immigration clandestine dans Un passage vers l’Occident que vous publiez en 2007. Au centre de texte, une jeune femme, Angélique, fuit la pauvreté de son Congo natal pour aller en Occident. Pourquoi le choix d’une femme, du Congo, et de l’immigration clandestine ?
C’est un sujet d’actualité. Combien de fois parle-t-on des clandestins qui tentent de fuir la misère aux nouvelles ? Le Congo parce que c’est une culture que je connais assez bien. L’idée de mettre une femme en scène est un défi que je me suis lancé. Je voulais voir si je me sentirais à l’aise avec un personnage féminin comme personnage principal et ce fut le cas.
En 2014, vous publiez un roman qui, pour une première fois, parle de votre Rwanda d’origine. Un ancien d’Afrique : les chiens de Kigali évoque notamment le génocide rwandais qui a eu lieu dix ans avant sa publication. Comment avez-vous vécu ce triste événement ?
C’est un événement transformateur dans la vie de toute personne qui est liée de près à ce pays. J’ai parlé du Rwanda afin de commencer à mettre des mots sur l’horreur qui a emporté des membres de ma famille élargie et de nombreux inconnus qui n’avaient rien demandé. Certes, je n’y étais pas, mes parents non plus, cela dit la raison de mon exil prit tout son sens avec ce génocide. Ce sont mes parents qui avaient eu raison de ne pas y être retournés.
Est-ce à cause de ce génocide que vous semblez assez distant du Rwanda et que vous n’y avez jamais mis pied ?
J’y ai mis pied récemment. J’y étais au printemps 2022. C’était la première fois que j’y allais. Je ne suis pas « distant » du Rwanda. C’est le Rwanda qui fut distant de moi. Je n’ai jamais demandé à partir. Des hommes et des femmes mal intentionnés décidèrent de faire de moi un apatride. Ce n’est pas parce qu’on court vers ce qu’on a perdu qu’on le retrouve plus rapidement. Mes cousins qui y sont ressemblent encore à des gens venus d’ailleurs. Voilà, je ne vois pas l’exil comme les autres. Vous, vous voyez le pays comme neutre. Or le pays, ce sont des gens. Ce n’est pas une entité vide. Vu qu’on m’a chassé, je rentre quand je le souhaite et je prends mon temps. Je suis différent. C’est peut-être pour ça que je suis écrivain.

Comment expliquez-vous la prééminence du thème de l’immigration dans vos livres ?
J’ai écrit officiellement neuf romans. (Il y en a plus dans mes tiroirs). 3 sont sur l’immigration. C’est une étiquette qu’on me colle. Je n’ai rien contre l’idée de voir mon œuvre comme celle sur l’immigration. Toutefois, j’ai écrit sur le nord du Canada (Le soixantième parallèle), sur les Franco-Ontariens (Le complexe de Trafalgar), sur le jazz et l’amour (Pour l’amour de Dimitri et le bonheur est un parfum sans nom), sur la vieillesse et ses droits (Le vieil homme sans voix).
Votre dernier roman, Le vieil homme sans voix, paru en 2019, suscite un profond questionnement sur le crépuscule de la vie de l’Homme. Le protagoniste, Wes, âgé de 80 ans, est un ancien coureur de jupons à la richesse immense, qui a perdu la parole et vit dans une maison de retraite… Quelle est selon vous la plus grande leçon à tirer de ce livre ?
Je vois ce que vous voulez dire, mais je voudrais quand même préciser que je n’écris pas pour donner des leçons. J’écris pour faire réfléchir. Selon moi, Wes voudrait qu’on lui donne une autre chance pour corriger ses torts, son égoïsme entre autres. Mais il faut voir que tous les vieux dans ce roman veulent être encore considérés, capables d’aimer, de ne plus être perçus comme incapables de participer à la vie moderne à leur façon. Ici, en Occident, on tente d’oublier les personnes d’âge mûr. Heureusement, ils s’organisent et ne se laissent pas tous faire.
Quelle est la place qu’occupe l’écriture dans votre vie ?
L’écriture est ma vie. Je suis habité par ça. Ce qui est bien est que je n’ai pas besoin de sacrifier quoique ce soit pour l’écriture. Ce n’est pas comme les autres arts, la musique ou peut-être la danse. Je peux écrire n’importe où et je reste auprès des gens qui m’aiment et que j’aime.
Didier, pourquoi aimez-vous autant le jazz ?
C’est tout d’abord une musique inventée par les miens. C’est l’invention des Noirs et leur esthétique est la mienne. C’est aussi un art né dans la clandestinité, sans l’autorisation des pouvoirs en place. Les bars et les maisons de passe sont les lieux de sa naissance. Ceci le rend rebelle. On ne peut pas démoder le jazz. On le critique, on s’en moque quelquefois, mais il refait toujours surface. C’est comme les tableaux des surréalistes qui ont copié les statues africaines. Ces peintres ont nié leur plagiat. Mais aujourd’hui, ce sont les peintres africains qui rayonnent dans les galeries du monde. Le synonyme de la culture noire est le modernisme indémodable. Il se réinvente. Voilà le pouvoir de la culture noire.
Le synonyme de la culture noire est le modernisme indémodable. Il se réinvente. Voilà le pouvoir de la culture noire.
Que faites-vous d’autre lorsque vous n’écrivez pas et n’écoutez pas le jazz ?
J’aime passer dans les bibliothèques de mon quartier. Je vais à la rencontre des livres. Quelquefois, j’ai un bouquin précis en tête. Mais la plupart du temps, je vais comme on va dans une gare de train ou un aéroport. Je vais croiser quelqu’un, un auteur, une auteure qui va me faire voyager. Quelquefois, je reviens bredouille. Si je ne fais pas ça, je regarde un film, souvent je revois un film que j’aime.
Un projet d’écriture en cours ?
J’ai des romans dans mes tiroirs. J’en sors un et je décide si c’est satisfaisant. J’ai toujours un projet d’écriture.
Merci, Didier Leclair !
Par Boris Noah