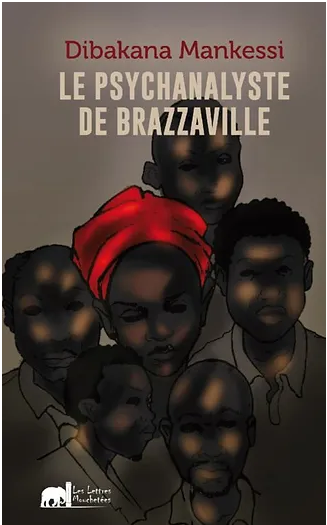Laurent Robert, bienvenue dans le Magazine Ou’Tam’Si. Comment se porte le champ littéraire belge ?
Merci ! Je dirais qu’il se porte très bien en termes de vitalité et d’activité. On pourrait évidemment mentionner la reconnaissance récurrente d’auteurs belges sur la scène littéraire française (parisienne) : citons en poésie Sébastien Févry et Anna Ayanoglou, Prix Apollinaire Découverte respectivement en 2019 et 2020, sans parler du Renaudot d’Amélie Nothomb en 2021. Je pointerais plutôt la création d’évènements qui ont pu traverser ou affronter la crise pandémique, par exemple le Poetik Bazar, marché de la poésie bruxellois, bilingue (à la fois francophone et néerlandophone). Évoquons aussi, à l’initiative du poète national Carl Norac, l’opération « Fleurs de funérailles ». Au début de la pandémie, les morts étaient inhumés ou incinérés pratiquement sans cérémonie et avec une assistance très réduite. Carl Norac a eu l’idée de faire écrire des poèmes à des poètes belges pour dire à ces funérailles, pour qu’il y ait au moins cela. Une centaine de poètes ont répondu à l’appel, aussi bien néerlandophones que francophones. C’est d’ailleurs une remarque que l’on peut faire : le champ littéraire belge se pense de plus en plus dans le dialogue entre communautés linguistiques (à contre-courant des chicanes politiques). Citons encore deux anthologies récentes de poésie belge francophone : un numéro spécial de la revue Le Journal des poètes (4, 2021) et Une poésie de vingt ans (Espace Nord, 2022).
Entre l’enseignement, la critique littéraire, la recherche scientifique et la poésie, quelle est la passion qui l’emporte sur les autres chez vous ?
C’est clairement la poésie, je veux dire l’écriture de poésie, qui l’emporte. L’écriture et l’achèvement d’un poème procurent un plaisir presque sensuel, que ne recèlent pas les autres activités !
Pourriez-vous partager avec nos lecteurs, les prémices de votre passion pour les Lettres en général ?
Assez classiquement, c’est une passion qui remonte à l’enfance et à l’adolescence. Dès que j’ai commencé à apprendre à lire, j’ai trouvé cela fabuleux. Ma famille n’était pas riche, mais j’ai toujours reçu des livres en cadeau. Après, il faut souligner le rôle des enseignants. La confrontation avec les grands textes est essentielle. J’ai aussi eu la chance à l’adolescence de faire du latin et du grec : la puissance d’Homère, de Sophocle, d’Euripide, l’impertinence de Martial, de Juvénal, quelle claque ! Et en anglais Animal Farm d’Orwell. Les deux premiers livres que j’ai acquis adolescent, et je les ai toujours, c’était Les Fleurs du mal de Baudelaire et Le Livre d’or de la poésie française de Pierre Seghers.
Vous êtes essentiellement poète, pourquoi la poésie et non les autres genres ?
J’aimerais beaucoup avoir la puissance de Philip Roth ou de Gabriel García Márquez, mais c’est impossible. Comme le poète anglais Philip Larkin, je dois reconnaître que je ne suis pas capable de grand-chose d’autre que d’écrire de la poésie. J’aime composer la miniature d’un poème, je ne parviens pas à peindre cette grande fresque qu’est le roman. Je porte trop d’attention aux mots, à chaque mot, sans doute aussi. Certains écrivains peuvent toucher à tous les genres, mais fondamentalement je pense qu’on ne choisit pas. Il y a en outre une espèce d’anachronisme et de marginalité dans la poésie qui me conviennent. Cependant, mon recueil Gorgonzola était une biographie d’Émile Zola, mais sous la forme de 155 tanka. Si j’écris un jour un roman, ce sera probablement en poèmes, en vers !
Vous avez publié votre premier livre, Protocole du seul, en 1994, chez Unimuse. Qu’est-ce qui vous inspire l’écriture de ce livre et de quoi parle-t-il ?

Si je me replace dans l’état d’esprit de l’époque, je pense que je l’ai d’abord écrit pour échapper à une sorte de stérilisation de l’écriture que générait l’exégèse universitaire. Je ressentais que le commentaire de la poésie finissait par tuer le poème, y compris celui que je pourrais écrire. La première partie du recueil est d’ailleurs à prendre à la fois comme une rupture et un passage de témoin. J’avais consacré mon mémoire de Master au poète belge François Jacqmin. Je savais qu’il avait promis à sa filleule, Anaïs, de lui écrire vingt poèmes pour ses vingt ans – promesse non tenue, car il est décédé en 1992. J’ai donc commencé mon recueil par « Vingt poèmes pour Anaïs », manière de poursuivre autrement mon travail sur Jacqmin et de rompre avec le commentaire, de retrouver la création – en prenant « Anaïs » comme une figure en partie abstraite, un peu comme la Lesbie de Catulle. Les deux autres sections « Sans » et « Protocole du seul » sont plus réflexives et torturées. De façon générale, c’est un recueil un peu hermétique, saturé d’images. Je ne le renie aucunement, mais je ne l’écrirais plus comme cela aujourd’hui.
Ce recueil de poèmes vous a permis de remporter le Prix Casterman la même année, à l’âge de vingt-cinq ans. Comment avez-vous accueilli cette récompense et quel a été son impact pour la suite de votre vie de poète ?
En réalité, c’était un prix accordé sur manuscrit anonyme, et qui débouchait sur l’édition du recueil. J’étais évidemment très heureux de recevoir ce prix, qui permettait à mon premier livre d’exister. Malheureusement, l’impact pour la suite a été nul. Cela a même été difficile à vivre. Après Protocole du seul, j’ai achevé un recueil de poèmes en prose, que je ne suis jamais parvenu à faire publier.
Laurent Robert, et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour publier Dix Haïku en 2014 et Métro Stalingrad en 2015 ?
Dans la continuité de la question précédente, simplement parce que j’ai essuyé de nombreux refus, malgré parfois des commentaires très positifs. C’était d’ailleurs ça le plus dur : l’hypocrisie de s’entendre dire que ce que l’on fait est très bien, mais sans que cela débouche sur une proposition concrète.
Votre livre, Sonnets de la révolte ordinaire (Éditions Aethalidès, 2020), est un ensemble de « sonnets d’aujourd’hui et tares assumées : belgitude, babélisme, anachronismes, références cavalières ou cavalièrement traitées, mauvaise foi, goût salé-sucré des femmes. » Pouvez-vous nous en dire plus, s’il vous plaît ?
C’est tout d’abord un recueil où je me confronte à la forme du sonnet. C’est une forme que je sacralisais (et sacralise encore) : c’est le poème des poèmes, une forme difficile et pratiquée par les plus grands poètes. Je ne pensais pas moi-même m’y adonner ; ça me semblait incongru et au-dessus de mes forces. Un jour, je le raconte dans la postface du recueil, c’est venu, presque naturellement. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j’écrivais, que c’était une forme contraignante par définition, mais aussi très souple, qui autorisait beaucoup de choses, tant en termes de variations formelles (il y a des centaines de déclinaisons de la forme sonnet) que de contenu. Il y a des sonnets d’amour, des sonnets métaphysiques, des sonnets du quotidien, des sonnets érotiques, politiques… « Belgitude », car je n’affirme pas spécialement une identité belge, mais je la laisse affleurer, elle est là, il n’y a pas de raison de la gommer. Un village ou une ville de Wallonie ou du Québec ou de Tunisie ou du Congo n’est pas moins poétique qu’une rue de Paris. « Babélisme », car j’aime jouer avec les langues et insérer des mots étrangers dans mes poèmes. Sans entraver, je crois, la compréhension, on y trouve de l’anglais, du néerlandais, de l’allemand, de l’italien, du latin, etc. C’est aussi le français de Belgique, le franglais, la variation sur les registres de langues, les tons… J’aime également mélanger les références culturelles, en faisant allusion aussi bien à des figures littéraires classiques (Homère, Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud) qu’à des écrivains contemporains ou à des cultures plus populaires comme certaines musiques, le metal (Rammstein), le rap (Damso), la variété (Michel Sardou, Julien Doré), ou comme la mode… Quant au « goût salé-sucré des femmes », il est évident que ma poésie recèle une dimension érotique…
Le haïku — cette forme poétique née au Japon — et le sonnet reviennent dans plusieurs de vos publications. Et dans l’ensemble, vos textes sont l’expression d’une sorte de révolte stylistique et esthétique qui est également visible à travers les thèmes que vous abordez. Finalement, quelle est votre perception de la poésie, et que représente-t-elle pour vous ?
La poésie pour moi s’incarne dans le poème, lequel s’incarne dans une forme. J’adhère assez à ce que dit Michel Houellebecq dans Rester vivant, lorsqu’il explique, en substance, que la poésie est une manière de structurer son cri. La vie est insupportable, le monde est insupportable. La poésie est une façon apaisée de crier – oxymore assumé. Une façon jouissive pour l’auteur et, espérons, pour le lecteur. Une façon en outre de créer un objet esthétique qui soit, selon les cas, beau, drôle, interpellant, percutant… Le recours à des formes métriques ou à contraintes (comme le haïku, le tanka, le sonnet, mais d’autres sont possibles) participe de la dynamique créative. Je décide généralement à l’avance d’un nombre de poèmes (3X50 haïku, 112 sonnets, etc.), ce qui permet de fixer le projet. Par ailleurs, depuis la fin du dix-neuvième siècle, toutes les formes ont été progressivement remises en question et déconstruites. Il est donc illusoire de prétendre à la nouveauté. Au contraire, des formes concertées peuvent sembler plus singulières que les quatre-vingts ou quatre-vingt-dix pour cent de vers libres qui constituent la production poétique publiée actuellement.

Précis de survie (Éditions Maïa, 2022) est votre dernière publication. Une réaction à l’atmosphère morose qu’a créée la pandémie de Covid-19 ?
Oui, en partie du moins. J’avais commencé à l’écrire pendant que se préparait la publication de Sonnets de la révolte ordinaire. Puis est arrivée la pandémie. Je n’ai pas voulu toutefois que ce soit un « journal du Covid » comme il y en a eu beaucoup. La première partie, « Précis de survie » justement, parle de l’étrangeté de cette période, des privations de liberté qui ont eu lieu, certaines de bon sens, d’autres totalement absurdes, et de la mort, étrange elle aussi, à la fois omniprésente et impalpable. La deuxième partie, « Un verre avec Charles Bukowski », rend hommage principalement à des poètes d’époques et d’horizons variés : des sonnettistes du seizième siècle croisent des jeunes poètes contemporaines, qui espagnole (Luna Miguel), qui française (Élodie Petit), qui québécoise (Chloé Savoie-Bernard) ; des Parnassiens (Léon Dierx, Sully Prudhomme) côtoient des poètes italiens (Pasolini, Moravia), américains (Frost, Hemingway, Bukowski, Louise Glück) ou le poète belge William Cliff plusieurs fois mentionné. La troisième partie « Rage et marasme » comprend des évocations de mon chaos personnel ainsi que quelques coups de gueule…
Votre thèse de doctorat soutenue en 2009 porte sur l’écrivain français Georges Fourest, décédé en 1945. Une thèse transformée en Essai en 2012, sous le titre : Georges Fourest ou le carnaval de littérature (Éditions Universitaires de Dijon). Pourquoi avoir décidé à votre manière de mettre en lumière cet auteur ?
Je ne connaissais, comme beaucoup, que son sonnet « Le Cid », était le travestissement burlesque de la pièce de Corneille. Quand j’ai lu son recueil La Négresse blonde, puis Le Géranium ovipare, j’ai adoré : c’était drôle, érudit, subtil et impertinent, avec une grande maîtrise de l’écriture poétique et une extraordinaire inventivité verbale. En cherchant des travaux qui étaient consacrés à Fourest et à son œuvre, j’ai vu qu’il n’y avait pratiquement rien : aucune biographie, aucune étude d’ensemble, aucune thèse, tout au plus deux ou trois articles universitaires et quelques notices biographiques succinctes et imprécises. Non seulement l’œuvre m’enthousiasmait, mais elle n’avait pas été traitée ! Je n’ai pas hésité longtemps à y consacrer ma thèse.
Pendant une quinzaine d’années, vous avez été Critique littéraire pour la revue Le Carnet et les Instants, dont le Rédacteur en chef était l’écrivain Carmelo Virone. Étant donné que vous êtes également professeur de littérature, est-ce que vous pouvez expliquer à nos lecteurs ce qu’est la critique littéraire ?
La critique littéraire a deux objectifs : informer le public sur les livres qui sortent et porter un jugement de goût étayé sur les œuvres afin d’orienter ou de tenter d’orienter le choix des lecteurs. Idéalement, elle devrait mettre en lumière le moins connu, ce qui risque de passer inaperçu (comme la poésie, justement, ou des romans d’auteurs en devenir). Dans Le Carnet et les Instants, on se consacrait uniquement à des œuvres d’auteurs belges (la revue étant financée par la Promotion des Lettres belges). La dimension critique n’était pas très appuyée ni polémique. Actuellement, la critique journalistique joue un rôle moins important, en raison de la place prise par la critique des lecteurs sur les blogues et sur les réseaux sociaux.
Vous arrive-t-il de vous intéresser à la littérature africaine de façon globale ?
Il est difficile de considérer la littérature africaine de façon globale. C’est un ensemble extrêmement vaste et polymorphe. Stricto sensu, André Brink (Sud-Africain écrivant en afrikaans et en anglais), Nadine Gordimer (Sud-Africaine anglophone) ou Pepetela (Angolais lusophone) sont des écrivains africains, de même que Naguib Mafouz (Égyptien qui écrivait en arabe). À la Haute École en Hainaut, je fais un cours sur les littératures francophones hors de France, expression qui ne vaut absolument pas mieux, où j’aborde des auteurs africains francophones, que ce soit du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne, ainsi que des écrivains des Antilles, du Québec, du Liban, d’Iran, etc.
Quels sont les auteurs africains que vous avez lus, et lesquels vous ont le plus marqué ?
Outre mon admiration indéfectible pour Senghor, je mentionnerais le romancier congolais Inkoli Jean Bofane (Mathématiques congolaises ; Congo Inc. Le Testament de Bismarck, 2008 et 2014, Actes Sud) et le romancier et poète algérien Mustapha Benfodil (Alger, journal intense, Macula, 2019 ; Cocktail Kafkaïne : Poésie noire, Hesterglock Press, 2018).
Pour sortir, voudriez-vous nous parler de vos projets à court et à long terme ?
En ce moment, je travaille conjointement sur deux projets : un nouveau recueil de sonnets et un recueil de « morales élémentaires » (forme fixe imaginée par Raymond Queneau). Je ne peux pas en dire beaucoup plus !
Laurent Robert, merci d’avoir répondu à nos questions.