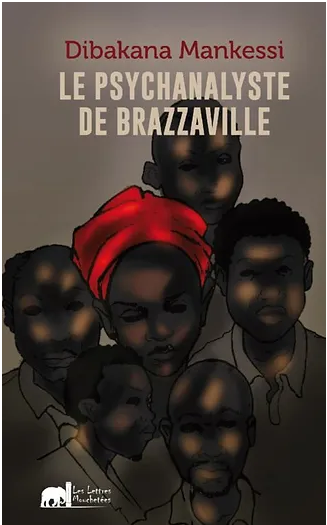Comme je ne voyais pas d’enfants comme moi dans les livres que nous étudions en classe, j’ai commencé très tôt à faire mes propres histoires.
Laura Nsafou, vous êtes née en France d’un père congolais et d’une mère martiniquaise. Comment s’est passée votre intégration dans cette société occidentale qui vous a vue naître et grandir ?
Je ne sais pas si j’ai vécu cela comme une intégration, je me souviens surtout du décalage entre mon quotidien avec ma famille, et ce qui était retranscrit dans les médias (des reportages misérabilistes ou exotiques sur l’Afrique et les Antilles, les discours xénophobes sur l’immigration, quelques séries avec des personnages noirs américains, etc.) et dans les institutions, comme l’école.
La question de l’identité est de plus en plus inévitable au regard de tous les mouvements migratoires qui régissent le monde contemporain. Alors, le fait de vous considérer comme une « Afropéenne », ne serait-ce pas un moyen voilé de prendre une distance de vos origines africaines ?
Est-ce qu’une personne se désignant comme Antillaise « prend de la distance avec ses origines » en faisant cela ? Je pense que c’est essentialiser l’Afrique que d’en faire bloc auquel on n’appartiendrait ou non, plutôt que de la voir comme la matrice d’une diaspora riche et diversifiée, aux trajectoires et aux vécus divers et légitimes. Le terme Afropéenne a donc le mérite de souligner la spécificité d’un vécu d’une personne noire née en Europe, bien distinct de l’expérience d’une personne noire en Amérique du Nord ou du Sud, par exemple. Il précise le contexte de mon identité, et n’est pas le seul à la définir.
Peut-on être Afropéenne sans se montrer plus occidentalisée qu’africanisée ?
Est-ce qu’une femme noire est plus femme que noire ? Je ne pense pas que ce soit des éléments mesurables, il y a tellement de facteurs socio-culturelles et économiques qui modulent une identité, et ce, dans le temps, que j’ai du mal à voir sur quels critères on pourrait mesurer ces parts d’une même personne. On peut bien sûr expliquer qu’une personne afropéenne sera toujours plus occidentale qu’une personne africaine née sur le continent, par son vécu… Mais peut-on faire ces mêmes distinctions à l’intérieur d’une personne ?
Quel rapport entretenez-vous avec le Congo de votre père d’abord, et la Martinique de votre mère ensuite ?
Mon père a su me transmettre son affection pour son pays, et tout particulièrement pour la ville de Pointe-Noire dont ma famille est originaire. Je crois que connaître l’histoire de ma famille, les pratiques culturelles et spirituelles de celle-ci m’ont plus rapprochée du pays que le fait de m’y être rendue. Ça a beaucoup inspiré notamment le second tome de Nos Jours Brûlés, ma trilogie afrofantastique.
Quant à la Martinique, il était plus facile d’y voyager d’un point de vue économique, j’ai donc pu y aller plus souvent et c’est un territoire où je me sens tout autant chez moi. Mais bon, que ce soit l’un ou l’autre, les gens sont toujours prompts à vous rappeler que vous n’êtes pas vraiment de là, alors je vis cela davantage comme un cheminement personnel.
C’était quand la première et la dernière fois que vous avez visité ces deux terres ?
Quelques années pour les deux territoires. Je devais d’ailleurs présenter mon travail à Pointe-Noire en 2020, mais il y a eu la crise du Covid-19, puis le décès de mon père. Ça m’est encore difficile de songer à m’y rendre en sachant que je ne l’y verrais pas.
Laura Nsafou, vous vous adonnez à l’écriture très tôt. Dès l’école primaire, vous présentiez déjà des prédispositions à faire couler votre imagination sur du papier. Pourriez-vous nous décrire les sentiments qui vous animaient à cette époque ?
Comme je ne voyais pas d’enfants comme moi dans les livres que nous étudions en classe ou dans les dessins animés, j’ai commencé très tôt à faire mes propres histoires, en les dessinant et les écrivant. J’avais envie d’être au plus proche de ce que j’avais en tête, et le seul moyen dont je disposais était l’écriture.
En reparcourant vos souvenirs, quel a véritablement été le déclic de cette pulsion, pourrait-on dire, qui ne vous a plus quittée ?
J’avais douze ans quand j’ai fini mon premier roman. Il faisait 400 pages, et je ne me sentais pas fatiguée ou lassée. À ce moment-là, j’ai su qu’écrire aurait une place particulière dans ma vie, au moins comme passion.
À l’âge de 16 ans, vous matérialisez votre rêve à travers la publication de votre premier roman intitulé Callie, juste vous et moi.Selon vous, pourquoi ce premier jet littéraire n’a-t-il pas connu le « succès » que l’adolescente que vous étiez escomptait ?
Oh, pour plein de raisons. C’était chez un petit éditeur qui n’en a fait aucune promotion, l’histoire avait quelques faiblesses et je crois que j’étais trop jeune pour prendre la mesure de ce qu’était le monde de l’édition.
Dans ce texte de 143 pages, vous racontez l’histoire de Callie, une jeune fille qui vit avec trois colocataires masculins… De quoi était-il question de fond en comble ?
C’était vraiment une comédie romantique à la manière des sitcoms américaines, mêlant amitié, amour et le fait de devenir adulte.
Après une attente presque longue, vous publiez votre deuxième roman, A mains nues (Éditions Synapse, 2017). Vous y racontez le combat de la jeune Sibylle qui tente de se libérer de l’haptophobie dont elle souffre. Quel est le lien entre le titre et cette peur de toucher ou d’être touchée que manifeste la protagoniste ?
Sibylle a peur de toucher, et va découvrir qu’avec la danse, elle peut non seulement se réapproprier son corps, mais aussi son rapport au monde, et le prendre à mains nues, du moins à sa manière.
S’inspirant de la quatrième de couverture du roman, et si l’on vous demandait : comment peut-on toucher autrement ?
Très bonne question. Je pense que le rapport au toucher est plus codé qu’on le pense, et qu’il y a une curiosité à nourrir sur le lien commun. Comment fait-on le lien avec les autres ? Susciter l’émotion est une manière de le faire.

Nos Jours brûlés, votre dernier roman, a été publié aux Éditions Albin Michel. Dans le premier tome paru en 2021, l’histoire se déroule en 2049. Et « depuis vingt ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la pénombre. » Une référence à la période sombre de la Covid-19 ?
C’est effectivement durant cette période que je l’ai écrit. Mais plus largement, le changement climatique, la montée de l’extrême droite dans plusieurs pays du monde et le recul de nos droits sont autant de raisons d’évoquer un monde sombre.
La protagoniste Elikia, qui naît après la Grande nuit, se fixe pour mission, avec l’aide de sa maman, de faire revenir le soleil dans le monde. On voit là, comme toujours, votre volonté de placer la femme au centre des attentions… Mais cette fois, vous faites recours à certaines pratiques comme la magie. Et pourquoi ?
Les mythes et spiritualités d’Afrique anglophone ont beaucoup été évoqués ces dernières années, notamment dans l’Afrofuturisme, l’Afrofantasy, ou encore l’Afrojujuisme. Je me demandais pourquoi cette curiosité s’y arrêtait et me suis penchée sur ceux des pays d’Afrique francophone. Plus que la magie, l’aventure d’Elikia est l’occasion de questionner le rapport au réel, et les savoirs perdus.
Dans le deuxième tome paru en septembre 2022, Elikia n’a toujours pas pu ramener le jour dans le monde. Que doit-on finalement retenir de ce récit initiatique ?
Je pense qu’il y aura une conclusion à retenir à la sortie du tome 3, la fin de son épopée.
Que répondez-vous à ceux qui trouvent certains passages de vos romans assez acerbes, concernant notamment l’expression du plaisir du corps de la femme, et que doit-on comprendre par-là ?
Je pense que ça leur appartient. Je serai néanmoins curieuse de savoir s’ils lisent tant de récits écrits par des femmes sur ce sujet pour varier leurs horizons, ou s’ils se sont juste contentés des représentations hypersexualisantes que l’on voit dans les médias.
En 2013, vous créez une plateforme, Mrs Roots, avec pour slogan : « Écrire. Pour qu’il ne soit plus possible de dire encore une fois : Je ne savais pas ». Quelles ont été vos motivations à mettre sur pied ce blog ?
Je voulais justement rendre la complexité que soulève mon identité, hors des cases selon lesquelles il faudrait être assez Française, assez Congolaise, etc., et questionner les représentations qui existent autour des femmes noires en France. C’était assez salvateur d’avoir cet espace où beaucoup de femmes noires se sont retrouvées.
Vous y exprimez abondamment votre engagement pour l’afroféminisme et nous sommes curieux de savoir comment vous êtes devenue afroféministe ? Est-ce à cause d’un événement particulier qui vous aurait marquée ou à cause d’une rencontre ?
À cause d’une rencontre, je pense. Disons que l’ouverture de ce blog est tombée au moment même où une pensée afroféministe était de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Je l’ai découvert avec le blog Ms Dreydful, comme la possibilité de ne pas avoir à choisir entre féminisme et antiracisme, mais bien un mouvement qui réponde à une véritable intersectionnalité.
Quel est l’intérêt aujourd’hui d’être afroféministe ?
C’est le seul mouvement politique qui lutte activement contre les violences systémiques visant les femmes afrodescendantes, sans qu’il ne leur soit demandé d’attendre ou de passer après l’agenda politique d’un autre groupe.
Comment s’est faite la rencontre avec Toni Morrison et jusqu’où a-t-elle influencé votre écriture, votre engagement ?
Tar Baby a été l’un des premiers livres que j’ai lus, montrant une réalité proche de la mienne. Son désir de mettre les populations noires américaines, et notamment les femmes noires au centre de son œuvre a été une véritable inspiration, et m’a montré qu’il était possible de nous dire.
Qu’est-ce qui vous inspire le plus dans l’œuvre de Toni Morrison ?
La part politique de son parcours, comment elle a permis en tant qu’éditrice la publication de textes marquants comme l’essai d’Angela Davis et la traduction vers l’anglais d’auteurs africains.
Vous êtes également auteure des Bandes dessinées. Selon vous, quelle est la place de ce genre dans la littérature ?
Il est aussi légitime qu’un autre, et apporte une vraie plus-value en termes de narration plus visuelle. Je suis convaincue que chaque livre peut être une porte d’entrée, quelle que soit sa forme.
Pour finir, vos projets en tant qu’écrivaine, en tant que militante féministe…
Je me consacre au dernier tome de ma trilogie Nos Jours brûlés, et espère pouvoir me lancer dans d’autres projets par la suite.
Laura Nsafou, merci de votre disponibilité !
Par Boris Noah